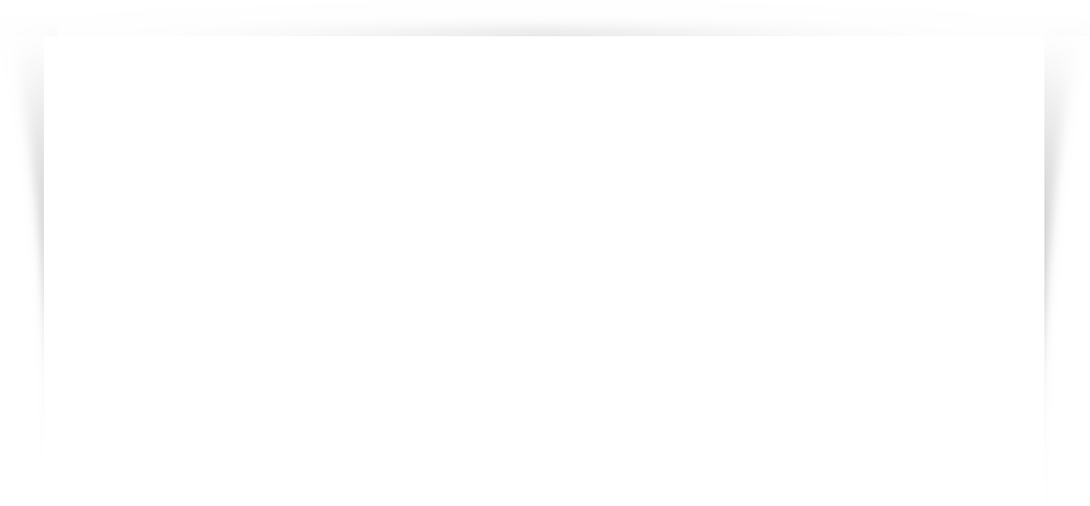
Télécharger - IRIS - Université Lille 1
GAUTHIER-VILLARS ET FILS
G.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
MASSOX
ENCYCLOPÉDIE SCIENTIFIQUE DES AIDE-MÉMOIRE
COLLABORATEURS
Section
de
l'Ingénieur
MM.
MM.
MM.
Gassaud.
Margerie.
Alheilig.
Gautier (Armand).
Meyer (Ernest).
&.rmengaud jeune.
Gautier ( H e n r i ) .
Michel-Léyy.
.irnaud.
Bassot (Colonel).
Godard.
Minel{Pol).
Gouilly.
Minet (Ad.).
Baume Pluvinel (de la'.
Grouvelle ( J u l e s ) .
Moësgard (Comm').
Borard ( A . ) .
Guenez.
Moissan.
Bergeron ( J . ) .
Guillaume (Ch.-Ed.).
Honni er,
Berthelot.
Guye ( P h . - A . ) .
Moreau (Aug. ).
Bertiii.
Guy ou ( C o m m ) .
Billy (Ed. de).
Hatt.
Ouvrard.
Bloch ( F r . ) .
Hérisson et Roche.
Perrin.
Alain-Abadie.
1
Naudin (Laurent).
Blondel.
Hospitalier ( E . ) .
Perrotin.
Boire { E m . ) .
Hubert ( H . ) .
Picou (R.-V.).
Boucheron (H.).
Hutin.
Poulet (J.).
Candlot.
Jacométy.
Resal (J.).
Caspari.
Jean (Ferdinand).
Ricaud.
Charpy (G.).
Labouret ( d e ) .
Rocques-Desvallces
Rouché.
Clugnet.
Launay ( d e ) .
Croneau.
Laurent ( H . ) .
Sarrau.
Damour.
Lavergne (Gérard).
Sauvage.
Defiorges (Coitim ].
Léauté (H.).
Schlœsing fila (Th.
Delafond.
Le Chatelier ( H . ) .
Schiitzenberger.
Dudebout.
Lecomte.
Seyrig ( T . ) .
Duquesnay.
Leloutre.
Sinigaglia.
1
Durin.
Lenicque.
Sorel.
Dwelshauvers-Dery.
Le Verrier
Urbain.
Etard.
Lindet ( L . ) .
Vcrmand.
Fahre ( C ) .
Lippmann ( G . ) .
Viaris (de).
Fourment.
Lumière ( A . et L.).
Widmann.
Fribourg (Comm ).
Madamet (A. ).
Witz (Aimé
Frouin.
Magnier de la Source.
Garnier.
Malher ( P . ) .
1
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
ENCYCLOPÉDIE
SCIENTIFIQUE
DES
AIDE-MÉMOIRE
PUBLIER
SOUS LA DIRECTION
DE M .
LKAUTÉ, MEMBRE DE I / I N S T I T U T
Lii CHA,TR LIETI — G ri FOU.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
1
Ce volume
scientifique
Élève
46,
est
de l'École
rue
une
publication
des Aide-Mémoire
Jouffroy
de
l'Encyclopédie
; F. Lnfargue,
Volt/technique,
Secrétaire
(boulevard
Malesherbes),
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
ancien
gémirai,
Paris.
ENCYCLOPÉDIE SCIENTIFIQUE DES AIDE-MÉMOIRE
Ï'L'BLIÉIÎ SOUS R.À
DineriTios
DB M. L E . V U T É , MEMUUK DE L'INSTITUT.
LE
GRISOU
PAR
H .
L E
C H A T E
L I E R
I n g é n i e u r e n c h e f des M i n e s
P r o f e s s e u r à l ' E c o l e n a t i o n a l e des M i n e s
"cli i m i e à l ' É c o l e P o l y t e c h n i q u e
PARIS
GAL'TIIIKU-YIU.AIIS ETFII.S,
G. M.4SSON, ÉIIITECH,
IMPRIIII:UHS-KDIT^^I\S
I-IBUATHE nv, I.'ACADRMIB DK MIIUITISE
Quai des Grands-Àiignsfins, 55
Boulevard Saint-Germain. 120
( T o u s CLÏOUS r é s e r v é s )
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
PREMIÈRE
CHAPITRE
PARTIE
PREMIER
NAT LR F. E T P R O D U C T I O N DU GRISOU
1. C o m p o s i t i o n d u G r i s o u . — On désigne
s o u s l e n o m d e grisou
(') u n gaz
combustible
q u i se d é g a g e s p o n t a n é m e n t d a n s l a p l u p a r t d e s
m i n e s de houille, parfois aussi m a i s , b e a u c o u p
plus rarement, dans certaines mines métalliques,
d a n s les m i n e s d e sel et d a n s les s o u f r i è r e s
Sicile. Mélangé e n p r o p o r t i o n
convenable
l'air q u i s e t r o u v e d a n s l e s g a l e r i e s d e m i n e ,
d o n n e naissance à des m é l a n g e s
l'inflammation
explosifs
accidentelle provoque
ces
de
avec,
il
dont
terri-,
bles catastrophes q u i a m è n e n t parfois d a n s l'es-
(') Grisou, brisou, terroux, feux grieux, mofette,
juauvais air, mauvais goût, /ire lire, fire
datnp,
Sr.hlac/e.iide
Wetter.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
paoe de q u e l q u e s m i n u t e s la m o r t
centaines
de
plusieurs
d'ouvriers.
D a v y e n i 8 i 3 (') a v a i t c o n c l u d e ses
que
gène
le
grisou
élait
5
( ) mêlé
à
de
analyses
d u protocarbure
petites
d'/u/dro-
quantités
i n e r t e s : azote et acide c a r b o n i q u e ,
de
gaz
c'est-à-dire
était identique c o m m e composition c h i m i q u e au
gaz
des
marais.
Aujourd'hui on
admet généra-
lement mais sans preuves suffisamment sérieuses,
q u e le g r i s o u r e n f e r m e e n d e h o r s d u p r o t o c a r b u r e
u n e certaine quantité d'autres gaz combustibles :
hydrogène
libre
ou
carbures moins
riches
en
h y d r o g è n e q u e le p r o t o c a r b u r e .
Les échantillons de grisou s o u m i s à
chimique
très
ont
différents,
mêmes
été recueillis
qui
garanties de
d e u x seuls qui
soient
p a r des
procédés
sont loin
d e p r é s e n t e r les
pureté
le g a z .
pour
irréprochables
à r e c u e i l l i r le g r i s o u q u i p r o v i e n t
flards,
l'analyse
soit de
c'est-à-dire des d é g a g e m e n t s
Les
consistent
sauf-
c o n t i n u s se
p r o d u i s a n t en c e r t a i n s e n d r o i t s par les fissures d u
massif d e h o u i l l e ou des r o c h e s e n c a i s s a n t e s , soit
4
( ) J)AVY. — Le grisou (Ann. de Phys.
et
Chim.
i ° série, t. I.).
( ) Protocarbure d'hydrogène, gaz des marais, form ù n e , iiu'thane, hydrure de m t - t h y l e , hydrure de méthy
lène. C' H (équivalents), CH (atomes).
r
2
-
2
4
4
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
de
trous
de
sonde
percés
dans
le m a s s i f
de
houille.
D a n s bien des cas on a e m p l o y é p o u r
se
pro-
e u r e r d u grisou un procédé beaucoup plus simple,
m a i s t o u t à fait d é f e c t u e u x , q u i c o n s i s t e à c h a u f f e r
au laboratoire des fragments de houille r é c e m m e n t
e x t r a i t s de la m i n e en les p o r t a n t à la t e m p é r a t u r e
d e i o o ° d a n s le v i d e o u d a n s u n c o u r a n t d e v a p e u r
d ' e a u . On a s u p p o s é , s a n s avoir j a m a i s essayé d'en
f a i r e l a p r e u v e q u e le g a z a i n s i d é g a g é é t a i t s i m p l e m e n t e m p r i s o n n é d a n s le c h a r b o n et n e p r o v e nait, p a s d e sa d é c o m p o s i t i o n . Si cette h y p o t h è s e
semble exacte pour un g r a n d n o m b r e de houilles
q u i n e c o m m e n c e n t à se d é c o m p o s e r q u ' a u - d e s s u s d e 3oo° et m ê m e à celte t e m p é r a t u r e n e d o n n e n t q u e d u g o u d r o n , les g a z n e c o m m e n ç a n t à
apparaître que
v e r s 4oo°> e l l e e s t
inexacte pour plusieurs
variétés
certainement
du
charbon :
le c a n n e l c o a l , le l i g n i t e , l a p o u s s i è r e d e h o u i l l e
oxydée à l'air
et p r o b a b l e m e n t
aussi
quelques
variétés de h o u i l l e m ê m e n o n o x y d é e . T o u t e s les
a n a l y s e s faites s u r des gaz s e m b l a b l e s
ne
peu-
vent donc être rapportées au grisou.
2. A n a l y s e .
—
Voici
g r i s o u effectuées s u r d u
quelques
analyses
de
g a z p r o v e n a n t d e souf-
flards ou de t r o u s de sonde et offrant p a r suite
les g a r a n t i e s de p u r e t é d é s i r a b l e s .
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
Provenance du gar
Mine de Dunraven.
(soufflard)
(trou de sondS) .
Mine de Garswood .
Mine de Ciamorgan.
(soufflard)
Mine de Dombran.
(soufflard)
Mine de Karwin
. .
(soufflard)
Mine de U m s c h a u .
(soufflard).
Mine de Peterswald.
(soufflard)
Mine de Segen Gottes.
(trou de sonde).
Mine do Liebe Gottes.
(trou de sonde) .
C02
0
Ar
0.4:
6,5
o,4i 3,0-i
«4,i6 o,8(j 12,3
88,8H 0.',, 8.90
a
9
A u t e u r s den
analyse*
0,0 J.-W. Thomas (')
II
0,0
Q,tj."l W. Kellner (')
//
1,83
-79
()3,oi 0,27 • ., 4 0,78
r
II
9
gfi, 11 o/,8 '..07
• 0,18 4.48
0,2
99°»:
7y,lfi
3,, 9
8 ; , 3 o,83 IO,2. i
10
r
9
o,34
O^'l
0,0
0,6'1
°.<)9
90,ou 0,1.") 9,2.'l o.fiu
83,51 1,17
u.3o
87,1b 1,11 11,73 0,0
J,
I
02
3,77 18,48 0,06
;:i«9
«biCeonmnomsoin
//
II
II
II
II
Sauer («)
II
II
(') J . W . THOMAS. — On the gases enclosed in Coals
from the South Wales Bassin and the gases evolved by
blowers and by boring into the Coal itself.
(Journal
of the Che.mic.al society of London, 2 série Tome XIII,
187S).
( ) D'W. KELLNER. — Senior assistant Chemist of the
war département. Analysis of fire damp. (Final
report
of her Majestys
commissionners
appointedto
inquire
into accidents of Mines, p. i4'»-i86J
( ) Schlussbericht der Centralcomitte d e r ö s t e r i - e i s
chischen S c h l a g w e t t e r commission p. 18, 1891.
( ) Voir note de la p. 23.
e
!
3
l
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
aulri-
du ç r i i o u
(2)
Ces a n a l y s e s et b e a u c o u p d ' a u t r e s
n ' a c c u s e n t d a n s le g r i s o u
semblables
c o m m e gaz
combus-
t i b l e q u e le p r o t o c a r b u r e d ' h y d r o g è n e .
Quelques
unes cependant indiqueraient
que
l'hydrogène,
d'autres
l'éthylène,
gaz
l'hydrure
tels
d'éthy-
lène ; c ' e s t l à u n point, q u i m é r i t e d'être é l u c i d é ,
c a r ces g a z , p l u s f a c i l e m e n t
inflammables
menteraient,
par
notablement
le d a n g e r du
aug-
présence
grisou.
\Jéthylène
lîishoiï en
leur
n'a
jamais
été signalé
que
imprimées, ent
fini
par acquérir
une
autorité
qu'elles ne méritent en a u c u n e façon. Les
thodes
par
1 8 4 1 - S u s a n a l y s e s , à. f o r c e d ' ê t r e r é -
d'analyse
employées
ne
mé-
comportaient
a u c u n e e x a c t i t u d e , à ce p o i n t q u e les
quantités
d'éthylène trouvées dans un m ê m e gaz ont varié
de o à
îo
°
/0
suivant
le
procédé
de
dosage
suivi.
h'hydrogène
e t l'hydrure
d'éthylène
signalés un peu plus souvent,
d a n s les a n a l y s e s d u D
r
ont
été
particulièrement
Schondortf qui
ont
f a i t e s s o u s l e s a u s p i c e s d e la c o m m i s s i o n
été
prus-
sienne du grisou.
Antérieurement, a u x recherches, du D' S c h o n dorff, la p r é s e n c e d e l ' h y d r o g è n e d a n s le g r i s o u
avait été signalée d e u x
en
1841> p a r P l a y f a i r
fois : u n e
première
fois
qui avait, dans une seule
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
analyse, trouvé
3 °/
d e ce
0
gaz,
m a i s il a é t é
l
r e c o n n u d e p u i s ( ) q u e cet h v d r o g é n e é t a i t s i m plement
le
résultat
d'une
erreur
de calcul ;
2
u n e s e c o n d e l'ois p a r M . F o u q u é ( ) q u i a d o n n é
p o u r la c o m p o s i t i o n d u
souf/lard
de
grisou
provenant
d'un
la fosse R é u s s i t e à A n z i n :
cw
„3,."il
CO 2
51
3.Ü7
•2,34
0
A;
1
(),21
M a i s la m é t h o d e d ' a n a l y s e s u i v i e e t les r é s u l t a t s
bruts
de l ' e x p é r i e n c e
n ' a y a n t p a s c l é p u b l i é s , il
n ' e s t p a s p o s s i b l e d e d i s c u t e r c e s n o m b r e s . Il e s t
néanmoins
d e 2 , 2 4 °/o
certain
1 1 0
que la t e n e u r en
d é p a s s e pris l e s
hydrogène
erreurs
possibles
d'expérience.
L ' h y d r u r e d ' é t h y l é n e a v a i t é t é s i g n a l é p a r J.VV.
T h o m a s d a n s le g a z d u s o u f l l a r d g é a n t d e l a m i n e
de Clarmogan, à Llwynypiu,
plus
récentes du
D
p
Kellner
m a i s les
sur
analyses
le m ê m e
gaz
ont conduit à u n e conclusion contraire.
(') ERNST VON MEYEH. — Journal
fur
praktische
Chemie. 3° série t. V. p. I I J .
( ) Pièces annexées aux procès-verbaux de la
Coinmission du grisou, p. 7.Ì.
a
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
A u t e u r des analyses
Thomas
Kellner
.
.
.
.
CH*
.
.
9
î,oi
A z
C02
4- "0
0,72
0.^7
0,Ç)0
0,00
Les expériences récentes du D
i n d i q u e n t t o u t e s d a n s le g r i s o u
r
l
ScbondortT ( )
la p r é s e n c e
soit
d ' h y d r o g è n e , soit d ' h y d r u r e d ' é l h y l è n e . O n s e r a i t
tenté d'accepter sans discussion
ces c o n c l u s i o n s
si l ' o n s ' e n t i e n t à l ' e x t r ê m e p r é c i s i o n a p p a r e n t e
d e s e x p é r i e n c e s ; l e s t e m p é r a t u r e s ôLaiont m e s u r é e s
au ~
de d e g r é , et les p r e s s i o n s
a u ~ de
milli-
m è t r e ; m a i s l'on r e g r e t t e de voir q u ' a u c u n e
a n a l y s e s n ' a été répétée
deux
fois et q u e
des
dans
a u c u n cas les r é s u l t a t s b r u t s de l ' e x p é r i e n c e n ' o n t
é t é p u b l i é s c o m m e c e l a se f a i t t o u j o u r s d a n s
rechorebes
scientifiques
On est s u r t o u t
frappé
de
quelque
du manque
les
précision.
d'esprit
cri-
tique qui a p e r m i s à l'auteur de d é t e r m i n e r
des
t e n e u r s en gaz é t r a n g e r s inférieures à celles
que
lo c a l c u l p e u t i n t r o d u i r e p a r ]e f a i t d e
r
l'incerli-
(') Bericht von D SchondorfF liber die von Wetterlaboratorium zu B^chum ausgef uhrteri wissenschaftlischen und teohnischcn Erraittellungen [Anlagen
surn
Haupt Bericht der Preussîschen
schlagwelter
commission, i8<S5 — Band I (p.
et Journal
de
Carnall,
t . XXIV, p.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
t u d e q u i existe d a n s la d é t e r m i n a t i o n
équivalents
du
c a r b o n e , de
des
poids
l'hydrogène
l'oxygène ou des densités de leurs
et
de
combinaisons
g a z e u s e s . U n e d i s c u s s i o n a p p r o f o n d i e de ces a n a l y s e s est. i n d i s p e n s a b l e . V o i c i d ' a b o r d l e s
p a u x r é s u l t a t s p u b l i é s p a r le D
Provenance flu (çaz
CII4
r
princi-
SehondorlT.
4-
H
Cl>3
n
i,',o
0,'iu
7,3f)
II
:>,*',
o.lj;
3,l)i
o.fkï
13.8.',
C2U0
Az
O
SOUPFLARDS
Mine
Bonifaciusa
Kray (Essen) .
— Consolidation
à
Schalk
(Westphahe)
. . .
— König à Neunkirchen
(SaarHi,8.,
— Obemh irchen à 60.4«
Schaumburg
I ,0-1
îl
3 , (¡4
o,8N
1 .
:
I I
II
3,.Vj
Il
i,8o
0,1'3
CL U C Htë-S
Mine
Lothringen
à Castrop (Westphalie . . . . '-"7 •!'•""'
— I\eu
Iserlohn
à
Laugendren
i'7''
r
(Westphalie) .
t
1,3.*)
II
7°,'L)
.,3',
II
o,()(i
II
1;;,
0, '0
Ces a n a l y s e s , c o m m e t o u t e s les a n a l y s e s
blables
thode
d'ailleurs,
out
été
faites
eudioméf rique dans laquelle
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
par
sem-
la
t o u s les
mégaz
combustibles
autres
que
le
protocarbure
ne
p e u v e n t ê t r e d o s é s q u e p a r d i f f é r e n c e . Il e n
sulte que
foutes les
erreurs
d'expérience
résont
estimées sous f o r m e de corps réels tantôt c o m m e
hydrogène,
tantôt comme
s u i v a n t le s e n s d e
simple
montre
d'acide
carbonique
hydrure
ces e r r e u r s .
qu'une
erreur
produite
d'éthyléne,
Un calcul
sur
très
la
quantité
égale au
ou au
d u v o l u m e total c o n d u i t à a d m e t t r e les p r o portions suivantes
des deux
gaz
précités
dans
les cas o ù le m é l a n g e b r û l é est c o m p o s é d e * de
g a z c o m b u s t i b l e et * d ' o x y g è n e .
Krn'iirB sur
C02
o
— 0,001
— 0,01
- j - 0,001
C1H
H
C2H6
100
II
II
0,7
II
99,3
9M
99. 'l
94 .
La précision
du
G, fi
0
//
0,6
II
(i
est p r a t i q u e m e n t
sible à obtenir, celles d u ~
impos-
peut facilement
être
réalisée p a r u n opérateur soigneux.
Il est d o n c
dans
reconnaître
des
1
tous
les
quantités
0 ,
c
cas
de
impossible
gaz
étrangers
de
inférieures
à
: on n e p e u t r é p o n d r e avec c e r t i t u d e de l e u r
p r é s e n c e q u e l à o ù le c a l c u l i n d i q u e u n e
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
teneur
d'au m o i n s 6 ° / . On est ainsi c o n d u i t à ne rete0
n i r p a r m i t o u t e s les analyses d u D
q u e celle d u soufflard
3
dique
r
Schondorff
d'Obernkirchen
qui
in-
6
3 7 , 6 4 d o C H . M a i s si l ' o n r e m a r q u e q u e
ce g a z n e r e n f e r m e
exclure
pas d'azote,
une origine
végétale,
ce q u i
que
semble
parmi
des
en a
pas
c e n t a i n e s d ' a n a l y s e s d e g r i s o u il n ' y
d ' a u t r e s p r é s e n t a n t c e t t e p a r t i c u l a r i t é et q u ' e n f i n
ce g a z p r o v i o n t d ' u n c o m b u s t i b l e d u L i a s e t n o n d u
terrain h o u i l l e r , o n est c o n d u i t à p e n s e r q u e l'on
a aifaire à u n gaz n a t u r e l a n a l o g u e à celui des gisem e n t s de pétrole plutôt q u ' à du véritable grisou.
On p e u t d o n c affirmer q u e j u s q u ' i c i
c a r b u r e d ' h y d r o g è n e e s t le s e u l g a z
le
proto-
combustible
d o n t la p r é s e n c e a i t é t é r e c o n n u e a v e c c e r t i t u d e
d a n s le g r i s o u . S i l ' o n doit, u n j o u r e n
trouver
d ' a u t r e s , i l e s t p e r m i s d e s u p p o s e r q u e ce s e r o n t
s u r t o u t des v a p e u r s des c a r b u r e s l o u r d s , liquides
ou solides, d o n t des traces indosables
pour
expliquer
l'odeur
dégagée
par
suffiraient
certaines
couches de houille.
3. F o r m a t i o n d u g r i s o u . — La houille
pro-
v i e n t d e la d é c o m p o s i t i o n d e s m a t i è r e s v é g é t a l e s
e n f o u i e s à l ' a b r i d e l ' a i r ; le g r i s o u a n é c e s s a i r e m e n t la m ô m e o r i g i n e
première.
Il se t r o u v e a c t u e l l e m e n t t o u t , f o r m é d a n s
h o u i l l e o ù il r e s t e e m p r i s o n n é j u s q u ' a u
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
la
moment
de l'exploitation de cette d e r n i è r e . S a
est c e r t a i n e m e n t
contemporaine
de
formation
celle d e
h o u i l l e d o n t les d e r n i è r e s t r a n s f o r m a t i o n s
la
n'ont
d û s ' a c h e v e r q u ' a p r è s q u e le t e r r a i n h o u i l l e r r e c o u v e r t d ' u n e é p a i s s e u r c o n s i d é r a b l e de morts-terr a i n s a é t é le s i è g e
de variations
de
pression
ou de t e m p é r a t u r e p l u s ou m o i n s considérables.
L ' e x i s t e n c e d ' u n m a n t e a u é p a i s de m a t i è r e s p e santes et imperméables
est indispensable
expliquer l'emprisonnement
sidérables de g r i s o u
des q u a n t i t é s
q u e l'on
retrouve
pour
con-
aujour-
d ' h u i d a n s la h o u i l l e .
La
formation
du
protocarbure
d'hydrogène
d a n s la d é c o m p o s i t i o n des m a t i è r e s v é g é t a l e s est
une
réaction
n o r m a l e ; elle
se p r o d u i t
sous nos yeux
d a n s les m a r a i s
naissance à un
gaz identique
où elle
au grisou.
l a p r o d u c t i o n de ce g a z est a b s o l u m e n t
a u x lois générales
encore
donne
Enfin
conforme
de la c h i m i e . L e s v é g é t a u x
sont des corps instables a n a l o g u e s a u x
explosifs
qui ont absorbé a u x radiations solaires u n excédent d'énergie disponible qu'ils tendent à restituer s p o n t a n é m e n t , m ù r n e en l'absence de l'oxyg è n e nécessaire à l e u r c o m b u s t i o n c o m p l è t e . Cet
é q u i l i b r e définitif, d o n t
chent progressivement
les v é g é t a u x se r a p p r o dans leur
décomposition
à l ' a b r i d e l ' a i r , c o r r e s p o n d a u p a s s a g e d e la t o t a -
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
lilé de l ' o x y g è n e à l'état d'acide c a r b o n i q u e , de
l ' h y d r o g è n e à l'état d e p r o t o c a r b u r e et de l'azote
à l'état d'azote l i b r e . L a h o u i l l e est u n e des étap e s d a n s ce r e t o u r v e r s
l'étal
d'équilibre
stable
q u i est d é f i n i l i v e m e u t a t t e i n t p a r le g r i s o u , m é l a n g é de p r o t o c a r b u r e , acide c a r b o n i q u e et azote.
4. G i s e m e n t d u g r i s o u . — La
question
g i s e m e n t d u g r i s o u a été c o m p l è t e m e n t
p a r les r e c h e r c h e s
expérimentales
du
élucidée
de M.
Lin-
d
d s a y - W o o d ( ) et les é t u d e s t h é o r i q u e s d e M . M a l 2
l a r d ( ) Il r é s u l t e de ces t r a v a u x q u e le g r i s o u e s t
r e n f e r m é d a n s la h o u i l l e et les r o c h e s e n c a i s s a n tes c o m m e l'eau d a n s u n corps p o r e u x et qu'il y est
c o m p r i m é à des pressions parfois considérables.
L ' e x i s t e n c e de ces p r e s s i o n s élevées
reconnue
3
p o u r la p r e m i è r e fois e n D e l g i q u c ( ) a été é t a b l i e
d ' u n e façon définitive p a r les e x p é r i e n c e s
en Angleterre par M.
1881. P o u r procéder
à la
mesure de
ces
sions on a percé au front d e taille d ' u n e
un trou
de sonde
faites
L i n d s a y - V V o o d d e 1879 à
dont
la
profondeur
1
presgalerie
variable
f ) Proceedings
of thcNorth of Engldnd Institute
of
•mining and mcchanical
En gineers. Vol. XXX, i88r,
p. iG3 à
( ) MALI.AIID.— Traduction par extraits du mémoire de
M . Lindsa}-Wood.(ytïntti/(?A- des mines. M a i , Juin ; 1882).
( ) CORNET. — B u l l e t i n de l'Académie
royale de Belgigue. i série, t. XLVJ1, mai 1879.
!
3
c
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
a filLcinL d a n s c e r t a i n s
d e fer
pousse
entouré
d'un
des rondelles
trempées
c a s î.ï m è t r e s .
jusqu'au
fond
garnissage
Un
tube
de, c e t r o u
était
étanche
alternatives
d a n s le c i m e n t q u i
libre
du
tube
fortement
On vissait
soit
un
d e s t i n é à r e c u e i l l i r le g a z e t m e s u r e r
Les pressions
fondeur du
plus élevées q u e
ajutage
son
débit.
ainsi les résultats o b t e n u s :
vont en croissant
trou
sur
manomètre
destiné à la m e s u r e des pressions, s o i l u n
On peut r é s u m e r
avec
d'étoupes
étaient
comprimées l'une contre l'autre.
l'extrémité
obtenu
de b o i s et
de
le
avec la p r o -
s o n d e ; elles sont
charbon
i n o i n s p o r e u x . L e d é b i t de g r i s o u
s u r f a c e de l ' e x t r é m i t é l i b r e
croît a v e c la p r o f o n d e u r
d'autant
est plus
du
par
trou
et v a r i e
compact,
unité
de
de
sonde,
en raison
in-
v e r s e d e l a c o m p a c i t é de l a h o u i l l e .
Les m e s u r e s les p l u s r é g u l i è r e s
t e n u e s à la m i n e d e
profondeur de 3 j o
PrcCondeuL- d u Lrou
Ilarton,
P r e s s i o n par c
2
k
II,
été o b t e Bensham,
mètres.
i:; K,s
ÎS,
ont
couche
/,u
32
•JO,
7
LK CHATELIER — Grisou
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
D é b i t par h o m e e n m^t
par m da la f d î t i o n lillre liu t r o u .
2
n3
0' ,u8t)
O,
I2U
u,
34;
Los pressions les plus
fortes
observées
dans
les a u t r e s m i n e s o n t é t é :
Profondeur
du t r o u
D é s i g n a t i o n de» m i n e s
Mi no Elemorc, couche
Mine Hetton, couche
Mine Kppleton, couche
Mine Baiden. couche
low.Main.
Huttoa.
3 . -A
Huttoa
liens
.
ham.
9·
3,
il)
l'ij
/)U
32,
A
D e s e x p é r i e n c e s s e m b l a b l e s faites p a r l a C o m mission anglaise d u grisou (') en suivant les m é thodes
employées
p a r M. L i n d s a y - W o o d
ont
d o n n é les résultats suivants :
Profonrlpu r
du trou
D é s i g n a t i o n d e s mines
Mine Harris navigation
Mine Mertiiyr Valt?
Ces chiffres n e s o n t
.
IU
Predion
1
II) "-'
1T1
I ,"l
lH
iG
3i
q u e des mini ma ; à u n e
d i s t a n c e p l u s g r a n d e d e la surface libre d u charbon la pression se serait encore élevée d a v a n t a g e .
M.
Mullard
a montré q u e l'on pouvait
simplement rendre
!
f ) Final
pointed
report
to inquire
compte
of her
into
d e cette
Majesty*
accidents
commissionuers
in Mines.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
très
augmentaapp. 2 1 .
tion
progressive
do
lu p r e s s i o n
surface libre d u c h a r b o n
en
à partir de
admettant
gaz i m p r è g n e le c o m b u s t i b l e
que
c o m m e l'eau
la
le
im-
p r è g n e u n e c o u c h e p o r e u s e et q u e s o n é c o u l e m e n t
a u d e h o r s r é s u l t e e x c l u s i v e m e n t de la
différence
de p r e s s i o n e n t r e l ' i n t é r i e u r de la m a s s e et l'extérieur. Le calcul
du grisou dans
m o n t r e alors q u e la repartition
l'intérieur
du
massif de houilla
se fait c o m m e celle de la t e m p é r a t u r e d a n s u n o
m a s s e d e m ô m e f o r m e et s o u m i s e à
des
condi-
t i o n s t h e r m i q u e s q u e l'on o b t i e n d r a i t en r e m p l a ç a n t le c o e f f i c i e n t d e p e r m é a b i l i t é p a r
le
coeffi-
c i e n t d e c o n d u c t i b i l i t é , les p r e s s i o n s p a r les t e m p é r a t u r e s , les p o i d s de gaz p a r les q u a n t i t é s de
chaleur
perdue. Le
tableau
suivant,
a u m é m o i r e d e M- M a l l a r d ,
son
des
résultats du
emprunté
d o n n e la c o m p a r a i -
calcul
et de
l'expérience
p o u r la m i n e E p p l e t o n :
P r a , ;nns
Profondeur
du
trou
ol>ser7ée
i
m
,o;
calculée
3,86
4,2
2, 29
7,
I
!
7>
II,
49
h
l
2°
7,3
i4,3
J3,7
,''1r
I,".,;
ili,3
.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
—
Les expériences de M . L i n d s a y - W o o d
donnent
d o n c la m e i l l e u r e d é m o n s t r a t i o n d e ce fait
l e g r i s o u n ' e s t p a s le r é s u l t a t d ' u n e
que
décomposi-
t i o n a c t u e l l e de la h o u i l l e ; m a i s q u ' i l y e s t s i m plement
contenu
comme
un
gaz
quelconque
dans une matière poreuse.
Cette m a n i è r e
d'être d u
grisou d o n n e immé-
d i a t e m e n t , c o m m e l ' a f a i t r e m a r q u e r M. Milliard,
l'explication des différentes p a r t i c u l a r i t é s de son
gisement.
ne peut
La
être équilibrée
morts-terrains
la raison
pression
considérable
que
par
qui recouvrent
pour laquelle
du
grisou
le p o i d s
des
la h o u i l l e ; c'est
les c o u c h e s t r è s g r i s o u -
tcuses ne se r e n c o n t r e n t j a m a i s q u ' à u n e g r a n d e
p r o f o n d e u r . Q u a n d les a f f l e u r e m e n t s
d ' u n e cou-
c h e r e m o n t e n t j u s q u ' a u j o u r , celle-ci devient
plus en plus p a u v r e en grisou à
mesure
de
qu'elle
s ' é l è v e , p a r c e q u e le g a z v e r s l e s p a r t i e s s u p é r i e u res s'est r é p a n d u d a n s l ' a t m o s p h è r e libre, c o m m e
il le f a i t p e n d a n t l ' e x p l o i t a t i o n d a n s l ' a t m o s p h è r e
des galeries.
D e p l u s , le grisou q u i s'est c e r t a i n e m e n t formé
dans l'intérieur
d e la m a s s e
de houille
n'y
est
p a s r e s t é c o n f i n é , il s ' e s t d i f f u s é d a n s l e s t e r r a i n s
encaissants
en
quantité
variable
suivant
leur
d e g r é de p e r m é a b i l i t é . Il en r é s u l t e q u e , l o r s q u e
la h o u i l l e se t r o u v e a u
voisinage d'une
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
couche
d e g r è s p o r e u s e , le g r i s o u
s'y
accumule
s'il
est
retenu par une couche imperméable supérieure.
Le grès donne alors u n autre
pourra
constituer
un
niveau de gaz qui
réservoir
plus
abondant
q u e la c o u c h e elle-même en
raison
grande
encore, lorsque
porosité. De
h o u i l l e se t r o u v e
même
en communication
de sa
plus
avec
la
une
cavité p r o d u i t e p a r u n e faille o u p a r t o u t e a u t r e
c a u s e , le g r i s o u s ' y a c c u m u l e j u s q u ' à c e q u ' i l a i t
p r i s u n e t e n s i o n égale, à c e l l e q u ' i l possède, d a n s
les t e r r a i n s e n v i r o n n a n t s .
Il résulte, de la p e r m é a b i l i t é i n é g a l e des différentes portions de la c o u c h e , de la p r é s e n c e
de
barres imperméables
de
ou
de failles r e m p l i e s
m a t é r i a u x p l a s t i q u e s , q u e les différents q u a r t i e r s
d ' u n e m ô m e exploitation sont parfois très
iné-
galement grisouteux. Certaines régions pourront
avoir conservé u n e q u a n t i t é considérable de g r i sou tandis q u e des régions voisines a u r o n t laissé
d i f f u s e r a u l o i n t o u t le l e u r .
5 . R e n d e m e n t d u g r i s o u . — L a q u a n t i t é de
grisou que peut dégager u n e quantité donnée de
h o u i l l e soit d i r e c t e m e n t , soit des terrains avoisin a n t s o ù il s'est
accumulé est
nécessairement
très variable. L a formation initiale n'est vraisemb l a b l e m e n t pas la m ô m e p o u r les différentes variétés de houille, de p l u s u n e p r o p o r t i o n p l u s ou
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
m o i n s g r a n d e q u i p e u t aller j u s q u ' à la
totalité
s'est d i s s é m i n é e soit d a n s l ' a t m o s p h è r e , soit à de
grandes
d'où
distances
il n e
peut
d a n s les t e r r a i n s e n c a i s s a n t s
plus
refluer
vers
la m i n e e n
exploitation.
P o u r se faire
grisou,
on
tanément
u n e idée sur cette p r o p o r t i o n de
en
la
est r é d u i t
quantité
lement d'une
h déterminer
de gaz qui sort
m i n e en exploitation
la q u a n t i t é do c h a r b o n
simuljournel-
r é g u l i è r e et
extraite dans
t e m p s . Tiien q u e l a h o u i l l e a i t d e p u i s
le
même
longtemps
d é g a g é la p r e s q u e totalité d e son g a z a u
moment
o ù elle est sortie de la m i n e , o n p e u t
admettre
qu'en
moyenne
la
quantité
de gaz
qu'elle
a
f o u r n i e est. é q u i v a l e n t e à l a q u a n t i t é d e g a z q u i
se d é g a g e d a n s la m i n e
pendant
son
extraction
et q u i p r o v i e n t d u m a s s i f e n c o r e e n p l a c e . Cela
serait
rigoureusement
houille
consistait
en
v r a i si
un
le
gisement
prisme
de
de
charbon,
couché, h o r i z o n t a l e m e n t , de l o n g u e u r i l l i m i t é e e t
parfaitement
homogène.
des
couches,
en
rayonnant,
enfin
de
En
autour
le v o i s i n a g e
de
du
quantité normale
De
l'abandon
plus
veines
trop
l'irrégularité
des
puits
travaux
t è r e n t la
des
fait
développement
du
travaux
d'extraction,
antérieurs
al-
grisou
dégagé.
d a n s la m i n e d e s
menus,
minces pour
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
être
exploitées,
ou
trop
riches
en
cendres
donnent
poids de houille a b a t t u , calculé d'après
pour
le
l'exlrac-
l i o n , u n chiffre b e a u c o u p t r o p faible. De p a r e i l l e s
recherches
théorique
ne
peuvent
donner
une
donc
idée
au
point
bien
de
précise de
vue
la
q u a n t i t é de grisou q u i s'est p r o d u i t e c o n c u r r e m m e n t avec u n poids d o n n é de bouille, m a i s elles
d o n n e n t , ce q u i est s u r t o u t i n t é r e s s a n t n u p o i n t
de v u e p r a t i q u e , u n e idée de l'ordre de g r a n d e u r
des quantités de grisou
gner
l'extraction
d'une
qui
peuvent
quantité
accompa-
donnée
de
bouille.
L a p l u p a r t des r e n s e i g n e m e n t s
que
l'on pos-
s è d e s u r ce s u j e t p r o v i e n n e n t d e s e x p é r i e n c e s e n treprises en v u e de d é t e r m i n e r l'influence des var i a l i o n s b a r o m é t r i q u e s s u r le d é g a g e m e n t du gris o u . U n e s é r i e d ' e x p é r i e n c e s faites p a r les s o i n s d e
l a C o m m i s s i o n p r u s s i e n n e d u g r i s o u e n 1 8 8 5 (*) a
d o n n é les r é s u l t a i s s u i v a n t s , c o m m e n o m b r e
de
(') Versuche
über die allmalige
Entgasung
einer
Bau-Abtheilung
des Schachtes Laiserstuhl
der
Steinhohlenzeche
Ver. Westfalia
bei Dortmund
[Anlagen
zum Haupt bericht der P r e u ß i s c h e n Schlagwetter Commiasion). Yul.IV, p. *2i3et -JI^ et Bericht über
Versuche eintreffend
den Linßuss
des loechsclnden
Luftdruckes auf die Entwickelw>\g
des Grubengases
(Anlagen,
p. SS a g : 3 ) .
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
mètres
cubes de grisou
dégagé
par
tonne
de
houille extraite.
Mi 11B8
V o l u m e île grisou
Kaiserstuhl à Dortjnund
Gemeinschaft /courant II) .
fi
//
.
.
.
.
2
.
._,m:i
3<j
Kl
(Unterwenthhau) .
(courant I) .
fili
li-
Ces n o m b r e s s o n t la m o y e n n e
faites c o n s é c u t i v e m e n t p e n d a n t u n
M. C h e s n e a u ('J a
fait
en
1888
d'observations
mois.
les
observa-
tions suivantes :
Mines d'Anzin, foase Herin, veine Voisin couchant : 3p,
m3
Des expériences entreprises r é c e m m e n t a u x mines de
R o n c h a m p , puits du
Magny, ont dunné
m 3
a5 > p a r tonne de houille.
Il p e u t être i n t é r e s s a n t de r a p p r o c h e r d e celte
q u a n t i t é d e gaz celle q u i reste e n c o r e
emprison-
n é e d a n s les f r a g m e n t s de h o u i l l e a u m o m e n t o ù
ils s o r t e n t de
la
m i n e . Ce g a z s e d é g a g e p e u
à
p e u à l ' a i r et o c c a s i o n n e p a r f o i s d e s a c c i d e n t s s u r
(M CHESNEA'J. — De l'influence des variations de la
pression atmosphérique sur le dégagement du grisou.
(Annales drs Mines. Mai, juin, 1888).
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
les n a v i r e s
fraîchement
où l'on
Les n o m b r e s
travail
a
e m b a r q u é de
la
houille
extraite.
suivants
sont
empruntés
l
de M. de Marsilly ( ) s u r
les
à
un
charbons
belges.
ILlBLrGR
1
P r o v e n a n c e lie. " h o u i l l e s
//
Flénu
D a n s les
expériences
r.ul)RS
p;ir t o n n e dt* bouille
qui ont
I, I
."i
i,(i
7
été citées
plus
h a u t de W . T h o m a s du pays de Galles, les v o l u m e s d e g a z o b t e n u s o n t été :
motrf s cubes
N a t u r e <ten h o u i l l e s
ProveQanua
de
par
Bitumineuse . .
Houille à vapeur
. Mine de Rhondda .
. n deButeMerthyr
//
Anthracite.
Mine de
Danelly
M3
o ,:*K*)0
r,
S,
//
ijaz
tuniirt
epo
:
5
"Watneys
. . . .
L e s trois p r e m i e r s chiffres s e r a i e n t t r o p faibles;
8
{') Annales
des Mines,
fï série t. XIT, p. 3f>7.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
26
NATURE
ET
PRODUCTION
l'extraction était incomplète
DU
GTUSOU
p a r c e q u e le
vide
n ' a v a i t p a s é t é a s s e z p r o l o n g é e t fait à u n e
tem-
p é r a t u r e t r o p b a s s e . L ' a n t h r a c i t e d a n s les m ê m e s
3
1
c o n d i t i o n s n ' a v a i t d o n n é q u e G™ a u l i e u d e 1 8 "
3
11 f a u d r a i t d o n c t r i p l e r e n v i r o n l e s t r o i s p r e m i e r s
chiffres p o u r se r a p p r o c h e r de la r é a l i t é .
On p e u t r a p p e l e r c o m m e t e r m e de c o m p a r a i son q u e les h o u i l l e s à gaz en se d é c o m p o s a n t p a r
la
distillation
dégagent
3oo
I u 3
de g a z .
r e n f e r m e p r è s d e la m o i t i é d e s o n
Ce
volume
gaz
d'hy-
d r o g è n e libre. Son v o l u m e serait r é d u i t à 2 o o
s'il n e s ' é t a i t f o r m é q u e d u p r o t o c a r b u r e
drogène. La mine
d'Ath
de g r i s o u p a r t o n n e soit
Gouley
le j d e
sou renferme donc u n e fraction
drogène des matières végétales
m 3
d'hv-
a donné
Gj™'
1
200 "'. L e
gri-
notable de l'hyqui
ont
donné
n a i s s a n c e à la h o u i l l e .
Dégagement
Le
dégagement
du
normal
grisou
du
est u n
grisou.
—
phénomène
e x t r ê m e m e n t v a r i a b l e ; ici il s u i n t e d ' u n e
façon
u n i f o r m e s u r t o u t e la surface d u c h a r b o n m i s ù
n u , l à il se d é g a g e p l u s a b o n d a m m e n t d e s b a n c s
de schiste o u de g r è s q u i
forment
m u r d e la c o u c h e . D e t e m p s e n
le t o i t
temps
e t le
l'ouver-
ture d'une cavité pleine de grisou d o n n e passage
il u n j e t d e g a z q u e l ' o n a p p e l l e soufflard.
Acci-
dentellement des éboulements considérables
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
du
toit,
ou la p u l v é r i s a t i o n
masses de houille
gements
donne
Instantanés
doutable
danger
spontanée Je
qui constituent
des
grandes
n a i s s a n c e à ces
mines
déga-
le p l u s r e -
d e h o u i l l e , le s e u l
c o n t r e l e q u e l il s o i t i m p o s s i b l e d e s e p r é m u n i r à
coup
sûr.
Toutes
grisou,
ces p a r t i c u l a r i t é s
sont,
conséquence
dégagement
du
c o m m e l'a établi M. Mallard,
la
de
gise-
m e n t . Ce g a z c o m p r i m é s o u s d e s p r e s s i o n s
con-
sidérables
i m m é d i a t e de
du
mode
s'écoule v e r s les p o i n t s
pression avec une
pression
son
initiale
vitesse qui
et
de
la
de
dépend
moindre
et
de
résistance plus
sa
ou
m o i n s g r a n d e q u e lui o p p o s e n t les passages p a r
l e s q u e l s il d o i t
s'écouler.
Le d é g a g e m e n t
normal
duit par suintement
sur
est
celui
tout
q u i se p r o -
le f r o n t d e
taille
d u m a s s i f do h o u i l l e et s u r les surfaces m i s e s à
n u d u toit et d u m u r d e la c o u c h e . Il v a r i e d ' u n i
p o i n t à l'autre s u i v a n t la q u a n t i l é de g r i s o u a c c u m u l é e d a n s les r o c h e s , s u i v a n t
leur
perméa-
b i l i t é e t s u r t o u t s u i v a n t le n o m b r e et l a p r o f o n d e u r des fissures naturelles ou des cassures q u i
t r a v e r s e n t c e s r o c h e r s . Ce d é g a g e m e n t t r è s r a p i d e
n u d é b u t d i m i n u e p r o g r e s s i v e m e n t , si l e s s u r f a ces n e s o n t p a s r e n o u v e l é e s , et finirait
nuler,
en
théorie
au
bout
d'un
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
par s'an-
temps
indé-
fini, en p r a t i q u e a u b o u t d ' u n t e m p s limité m a i s
sans
doute
suppose
plus long
q u e l ' o n n e le
souvent.
Pour
jeure
beaucoup
ce m o t i f
partie du
taille ou
dans
on
a d m e t s o u v e n t q u e la m a -
grisou
son
se
dégage
au
front
q u e l'on a p p e l l e les t r a v a u x n e u f s , q u e
résultant du dégagement
vaux
plus anciens
vis-à-vis
de
v o i s i n a g e i m m é d i a t d a n s ce
est
produit
l'apport
d a n s les
tra-
u n e q u a n t i t é très faible
de la p r e m i è r e .
Mais l'expérience
ne,
s e m b l e pas confirmer cette m a n i è r e de voir.
Il
est
bien
mise à nu
certain
théoriquement
de nouvelles
croissement
que
la
surfaces a m è n e u n ac-
du dégagement
d u grisou par
ces
s u r f a c e s ; m a i s si le d é g a g e m e n t d û à c e s s u r f a ces est faible vis-à-vis de celui d e t o u t le r e s t e de
la
mine,
son
accroissement
ne
représentera
q u ' u n e q u a n t i t é n é g l i g e a b l e . T o u t e s les m e s u r e s
faites s u r le d é g a g e m e n t d u g r i s o u s e m b l e n t i n diquer
que
c'est
bien
ainsi
q u e les
choses
se
p a s s e n t . On n ' a j a m a i s t r o u v é de différence dans
le d é g a g e m e n t d u g r i s o u le m a t i n a v a n t le t r a v a i l
ou l'après-midi
plus
au
m o m e n t de l'exploitation
active ; le d i m a n c h e j o u r
la
de r e p o s o u les
j o u r s d e l a s e m a i n e . Il f a u t q u e l ' e x p l o i t a t i o n s o i t
suspendue pendant plusieurs semaines pour que
le d é g a g e m e n t d u g a z c o m m e n c e à se r a l e n t i r .
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
Voici
quelques
chiffres
empruntés
aux
Ira-
v a u x d e l a C o m m i s s i o n p r u s s i e n n e (') d u g r i s o u
q u i a fait
s u r ce s u j e t
les r e c h e r c h e s
les
plus
élendues q u e l'on possède actuellement.
Le p r e m i e r tableau d o n n e en mètres cubes
la
q u a n t i t é m o y e n n e d e g r i s o u d é g a g é p a r m i n u t e Je
m a t i n a v a n t le t r a v a i l , à m i d i p e n d a n t l e t r a v a i l
et le s o i r a p r è s l a fin d u t r a v a i l . C e s n o m b r e s o n t é t é
déduits des résultats de cinq j o u r s d'observations:
Mines
Mi.ii
Malin
Gemeinschaft (courant II).
II
(Meister).
Ath. Gouley (courant I) .
mJ
0,
N:Î
1,
Ha
Soir
5 ,ifi
")"'\L(i
O.
o,
r,
1
>
Cj").
7-'
«7
71
D ' a p r è s ces chiffres l'influence, de l ' a b a t a g e est
rigoureusement
nulle.
Le d e u x i è m e t a b l e a u d o n n e les r é s u l t a t s c o m p a r é s d e s o b s e r v a t i o n s d u d i m a n c h e et d e s j o u r s
d e la s e m a i n e :
Mines
Ath.. Gouley (courant I)
Oemeinschaft (courant II).
Dimanche
Semaine
4.(7
4.7 ï
i,(ifj
.
.
(') Voir note de la p. a3.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
L'inilucnce du
repos du
dimanche
csl
aur^si
rigoureusement, nulle.
L e 3" t a b l e a u
la q u a n t i t é
d o n n e la q u a n t i t é
de h o u i l l e e x t r a i t s
de grisou et
mensuellement
d ' u n q u a r t i e r d e la m i n e K a i s e r s t u h l
M.'1res MUIICB
Miis
do g)
1 fOU
•>oooo
:
Tonnes
de tioml le
I
o
o
"OLHJO
IiSOiJU
2
'} )(>
Mai
7<ï )
) OO )
l'on
H)
ruoj
T»o
ï ()(K)0
N~o
ItSfï JO
i ' \ o a
IHOÙO
1
^uo
lui e n c o r e d e s v a r i a t i o n s c o n s i d é r a b l e s et l o n g t e m p s prolongées d a n s l'activité de l'exploitation
n ' o n t a m e n é q u e des modifications p e u m a r q u é e s
d a n s le d é g a g e m e n t d u
grisou. Enfin
e x p é r i e n c e s r é c e m m e n t faites
au
dans
des
puits du
Ma-
g n y des m i n e s de R o n c h a m p j ' a i c o n s t a t é q u ' a p r è s
u n m o i s d'arrêt total de l'exploitation
le d é g a g e -
m e n t d u g r i s o u n'était pas t o m b é à m o i t i é de sa
valeur primitive;
m
il s ' é t a i t s e u l e m e n t r é d u i t d e
m
3 \ ( ) p a r m i n u t e à 2 ' , 1.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
Des résultats a n a l o g u e s q u o i q u e
plets
avaient
éLé o b t e n u s
moins
dilTcrenls o b s e r v a t e u r s en
France
terre.
dégagement
La
constance
du
com-
antérieurement
par
et en A n g l e du
gri-
s o u le d i m a n c h e e t l e s j o u r s d o l a s e m a i n e a v a i t
élé r e c o n n u e p a r M. Castcl (') a u x m i n e s de
2
miriy, p a r M.
Chesneau ( ) aux
et p a r M . L i v e i n g ( ' ) à la m i n e
mines
Fir-
d'Anzin
de lîoldon ( A n -
gleterre).
L'ensemble
admettre,
au
de
ces r é s u l t a t s
moins
conduit
p o u r les couches,
donc
à
minces,
le-i s e u l e s q u i a i e n t é t é é t u d i é e s j u s q u ' i c i , q u e l a
quantité supplémentaire de
au m o m e n t
plètement
de
gaz
qui
se
dégage
l'abalage est u n e q u a n t i t é c o m -
négligeable
par
rapport au
dégage-
m e n t t o t a l q u i se p r o d u i t d a n s l ' e n s e m b l e d e l a
mine.
Il e s t i m p o s s i b l e a c t u e l l e m e n t
de
déterminer
l'âge des t r a v a u x q u i j o u e n t le p l u s g r a n d
rôle
d a n s le d é g a g e m e n t d u g r i s o u .
Les v i e u x t r a v a u x c o n t i n u e n t p e n d a n t des ann é e s à d é g a g e r d u g a z ; le d é g a g e m e n t
au
(') Pièces annexées aux procès-verbaux
de la
mission du grisou, i fascicule, pag. i.
(-} Annales des mines, mai, juin r8yy.
( J Fïna report of her ASajestys commissioners,
I [I p. i )i, iS3<).
mètre
Com-
K
H
1
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
Ap.
carré
superficiel
mais comme
est
certainement
très
faible,
le n o m b r e de ces m è t r e s c a r r é s est
é n o r m e , le d é g a g e m e n t t o t a l p e u t d a n s
certains
cas être i m p o r t a n t . D e s expériences faitesau p u i l s
de Magny, m i n e de R o n c h a m p , m ' o n t m o n t r é q u e
des vieux t r a v a u x r e m b l a y é s , âgés de 3 a n s , déga3
g e a i e n t e n c o r e s».!)"' d e g r i s o u p a r h e c t a r e e t
9.4 h e u r e s . L ' o p i n i o n t r è s r é p a n d u e q u i
par
n'attri-
b u e q u ' u n e influence négligeable a u x v i e u x trav a u x , pourrait bien être c o m p l è t e m e n t erronée ;
cela
semble
résulter
de
faites à la m i n e d ' A t h
le g a z s o r t a n t
quelques
observations
G o u l e y (') d a n s
des vieux travaux
laquelle
représenterait
p l u s d e la m o i t i é d u d é g a g e m e n t t o t a l . C'est là,
en
tout
cas, p o u r
question
terait
d'une
la sécurité
importance
des
mines,
capitale qui
une
méri-
d'être s é r i e u s e m e n t étudiée.
7. D é g a g e m e n t s b r u s q u e s . — Les dégagements
anormaux
dislocation
du
brusque
ches encaissantes ne
grisou par
de
la
représentent
q u ' u n e partie m i n i m e du
soufllard,
houille
et
des
ou
ro-
généralement
dégagement
total. Ils
(') BUMINO. — The Pieler lamp, and modes of i n d i cating the presence ot small quantities of fire Damp
in Mines.
(North of England
institute
of Mining
engineers,
vol. XXX, p. i63, 18S0).
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
n'en ont pas moins une importance considérable
au point de v u e de la sécurité parce qu'en raison
d e l e u r i r r é g u l a r i t é , i l e s t d i f f i c i l e d e se p r é m u n i r
contre eux.
Le plus fréquent
des dégagements
est celui q u i se p r o d u i t p a r
anormaux
l e s soiiffiards.
dégagement comprend en général deux
bien distinctes
Ce
périodes
mais d'importance très inégale :
la p r e m i è r e c o r r e s p o n d a n t a u m o m e n t
de
l'ou-
v e r t u r e de la p o c h e où le gaz est r e n f e r m é , d o n n e
lieu à u n
très
rapide
d é g a g e m e n t instantané ou au
résultant
de
la détente
c o m p r i m é ; si c e t t e d é t e n t e
instantanée
c'est
que
n'est
souvent
pas
moins
du
gaz
toujours
la cavité o ù
t r o u v e le g a z est f o r m é e p a r u n s y s t è m e d e
se
fis-
sures du terrain plus ou moins étroites à travers
lesquelles l'écoulement du gaz éprouve u n e
taine résistance.
qui
cette
la s e c o n d e
dégagement
période
cer-
première période
d u r e a u p l u s q u e l q u e s h e u r e s est
commence
un
Quand
terminée,
c o r r e s p o n d a n t à.
moins abondant
du gaz,
mais
q u i se p r o l o n g e t r è s l o n g t e m p s , p a r f o i s u n g r a n d
nombre
d ' a n n é e s ; ce d é g a g e m e n t
est
alimenté
p a r le g r i s o u r e n f e r m é d a n s les t e r r a i n s ( c h a r b o n
o u roche) q u i f o r m e n t les p a r o i s d e la c a v i t é . L e
grisou était p r i m i l i v e m e n t en équilibre de press i o n d a n s la c a v i t é e t l e s t e r r a i n s e n c a i s s a n t s . U n e
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
f o i s cp.tto d e r n i è r e r e v e n u e à l a p r e s s i o n a t m o s phérique,
un
nouvel équilibre
tend
à
s'établir
qui a m è n e l'écoulement d u gaz c o m p r i m é
dans
la paroi d u terrain.
On
conçoit
q u e les i n t e n s i t é s r e l a t i v e s de ces
d e u x périodes d'existence d ' u n soufflard
doivent
être e x t r ê m e m e n t variables. L'ouverture
d'une
poche sphérique donnera un dégagement instant a n é très a b o n d a n t et p r e s q u e rien e n s u i t e à c a u s e
d u faible d é v e l o p p e m e n t des surfaces de s u i n t e ment, au contraire une
étendue ne donnera
fissure
t r è s m i n c e et t r è s
pour ainsi
dire pas de
gagement instantané, mais un dégagement
déulté-
rieur très a b o n d a n t et très l o n g t e m p s
prolongé.
De m ê m e
soufflards
l'importance
absolue
des
varie dans des limites e x t r ê m e m e n t étendues. Au
m o m e n t de l ' a b a t a g e d e la h o u i l l e , les p l u s
pe-
tites fissures m i s e s à j o u r d o n n e r o n t n a i s s a n c e à
des soufflards
minuscules
qui n'auront
qu'une
faible d u r é e d ' e x i s t e n c e et d o n t l e d é b i t se
fondra
a v e c le
suintement
plus
rapide
conde
la
t r a n c h e m i s e à n u . P a r c o n t r e , il e x i s t e d e s s o u f flards g é a n t s d o n t le gaz est parfois assez
abon-
d a n t p o u r ê t r e c a n a l i s é et e m p l o y é à l ' é c l a i r a g e .
Les grands
soufflards
c o r r e s p o n d e n t soit à
failles t r a v e r s a n t u n e forte é p a i s s e u r d u
h o u i l l e r soit k des b a n c s
de
roches
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
des
terrain
fissurés
pa-
rallóles ù u n e c o u c h e do h o u i l l e q u ' i l s d r a i n e n t à
g r a n d e dislance. Les p l u s i m p o r t a n t s ont été obs e r v é s e n A n g l e t e r r e , e n voici q u e l q u e s e x e m p l e s :
E n 1 7 6 J , à la m i n e do W h i t e s h a v e n , u n
souf-
llard a m e n é au j o u r par u n e canalisation eut u n
débit assez c o n s i d é r a b l e p o u r q u ' i l fût
question
de l'utiliser à l'éclairage des r u e s do la ville.
E n i 8 3 o , à la m i n e de W a l l s - E n d , u n soufflard
canalisé j u s q u ' a u j o u r et a l l u m é p o u r se
m3
r a s s e r d u g a z d é b i t a i t 3 ,(i
débar-
p a r m i n u t e . Il conti-
n u a à brûler ainsi pendant plusieurs années.
E n 1860, le c r e u s e m e n t d ' u n p u i t s à l a m i n e d e
C a r s w o o d fut i n t e r r o m p u p a r l e d é g a g e m e n t
énorme
soufllard.
qu'au jour
Après
sa
d'un
canalisation
jus-
i l f u t a l l u m é et b r û l a p e n d a n t
neuf
a n n é e s c o n s é c u t i v e s j u s q u ' à ce q u ' i l fût
p o u r des e x p é r i e n c e s s u r l e s l a m p e s
de
utilisé,
sûreté.
S a f l a m m e se v o y a i t d a n s u n r a y o n de d i x m i l l e s
et éclairait s u f f i s a m m e n t p o u r le t r a v a i l de n u i t .
E n f i n il e x i s t a i t e n 1 8 8 0 , à l a m i n e El w y n y p i u ,
un
soufflard
considérable
q u i , de m ê m e q u e l e
p r é c é d e n t , servait, à l'éclairage et fut u t i l i s é
la C o m m i s s i o n anglaise, d u g r i s o u
par
p o u r des ex-
p é r i e n c e s s u r les l a m p e s de s û r e t é .
Il se d é g a -
g e a i t d a n s le p u i t s à la r e n c o n t r e , d ' u n b a n c d e
g r è s o c c u p a n t le s o m m e t d ' u n e s é r i e de
de c h a r b o n .
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
couches
Un
second
modo
de dégagement
instantané
analogue à certains points de v u e a u x soufilards
mais beaucoup
outburst
plus rare qu'eux
des mines
est le
soufflard e u ce q u e la lissure q u i d o n n e
au
sudden
a n g l a i s e s ('J. I l d i f f è r e d u
passage
g a z a u lieu d e préexister d a n s le lorrain se
produit brusquement
p a r le fait m ê m e
d e l'ex-
ploitation. Ce g e n r e d'accident n'est g u è r e c o n n u
q u ' e n A n g l e t e r r e o ù il d u i t s o n o r i g i n e à l a p r é sence fréquente, a u voisinage des couches exploitées, d e n i v e a u x
g r i s o u l e u x très p e r m é a b l e s s é -
parés p a r des bancs
très d u r s et i m p e r m é a b l e s ,
dont l a r u p t u r e m e t e n c o m m u n i c a t i o n ces niv e a u x a v e c l e s g a l e r i e s d e la m i n e . C e s r u p t u r e s
s o n t facilitées
anglaises
p a r les méthodes
qui n'emploient
d'exploitation
jamais des remblais
rapportés.
Il existe u n e t r o i s i è m e catégorie
ments
instantanés
de
est p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t
réservée. I l s diffèrent
des o u t b u r s t e n ce qu'ils p r o v i e n n e n t
vierge d u charbon et jamais
santes ; ils sont
de
charbons
L
( )
Ac.uiLi.ON
dégage-
a u x q u e l s cette d é n o m i n a t i o n
des roches
accompagnés
menus
d'une
qui viennent
E T PERNOI.IÏT.
d u massif
—
encais-
projection
remplir
exploitation
en
des
mines
à grisou
en Angleterre,
p. fn. (Rapport de
Mission présenté à la Commission française du grisouj.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
p a r t i e les vides en a r r i è r e d u front de taille,
en-
s e v e l i s s a n t p a r f o i s l e s o u v r i e r s q u i n ' o n t p a s le
t e m p s d e se s a u v e r . Ces d é g a g e m e n t s
ont
prin-
c i p a l e m e n t été o b s e r v é s j u s q u ' i c i en B e l g i q u e .
Ils s o n t p l u s rares e n F r a n c e
pourtant
constatés
d'une
où
façon
ils ont
certaine
été
dans
u n e des c o u c h e s d e s m i n e s d e B e s s è g e s ; ils
sont
b e a u c o u p plus rares encore en A n g l e t e r r e . Les dég a g e m e n t s i n s t a n t a n é s de celte n a t u r e se p r o d u i sent toujours e n des p o i n t s o ù la h o u i l l e est très
t e n d r e e t p r é s e n t e la s t r u c t u r e p a r t i c u l i è r e
gnée
s u i v a n t les
houille
la
pays
daloide, danty
désagrégation,
s o u s la p r e s s i o n
cumulé.
En
de
dési-
p a r les t e r m e s « f u s a i n ,
c o a l ». l i s r é s u l t e n t
l'explosion
de la
de
houille
i n t e r n e d u g r i s o u q u i y est ac-
général,
la
variation
de
pression
d a n s le m a s s i f d e h o u i l l e d e p u i s l a s u r f a c e l i b r e
est assez l e n t e p o u r q u e le b l o c d e h o u i l l e p o u s s é
vers l'extérieur par la pression interne présente
d'assez g r a n d e s d i m e n s i o n s p o u r être
en p l a c e p a r
mur.
son adhérence contre
maintenu
le t o i t e t
le
Mais si p o u r u n m o t i f a c c i d e n t e l q u e l c o n -
q u e la z o n e d e p r e s s i o n m a x i m a se r a p p r o c h e de
la s u r f a c e l i b r e l ' é q u i l i b r e p o u r r a ê t r e d é t r u i t et
la masse
de houille
moment,
contact
se b r i s e r a .
A partir de
les t r a n c h e s d u m a s s i f d e
houille
avec l'atmosphère r e n f e r m e r o n t
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
ce
en
du gaz
à u n e p r e s s i o n élevée q u i p o u r r a p r o v o q u e r l'explosion de la houille p a r t o u t
o ù elle ,sera
assez
tendre. Los circonstances qui p e u v e n t produire
ce r a p p r o c h e m e n t d e l a z o n e à f o r t e s p r e s s i o n s
seraient
un
é c r a s e m e n t de la c o u c h e
par
une
pression du toit, u n f e n d i l l e m e n t à g r a n d e p r o fondeur dù à l'emploi des explosifs,
d'un soufllard plein
foration
ment
d'un
trop
trou
rapide
d'une exploitation
l'ouverture
do gaz c o m p r i m é ,
de
du
la
sondage ou un
front
de
taille
per-
avancerésultant
intensive.
Voici q u e l q u e s e x e m p l e s de ces
dégagements
instantanés :
E n B e l g i q u e , les d e u x m i n e s de P A g r a p p e
de Marcinelle sont p a r t i c u l i è r e m e n t c o n n u e s
et
par
l e u r s d é g a g e m e n t s i n s t a n t a n é s . La p r e m i è r e a été
l e 17 a v r i l 1 8 7 9 , le s i è g e d ' u n a c c i d e n t
ble dû à un d é g a g e m e n t
intensité
mémora-
de cette n a t u r e
d'une
t o u t à fait e x c e p t i o n n e l l e . L e
volume
de g r i s o u d é g a g é a été é v a l u é à p l u s de
100000
m è t r e c u b e s et celui de la h o u i l l e p r o j e t é e a été
d e 4ui) t o n n e s . L e g a z v i n t
l'orifice d u
plusieurs
s'allumer
puits d'extraction
heures
en
au
et b r û l a
donnant
une
jour à
pendant
flamme
p l u s de 5o m è t r e s de h a u t e u r . U n g r a n d
de d é g a g e m e n t s
la
même
semblables
de
nombre
s e s o n t p r o d u i t s a.
m i n e , m a i s avec u n e intensité
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
moin-
d r e . L e ag j u i l l e t i 8 6 4 , il se p r o d u i s i t
un
déga-
g e a i e n t a c c o m p a g n é de la projection de i 5 o tonnes
de c h a r b o n
fin q u i
vriers ; trois autres
qui
m ê m e chantier furent
ensevelirent
deux
se t r o u v a i e n t
ou-
dans
a s p h y x i é s p a r le
le
grisou.
D a n s l e s s i x p r e m i e r s m o i s d e l ' a n n é e 1 8 8 0 , 011
releva, à
tantanés
la m ê m e m i n e , h u i t d é g a g e m e n t s i n s bien
caractérisés
dont
le p l u s
impor-
t a n t projeta v i n g t tonnes de c h a r b o n .
L'importance
dégagements
r e l a t i v e de ces trois
instantanés
est très
modes
de
inégale.
Les
soufflards o u c a s s u r e s sont d e b e a u c o u p les
plus
f r é q u e n t s ; il n ' y a p a s d e m i n e s o ù
il n e s ' e n
r e n c o n t r e de t e m p s en t e m p s g r a n d s o u p e t i t s ;
ils font
presque partie du dégagement
normal
du grisou. Les dégagements instantanés proprement
dits
charbon
accompagnés
sont beaucoup
de
plus
pulvérisation
r a r e s ; ils
ne
du
se
p r o d u i s e n t q u ' e n des points particuliers de c o u c h e s d e h o u i l l e d é t e r m i n é e s et t o u j o u r s
les
mê-
m e s ; ils n e s o n t à c r a i n d r e q u e p e n d a n t les t r a v a u x de t r a ç a g e . E n f i n les s u d d e n o u t b u r s t p l u s
r a r e s e n c o r e n e se p r o d u i s e n t c o m m e les
dents que
dans
certaines couches
précé-
particulières
possédant dans leur voisinage des niveaux grisouteux abondants
trairement
et très p e r m é a b l e s ; m a i s , c o n -
à ces d e r n i e r s , ils n e se p r o d u i s e n t
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
q u e d a n s les t r a v a u x de d é p i l a g e . Ces d e u x
niers modes de dégagement sont
der-
heureusement
b e a u c o u p p l u s r a r e s q u e t e n d r a i e n t à le faire c r o i r e
certaines statistiques qui rapportent a u x dégagements instantanés
tous
les accidents de
grisou
d o n t la c a u s e i m m é d i a t e n ' a p u être é t a b l i e .
8.
Influences
météorologiques
dégagement de grisou.
—
On
sur
a cherché
diverses reprises à établir u n e relation
variations
de la pression
rapidité du
entre
atmosphérique
dégagement du grisou. La
lité d'une semblable influence
est e n
et
le
à
les
la
possibi-
contradic-
t i o n a v e c les lois p h y s i q u e s les m i e u x é t a b l i e s ;
u n e variation de pression de q u e l q u e s centièmes
aucune
influence
appréciable sur l'écoulement d ' u n gaz
d'atmosphère
ne
peut avoir
comprimé
primitivement à plusieurs dizaines
d'atmosphè-
res. P o u r soutenir l'exactitude des o p i n i o n s émises au sujet de l'influence
des variations
métriques,
moins
il
observations
faudrait
au
baro-
apporter
des
p r é c i s e s et n o m b r e u s e s t a n d i s q u e
l'on n'a j a m a i s p u i n v o q u e r q u e des on-dit p l u s
o u m o i n s v a g u e s . T o u t e s les o b s e r v a t i o n s p r é c i ses faites s u r
ce s u j e t et e n p a r t i c u l i e r
les
re-
c h e r c h e s récentes de la C o m m i s s i o n a u t r i c h i e n n e
du
grisou
ont
au
contraire
d'aucune influence semblable.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
montré
l'absence
P o u r c o m p r e n d r e le crédit d o n t a j o u i la théor i e d u b a r o m è t r e , il f a u t s o n g e r à l ' e x i s t e n c e d e
certains facteurs d'ordre
voir
avec
l'exactitude
m o r a l qui n'ont rien à
scientifique.
directeur de m i n e s après u n
Lorsqu'un
accident est
suivi d e v a n t les t r i b u n a u x et q u ' i l
pour-
croit, à tort
o u à r a i s o n , n ' a v o i r r i e n à se r e p r o c h e r , il
cher-
c h e n a t u r e l l e m e n t à e x p l i q u e r l'accident soit p a r
l ' i m p r u d e n c e d ' u n d e ses o u v r i e r s , soit p a r
tervention
d'une
cause
naturelle
dont
puisse être responsable. Le baromètre
l'in-
il
ne
évidem-
m e n t offre p o u r c e t u s a g e t o u t e s l e s q u a l i t é s
dé-
s i r a b l e s . C'est p o u r ce m o t i f q u e p e n d a n t u n c e r tain
temps
tous
les
accidents furent
attribués
a u x i n f l u e n c e s a t m o s p h é r i q u e s . U n e fois la t h é o rie d u b a r o m è t r e trop d é m o d é e
pour
être
utile-
m e n t mise en a v a n t , on eut recours à l ' i n t e r v e n t i o n d e s p o u s s i è r e s . A u j o u r d ' h u i ce s o n t les
gagements instantanés
sières et b a r o m è t r e
en
dé-
qui ont remplacé pousattendant
qu'ils
soient
remplacés à leur tour par une autre cause irresp o n s a b l e a p r è s a v o i r été usés p a r u n e m p l o i t r o p
abusif. Il est b i e n
certain que
les
dégagements
i n s t a n t a n é s existent et ont causé des accidents,
m a i s ils s o n t h e u r e u s e m e n t fort r a r e s , d e
même
les v a r i a t i o n s b a r o m é t r i q u e s p e u v e n t avoir
influence
sinon
sur
le d é g a g e m e n t d u
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
une
grisou,
au moins
sur
son
cette influence
mode d'accumulation,
môme
dans
mais
ce d e r n i e r c a s ,
qui
n ' e s t p a s e n v i s a g é ici, est t o u j o u r s très faible.
9. A c c u m u l a t i o n
du
g r i s o u . — L e grisou,
u n e fois d é g a g é d e la h o u i l l e n ' e s t p a s i m m é d i a t e m e n t e n t r a î n é e n d e h o r s d e l a m i n e , il y
cir-
c u l e n é c e s s a i r e m e n t p e n d a n t u n c e r t a i n t e m p s et
p e u t m ô m e s ' a c c u m u l e r e n c e r t a i n s p o i n t s o ù il
ne circule p l u s ou du m o i n s
lentement.
Ces
n e le fait q u e
accumulations
p r é p o n d é r a n t dans la p l u p a r t
jouent
très
un
rûle
des accidents de
g r i s o u ; les d é g a g e m e n t s i n s t a n t a n é s m i s à p a r t ,
il e s t t o u j o u r s p o s s i b l e d e f a i r e a r r i v e r
dans
m i n e u n e q u a n t i t é d'air assez c o n s i d é r a b l e
la
pour
q u e , u n i f o r m é m e n t m ê l é au g r i s o u , il lui e n l è v e
la possibilité
de
b r û l e r . M a i s il n ' e s t p a s
j o u r s facile d e r é a l i s e r ce m é l a n g e d ' u n e
toufaçon
c o n v e n a b l e d a n s t o u t e l ' é t e n d u e d e l a m i n e , e t il
arrive qu'eu
gage
qu'en
c e r t a i n s p o i n t s o ù le g r i s o u se d é -
régulièrement
quantité
serves de
tandis
insuffisante,
que
l'air
n'arrive
il se f o r m e d e s
ré-
m é l a n g e explosif auxquelles la m o i n -
dre imprudence
pourra
communiquer
le
feu.
11 n e f a u t p a s o u b l i e r d ' a i l l e u r s q u ' u n p u i t s t r è s
grisouloux
peut
dégager jusqu'à
îoooo
mètres
c u b e s d e g r i s o u p a r i\ h e u r e s e t q u ' i l s u f f i t d ' u n e
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
ACCUMULATION DU
43
GHlSOU
a c c u m u l a t i o n d e 10 m è t r e s c u b e s d e c e g a z p o u r
amener une explosion épouvantable.
L e s c o n d i t i o n s les p l u s h a b i t u e l l e s d a n s l e s q u e l les les a c c u m u l a t i o n s
de g r i s o u
se
produisent
seront étudiées en traitant des m o y e n s à e m p l o y e r
p o u r p r é v e n i r les a c c i d e n t s . T a n d i s q u e le d é g a g e m e n t d u grisou est u n e fatalité qu'il faut accepter,
son
accumulation
quantité un peu
résultat
exclusif
locale dans
la m i n e on
i m p o r t a n t e est au contraire
des
méthodes
employées, c'est-à-dire que dans u n e m i n e
t e n u e , il se d é g a g e a u t a n t
bien
de grisou q u e dans
u n e m i n e m a l dirigée, m a i s d a n s la p r e m i è r e
grisou
reste invisible
le
d'exploitation
et est inoffensif.
le
C'est la
n a t u r e q u i p r o d u i t le d é g a g e m e n t d u g r i s o u , m a i s
c'est la v o l o n t é o u p l u t ô t la n é g l i g e n c e
humaine
q u i p r o d u i t son a c c u m u l a t i o n d a n s la m i n e .
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
CHAPITRE
PHOPHIKTÉS
DU
IT
GRISOU
10. P r o p r i é t é s p h y s i q u e s .
tés
—
Les
proprié-
d u g r i s o u sont celles d u p r o t o c a r b u r e
drogène
d o n t il n e d i f f è r e
d'hy-
p a s , ainsi q u e cela a
été établi au d é b u t de cette é t u d e .
Le poids spécifique ou poids
du
a o° e t 760 m i l l i m è t r e s e s t d e o
Le grisou
est u n
B r
litre
gaz p e r m a n e n t ,
c'est-à-dire
q u i n e p e u t p r e n d r e l'état l i q u i d e à la
ture
ordinaire,
élevées.
Son
même
point
sous
critique
mesuré
,-i7.
tempéra-
des
pressions
est
en
effet
très
situé
d ' a p r è s les e x p é r i e n c e s de D e w a r à u n e t e m p é r a ture de —
100
0
et c o r r e s p o n d à u n e pression de
5u a t m o s p h è r e s .
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
Ce gaz est p e u s o l u b l e d a n s l'eau q u i en d i s s o u t s e u l e m e n t à la t e m p é r a t u r e
ordinaire
un
v o l u m e d e 35 c e n t i m è t r e s c u b e s p a r litre. L e v o -
sous l a p r e s sion q u ' i l s u p p o r t e au m o m e n t d e s a d i s s o l u l u m e du g a z est s u p p o s é m e s u r é
tion.
Le grisou
est i n c o l o r e et p a s s e g é n é r a l e m e n t
pour inodore ; dans quelques mines
comme
celle de
cependant
l l o n c h a m p , il p r é s e n t e u n e l é -
g è r e o d e u r é t h é r é e , d u e p e u t - ê t r e à la p r é s e n c e
d ' i m p u r e t é s , q u i s u f f i t p o u r l e faire r e c o n n a î t r e ,
dès q u e sa p r o p o r t i o n d a n s
l'air e s t u n p e u
no-
table.
II n e p o s s è d e a u c u n e p r o p r i é t é t o x i q u e ; m ê l é
en
grande quantité
l'asphyxie,
excès d'azote en
gène.
à l'air i l
peut
provoquer
mais s e u l e m e n t c o m m e le f e r a i t u n
diluant trop fortement
l'oxy-
.
1 1 . P r o p r i é t é s c h i m i q u e s . — E n dehors de
sa c o m b i n a i s o n
avec l'oxygène
ou
combustion
q u i f e r a l ' o b j e t d ' u n e é t u d e d é t a i l l é e , le g r i s o u
ne se c o m b i n e g u è r e d i r e c t e m e n t q u ' a u
et a u
brome
substitution
l'acide
en
donnant
: chlorure
chlorhydrique
comme pour l'oxygène,
soit
chlore
des produits de
de m é t h y l e , e t c . , soit d e
et
du
charbon.
Mais,
cette réaction doit être
p r o v o q u é e p a r u n e élévation de t e m p é r a t u r e
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
ou
t o u t au m o i n s d a n s le cas d u chlore par
de
la
lumière.
Le
protocarbure
l'action
d'hydrogène
c o m m e t o u s les c a r b u r e s
saturés manifeste
peu de tendance à entrer
en réaction
d'où
le n o m
d e paraffines
très
chimique,
q u e l'on d o n n e sou-
v e n t à cette catégorie de c o r p s . C'est en raison de
cette absence d'affinité c h i m i q u e q u e toutes
les
tentatives faites p o u r t r o u v e r des a b s o r b a n t s
du
g r i s o u o n t é c h o u é e t il p a r a i t à p e u p r è s
sible q u e de nouvelles
tentatives
impos-
d a n s la m ê m e
voie aboutissent j a m a i s .
12. C o m b u s t i o n d u grisou. —
La
combus-
tion complète d u p r o t o c a r b u r e d ' h y d r o g è n e
exige
d e u x fois s o n v o l u m e d ' o x y g è n e e t p a r s u i t e
fois s o n v o l u m e
Poids
Volumes
dix
d'air
r
i(i>.'
aa'i'v'ia
6'|i?
r
r
p
4^K
3l>b'
aaUlyVa ,\ -,(>',
f
La combustion, l'eau restant
sans c h a n g e m e n t de v o l u m e .
Vit
g a z e u s e , se
A p r è s la
fait
conden-
s a t i o n de l'eau la c o n t r a c t i o n est é g a l e a u d o u b l e
du v o l u m e du gaz c o m b u s t i b l e .
La
quantité
de
chaleur
dégagée
dans
réaction, rapportée au poids moléculaire du
soit
cette
gaz
e s t de, 18R g r a n d e s c a l o r i e s .
Les t e m p é r a t u r e s de c o m b u s t i o n
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
du
mélange
d'air et d e g r i s o u d a n s les p r o p o r t i o n s
voulues
p o u r la c o m b u s t i o n totale sont :
A
volume
constant
A
pression
•JI">O°
Les
pressions
combustion
constante
iH:')o°
absolues
développées
par
la
e n vase clos des m é l a n g e s en pro-
p o r t i o n variable d'air et de grisou sont
d'après
les e x p é r i e n c e s de M M . M a l l a r d et L e C b a t c l i e r les
suivantes :
2
4
Proportion d e C H sur)
,
,
.,
6ioo vol. de mélange. \ "
-,q 0,(3
'
•"
IO
ri,.5
II
;
Pression en k i l o g r . .1 G,t)j 8, | 8,çp y,oji 8,8 8.T1
13. T e m p é r a t u r e d'inflammation, — La
température
d'inflammation
du
grisou
a
été
t r o u v é e p a r M M . M a l l a r d et L e C h a t e l i e r de 6 5 o ° .
A u x t e m p é r a t u r e s plus basses à partir de 4 5 ° " ,
il
commence
à
se
lente sans
flamme
suivant la
nature
produire
une
combustion
q u i est p l u s ou m o i n s
de l'état p h y s i q u e
active
du
corps
a u contact du m é l a n g e gazeux. Les corps poreux,
la m o u s s e de p a l l a d i u m particulièrement,
acti-
vent
peu-
beaucoup
celte
combustion
l e n t e et
0
v e n t la r e n d r e sensible dès 2 0 0 . Mais l ' i n f l a m m a tion du grisou présente u n e particularité capitale
q u i n e s e m b l e p a s se r e t r o u v e r c h e z l e s
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
autres
gaz combustibles, au moins à u n degré
rable.
Tandis
l'hydrogène,
aussitôt
que
mélanges
l'oxyde de carbone
qu'ils
convenable,
les
sont
portés
à
compa-
formés
par
s'enflamment
la
température
c e u x d a n s l e s q u e l s le p r o t o c a r b u r e
d ' h y d r o g è n e est l ' é l é m e n t c o m b u s t i b l e
n'entrent
au contraire en c o m b u s t i o n
vive q u e
lorsqu'ils
o n t été m a i n t e n u s p e n d a n t
un
certain
nombre
do secondes à u n e t e m p é r a t u r e égale ou
rieure
à leur température
retard à l'inflammation
supé-
d'inflammation.
peut
Ce
s'élever à u n e di-
z a i n e d e s e c o n d e s a u x e n v i r o n s de 65o°. Il d i m i n u e à m e s u r e q u e s'accroît la t e m p é r a t u r e à
quelle
on
p o r t e les gaz et n ' a t t e i n t
plus
laune
seconde à iooo°.
L ' i n f l a m m a t i o n du grisou dépend d o n c de d e u x
facteurs
d i s t i n c t s , la
température
et le
temps
d'échauiïementdonl chacun doitètred'autantplus
c o n s i d é r a b l e q u e l ' a u t r e est p l u s
faible.
14. Limites d'inflammabilité.
— Les
mé-
q u e l c o n q u e chauffés
dans
l e u r t o t a l i t é à C3o° b r û l e n t c o m p l è t e m e n t ;
mais
langes en proportion
d a n s les c o n d i t i o n s h a b i t u e l l e s
d'inflammation,
le m é l a n g e g a z e u x e s t a la t e m p é r a t u r e
et u n e
ordinaire
région l i m i t é e e s t s e u l e é c h a u f f é e p u r l a
source de c h a l e u r e m p l o y é e p o u r p r o v o q u e r l'inflammation..
On dit alors q u e le m é l a n g e est in-
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
flammable
ou non
suivant que
p o r t é e ainsi en u n
l'inflammation
p o i n t , se p r o p a g e
de p r o c h e
e n p r o c h e d a n s t o u t e la m a s s e ou s'éteint.
L e s s e u l s m é l a n g e s i n f l a m m a b l e s de g r i s o u et
d'air sont ceux
dans
gaz inflammable
lesquels
sur
la p r o p o r t i o n
de
i o n de m é l a n g e est com-
prise entre :
6 Vo
L'élévation
^
préalable
16 ·/„
de
température
m a s s e g a z e u s e é t e n d les l i m i t e s
0
j u s q u ' à fi:")!) o ù t o u s
de
la
d'inflammabilité
les m é l a n g e s d o i v e n t
être
combustibles.
15. V i t e s s e d e p r o p a g a t i o n d e la f l a m m e .
— L ' i n f l a m m a t i o n p r o v o q u é e en u n p o i n t
d'un
m é l a n g e g a z e u x c o m b u s t i b l e se p r o p a g e a v e c u n e
v i t e s s e q u i d é p e n d d'uii g r a n d n o m b r e d e c o n d i t i o n s d i f f é r e n t e s : proportion
ou agitation
du mélange
du
voisinage
mélange,
La Commission
des gaz
môles,
gazeux,de corps
solides
froids.
française d u grisou
s ' e s t ef-
forcée, par de n o m b r e u s e s expériences, de
tre en évidence
constances,
repos
température
l'influence
a u x q u e l l e s est
met-
d e ces d i v e r s e s ciri n t i m e m e n t lié
le
d e g r é d e s é c u r i t é p r o c u r é p a r les l a m p e s .
La vitesse de p r o p a g a t i o n varie d'abord
lu proportion
de
grisou
contenue
d a n s le
avec
mé-
lange ; sensiblement nulle aux deux limites exc
LK CHATKIIKR — G r i o u
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
4
t r è m e s rie c o m b u s t i b i l i t é , e l l e p a s s e p a r u n
x i m u m qui ne correspond pas c o m m e on
pu
le p e n s e r ,
plète,
mais
au
bien
mélange à
à un
ma
aurait
combustion
com-
mélange renfermant
un
certain excès de gaz c o m b u s t i b l e . L a vitesse
la
m
p l u s g r a n d e observée a été de o , 6 o p a r seconde.
2
;
Proportion de C I I flans]
,
,
.,
¡6
ioo vol. de melange .)
l'i
io
8
ii
*
iG
Vitesse en mètres. . .1 o,0f 0,9.2 0,42 o.fio o,?>- o,o>S
D a n s les m é l a n g e s à e x c è s d ' o x v g è n e la s u b s titution
d'azote
à
l'oxygène
q u i est en
sus
c e l u i n é c e s s a i r e à la c o m b u s t i o n
n'altère pas
vitesse de propagation ; l'acide
carbonique
de
la
au
contraire abaisse n o t a b l e m e n t cette vitesse.
L e s chiffres p r é c é d e n t s s ' a p p l i q u e n t à des m é langes en
repos, les vitesses
t o u t a u t o u t p a r ['agitation
sont changées
d e la m a s s e
du
gazeuse
en c o m b u s t i o n . Les m é l a n g e s les p l u s lents p e u v e n t d o n n e r lieu à des p r o p a g a t i o n s
dire
instantanées,
explosions,
quand
l'inflammation
c'est-à-dire
pour
n. d e
ainsi
véritables
on provoque au m o m e n t
de
u n e a g i t a t i o n très vive, telle q u e
celle q u e l'on obtient en faisant
dégager au
mi-
lieu d ' u n e m a s s e gazeuse en repos u n jet de
gaz
animé d'une
grande
vitesse. C'est
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
là
I'explica-
tion d e la p r o d u c t i o n
des explosions
de
grisou
d a n s les m i n e s . Si la v i t e s s e de p r o p a g a t i o n
dépassait
jamais
m
o ,Go,
l e s effets
ne
mécaniques
s e r a i e n t t o u j o u r s n u l s et les o u v r i e r s
pourraient
se s a u v e r d e v a n t l a f l a m m e .
précises
sur
l e s v i t e s s e s q u i p e u v p n t a i n b i se d é v e l o p p e r .
Il n ' a p a s é t é fait d ' e x p é r i e n c e s
On
sait s e u l e m e n t q u ' a u laboratoire, dans des petits
t u b e s d e o'",o3 d e d i a m è t r e et i m è t r e s de
gueur on peut obtenir
à
20
mètres
centaines de
tesses
par
des vitesses
seconde.
mètres qu'il
C'est
faut
lon-
supérieures
peut-être
par
c o m p t e r les vi-
e x t r ê m e s réalisables d a n s les
explosions
de g r i s o u .
L'agitation
s p o n t a n é e de la masse gazeuse en
combustion n'est pas u n
phénomène
exception-
n e l , c'est a u c o n t r a i r e la r è g l e . P o u r éviter
seu-
l e m e n t p a r t i e l l e m e n t sa p r o d u c t i o n d a n s les
ex-
périences
de
laboratoire,
il
faut
p r e n d r e des
précautions toutes spéciales.
16. E n r e g i s t r e m e n t des vitesses de combustion. —
sente
la
Toutes
les p a r t i c u l a r i t é s q u e
combustion
des
mélanges
p e u v e n t a v e c le g r i s o u être observées à la
s i m p l e , c'est-à-dire d ' u n e façon p u r e m e n t
tative ; les m e s u r e s
précises sont
vue
quali-
impossibles.
M a i s il e x i s t e u n m é l a n g e c o m b u s t i b l e , c e l u i
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
pré-
gazeux
de
sulfure
do c a r b o n e et de
bioxyde
d'azote
qui,
g r â c e a u x p r o p r i é t é s p h o t o g é n i q u e s de sa
flamme,
permet
de
l'enregistrement
propagation
d e cette
photographique
flamme.
Les
la
phénomènes
s o n t t o u t à fait s e m b l a b l e s à c e u x d u m é l a n g e d e
r\ .
s
grisou
1
et d ' a i r avec cette s e u l e différence
qu'ils
p e u v e n t donner parfois naissance à l'onde explosive, m a i s assez
Les
fig.
difficilement.
1, 2 et 3 s o n t les r e p r o d u c t i o n s
photographies
obtenues
zeux. Le tube parcouru
avec
p a r la
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
ce m é l a n g e
flamme
de
ga-
est p r o -
jeté a u m o y e n d ' u n objectif p h o t o g r a p h i q u e suivant
la
génératrice
d'un
cylindre
recouvert d'un papier sensible au
m u r e . Les ordonnées
les
chemins
des figures
parcourus
par
la
tournant
gélatino-broreprésentent
flamme
et les
abeisses, les t e m p s .
L a fig. i r e p r é s e n t e l a c o m b u s t i o n d a n s u n t u b e
de 3 m è t r e s
de longueur, l'inflammation
étant
F.-, a
il
1
„ •.•» » - "I"' """
"*^*
nHT
ÉCHELLE DES TEMPS
portée
près de la partie o u v e r t e .
la vitesse d'abord
On
voit
m
u n i f o r m e et égale à i , 5 o
que
par
seconde s'accroît r a p i d e m e n t à m e s u r e q u e l'amplitude des m o u v e m e n t s vibratoires a u g m e n t e .
La
fig.
i r e p r é s e n t e la m ê m e
expérience ré-
pétée d a n s u n tube de 1 c e n t i m è t r e de
et
de m ê m e
flamme
s'est
longueur
éteinte
que
après
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
diamètre
précédemment.
avoir
parcouru
La
le
p r e m i e r tiers d u t u b e , q u a n d le m o u v e m e n t v i bratoire eut
pris une intensité convenable.
première extinction
presque cumplète,
Une
puisque
Fi». 3
ECHELLE
DES T E M P S
*
l ' i m p r e s s i o n p h o t o g r a p h i q u e s cessé m o m e n t a n é m e n t , s'était p r o d u i t e u n p e u a u p a r a v a n t à la s u i t e
d ' u n e p r e m i è r e p é r i o d e de g r a n d e s v i b r a t i o n s .
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
L a fïg.
3 r e p r é s e n t e la p r o p a g a t i o n de la c o m -
b u s t i o n d a n s le c a s o ù l ' i n f l a m m a t i o n e s t p o r t é e
contre l'extrémité
fermée d n tube. On voit i m -
médiatement l'accélération é n o r m e q u e prend la
de
la
c o u r b e q u i a c e p e n d a n t été o b t e n u e , c o m m e
flamme
p a r le r e d r e s s e m e n t
très rapide
le
m o n t r e l'échelle des t e m p s , avec u n e vitesse de
déroulement du
papier
sensible
cinq
fois
plus
g r a n d e q u e d a n s les e x p é r i e n c e s p r é c é d e n t e s . L a
vitesse
atteinte
flamme
d u t u b e a été voisine d e 4 o o mètres p a r
au
moment
seconde, q u a n d la vitesse
de la sortie de la
normale n'est
cepen-
dant q u e de î ^ S o par seconde.
17. Influence des parois
froides.
—
Les
c o r p s froids tels q u e les p a r o i s des t u b e s e x e r c e n t
u n e très g r a n d e influence s u r la p r o p a g a t i o n
flammes.
Celles-ci s'éteignent j u s q u ' à
des
u n e cer-
t a i n e d i s l a n c e d e l a p a r o i , t r è s p e t i t e il e s t v r a i ,
par suite du refroidissement qu'elles
En
regardant
sous
éprouvent.
une incidence rasante
surface plane frappée p a r u n e flamme, on
ç o i t u n e z o n e s o m b r e o ù il n e s e p r o d u i t
combustion.
Ce f a i t
signalé depuis
une
aper-
aucune
longtemps
a v a i t fait d i r e q u e les c o r p s froids r e p o u s s e n t l e s
flammes.
L ' é p a i s s e u r de cette z o n e est d ' a u t a n t
plus considérable
plus près
que
le
mélange
gazeux
est
de sa l i m i t e de c o m b u s t i b i l i t é ; elle
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
peut atteindre
dans
certains cas
Cette influence refroidissante
1
millimètre.
se fait s e n t i r é g a -
l e m e n t d a n s la p a r t i e d u m é l a n g e où la c o m b u s tion
est encore
abaissée
possible;
d'autant
la t e m p é r a t u r e y
plus que
l'on
se
d a v a n t a g e de la r é g i o n s a n s c o m b u s t i o n ;
cette influence décroît
est
rapproche
mais
très r a p i d e m e n t avec
la
d i s t a n c e , de telle sorte q u ' à d e u x c e n t i m è t r e s de
la p a r o i , m ô m e d a n s les m é l a n g e s les p l u s p a u vres, l'influence refroidissante devient négligeab l e e t la v i t e s s e d e p r o p a g a t i o n y c o n s e r v e e n c o r e
sa v a l e u r n o r m a l e . D a n s les t u b e s d e c i n q c e n t i m è t r e s do d i a m è t r e , l a p r o p a g a t i o n d e l a f l a m m e s e
fiiit p o u r les m é l a n g e s d e g r i s o u d a n s l e s m ê m e s
c o n d i t i o n s q u e si la s e c t i o n l i b r e d u t u b e é t a i t indéfinie. D a n s les t u b e s p l u s étroits la vitesse norm a l e d e p r o p a g a t i o n est r a l e n t i e e t finit m ê m e p a r
s ' a n n u l e r a v e c e x t i n c t i o n d e la f l a m m e p o u r d e s
diamètres suffisamment petits.
Les
expériences
s u r le m é l a n g e d e g r i s o u et d ' a i r à 11 ° /
0
de gaz
c o m b u s t i b l e o n t d o n n é les r é s u l t a t s s u i v a n t s :
I
Diamètre du tube en)
.
I :io
millimètres
)
Vitesse de propagation)
....
,,
en mètres
>
)
oSiO
^
. .
, ,
ia,a (j,.ï H .1,.» .},'-*
1
0,4"
1J
I
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
V.'il
1
U.,5li
J
0,2'iO,U
m
A v e c le d i a m è t r e d e 3"' ,2 la f l a m m e p é n è t r e d e
,'5u m i l l i m è t r e s a v a n t d e s ' é t e i n d r e l o r s q u e le g a z
est a u r e p o s . S'il
est
animé
d'une
certaine
tesse d e t r a n s l a t i o n , la p é n é t r a t i o n de la
est
accrue
ou
diminuée
suivant
le
vi-
flamme
sens
du
mouvement.
Q u a n d o n d i m i n u e p l u s e n c o r e le d i a m è t r e d e s
t u b e s , la l o n g u e u r de p é n é t r a t i o n d e la f l a m m e
d i m i n u e et finit m ê m e
par
s'annuler avant
que
le d i a m è t r e d u t u b e d e v i e n n e l u i - m ê m e n u l . C e l a
t i e n t à ce q u e la f l a m m e , s ' a r r è t a n t à u n e c e r t a i n e
d i s t a n c e d e la s u r f a c e d e s c o r p s f r o i d s , la p o i n t e
F.g. 4
d u p e t i t c ô n e q u i se f o r m e d e v a n t u n e o u v e r t u r e
percée dans u n e paroi mince, peut ne pas atteind r e l a s u r f a c e e l l e - m ê m e {fig.
C'est en s ' a p p u y a n t
phénomènes que Davy
4)·
sur l'observation
de
ces
fut c o n d u i t à la d é c o u -
verte des l a m p e s de s û r e t é à treillis
métallique.
18. P r o p r i é t é s des toiles métalliques. —
Les propriétés
mises
reté,
en
des toiles m é t a l l i q u e s , q u i
oeuvre d a n s
découlent
sont
t o u t e s les l a m p e s de s û -
immédiatement
de
celles
des
t u b e s . L e s t o i l e s p e u v e n t e n effet ê t r e c o n s i d é r é e s
comme une agrégation d'un
grand
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
nombre
de
petits tubes juxtaposés
diamètre
seraient
dont
la l o n g u e u r
très faibles.
Les
e t le
principales
d i m e n s i o n s d e s toiles m é t a l l i q u e s e m p l o y é e s p o u r
la c o n s t r u c t i o n
des l a m p e s de sûreté sont résu-
m é e s d a n s le t a b l e a u s u i v a n t :
N o m b r e de
m a i l l e s au
centimètre
carre
Diflurentes e s p è c e s
rie l a m p e s
Diminuire d e s D i a m e t r o dus
lila en
maillae e n
m iLlimètres
millimetres
D i m e n s i o n s d o n n é e s pai
0,.">(j
D a ? y aux t o i l e s de KR
oli',
( i, '* 7
Anciennr-s "ampes D a v v ,
du G a r d et de
Saint
o , ->.">
Anciennes lampes
Davy
du fîaril fit du P a s - d e 0,*i 1
La m po
Davy
r
(i,. ).i
du Cou
c h a n t de MUHH ^Bal0.',',
tique)
D i m e n s i o n s d o n n é e s par
M u t î s e l r r fi .«a l a m p H .
Lampe
O,:Ì:Ì
MnB=ol6r r é g i e
mpntiiii'e
en B e l g i q u e
d e p u i s ISril .
.
.
o,ï8
Ü,
.
196
Jfj
0,2.")
Les dimensions adoptées aujourd'hui en France
p o u r les l a m p e s d e s û r e t é o u t o u t
au moins re-
c o m m a n d é e s p a r l ' a d m i n i s t r a t i o n , sont celles d e
l a l a m p e M u e s c l e r b e l g e , s o i t 144 m a i l l e s a u c e n 1
1
t i m è t r e c a r r é a v e c u n fil d e o" " ,;};}. M a i s e n d é -
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
finissant
des
a i n s i l e s t o i l e s m é t a l l i q u e s p a r le n o m b r e
mailles
au
centimètre
carré,
e x p r e s s é m e n t q u e toutes les mailles
reusement
é g a l e s ; o r , il n ' e n
on
suppose
sont
est p a s
rigou-
toujours
ainsi et p e n d a n t l o n g t e m p s les l a m p e s d u b a s s i n
do S a i n t - E t i e n n e , e n F r a n c e , o n t é t é
fabriquées
a v e c d e s t o i l e s t r è s i r r é g u l i è r e s d a n s l e s q u e l l e s le
d i a m è t r e des mailles variait d ' u n point à l'autre
d u s i m p l e a u d o u b l e . D a n s ces c o n d i t i o n s , la s é curité don née p a r u n e s e m b l a b l e toile à i 4 4 m a i l l e s
n'est
p a s p l u s g r a n d e q u ' a v e c u n e toile bien r é -
g u l i è r e d e 3 6 m a i l l e s a u c e n t i m è t r e c a r r é . Il suffit
e n effet d ' u n e s e u l e m a i l l e t r o p l a r g e p o u r l a i s s e r
p a s s e r la
flamme
; il p o u r r a y avoir d e s c e n t a i n e s
da m a i l l e s r é g u l i è r e s à coté s a n s q u e la sécurité
s o i t r e n d u e p l u s g r a n d e p a r l e u r p r é s e n c e . Il n e
faut pas
oublier
n o n p l u s q u ' à l'usage les
lils
des toiles s ' a m i n c i s s e n t et a m è n e n t u n e a u g m e n tation progressive de l ' o u v e r t u r e de la maille.
L e r ô l e d e s t o i l e s m é t a l l i q u e s d a n s les l a m p e s
consiste à refroidir s u f f i s a m m e n t les p r o d u i t s de
la
combustion
du
mélange
a l l u m é à la f l a m m e et b r û l e
que l'inflammation
explosif
qui
s'est
à l'intérieur
pour
n e p u i s s e se t r a n s m e t t r e a u
m é l a n g e e x p l o s i f q u i e n t o u r e la l a m p e . L e d e g r é
de s é c u r i t é de ces toiles est d o n c fonction de d e u x
variables indépendantes :
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
) ° L a q u a n t i Le d e c h a l e u r
absorber
qu'elles
peuvent
d a n s l'unité de t e m p s et diffuser
par
rayonnemen t ;
2" L a q u a n t i t é d e c h a l e u r f o u r n i e d a n s l e m ê m e
t e m p s p a r la c o m b u s t i o n d u m é l a n g e g a z e u x .
Toute variation
d e l ' u n e d e ces g r a n d e u r s a l -
t é r e r a la s é c u r i t é offerte p a r la t o i l e m é t a l l i q u e
doit
être
é t u d i é e a v e c le p l u s d e s o i n à c e p o i n t d e
considérée. Les causes dont l'influence
vue
s o n t : l'élévation
nature
du
de
mélange
température
des
combustible
toiles,
et son
la
agita-
tion.
h'élévation
évidemment
de température
leur
action
des t u i l e s d i m i n u e
refroidissante
et
aug-
m e n t e en m ê m e t e m p s la v i t e s s e d e p r o p a g a t i o n
de la f l a m m e d a n s le m é l a n g e g a z e u x q u i , p l a c é
à l e u r c o n t a c t , se t r o u v e e n é q u i l i b r e de t e m p é r a t u r e a v e c e l l e s . A la t e m p é r a t u r e d e 6 5 o ° , c'està-dire a u
rouge
sombre,
les toiles
métalliques,
q u e l q u e fines q u ' e l l e s s o i e n t , n e suffiraient p l u s
p o u r a r r ê t e r la f l a m m e d ' a u c u n des m é l a n g e s de
g r i s o u et d ' a i r . C e c i b i e n e n t e n d u e n
q u e la f l a m m e
arrive
sur
une
toile
supposant
métallique
e n t o u r é e de toute p a r t de m é l a n g e c o m b u s t i b l e .
Si à l ' e x t é r i e u r d e la toile il n ' y a q u e des gaz
b r û l é s a u l i e u d e m é l a n g e c o m b u s t i b l e , la
pérature
d e l;i t u i l e
pourra
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
évidemment
temêtre
plus
élevée
page
au
sans
que
l'inflammation
d e h o r s . Ces d i v e r s e s
se
pro-
c i r c o n s t a n c e s se
p r é s e n t e n t d a n s l ' é t u d e des l a m p e s de s û r e t é .
La
tions
nature
dans
influence
du gaz
combustible
lesquelles
non
il est mt'lé
moins
grande
et les
propor-
à l'air,
ont une
sur
la
plus
m o i n s g r a n d e facilité avec laquelle u n e
ou
flamme
p e u t traverser u n e toile d o n n é e . P l u s faible sera
la v i t e s s e d e p r o p a g a t i o n , p l u s c o n s i d é r a b l e sera'
l a p e r t e r e l a t i v e d e c h a l e u r et p a r s u i t e p l u s facile s e r a l ' e x t i n c t i o n .
Parmi
les
0
g r i s o u e t d ' a i r , l e m é l a n g e à 11 /
0
mélanges
de
qui a u n e vi-
tesse de o'",6o p a r s e c o n d e n e s e r a p a s a r r ê t é p a r
d e s toiles q u i a r r ê t e r o n t les m é l a n g e s à l a l i m i t e
de c o m b u s t i b i l i t é . Les m é l a n g e s d ' h y d r o g è n e o u
de s u l f u r e de c a r b o n e et d'air d o n t la vitesse
propagation peut dépasser plusieurs mètres
de
par
s e c o n d e s , t r a v e r s e n t à c o u p s û r toutes les toiles
métalliques employées habituellement
dans
les
une
in-
lampes de sûreté.
\] agitation
fluence
du
mélange
considérable
sur
gazeux
a
la sécurité des
toiles
m é t a l l i q u e s et p a r s u i t e s u r celle des l a m p e s d e
siireté ; des
circonstances
trop
nombreuses
et
trop variables p o u r être toutes prévues, peuvent,
d a n s l'usage c o u r a n t des l a m p e s de sûreté, dével o p p e r u n e c e r t a i n e a g i t a t i o n . C'est là u n e q u e s -
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
tion qui, par
son
importance
pratique,
mérite
u n e étude détaillée.
Si l ' o n r e p r e n d l ' e x e m p l e p r é c é d e n t d e s t u b e s
placés a u m i l i e u d ' u n m é l a n g e explosif et
lesquels
se p r o p a g e
dans
l a c o m b u s t i o n et q u e l ' o n
s u p p o s e q u e le m é l a n g e
au
lieu d'être e n r e p o s
soit lui-même a n i m é
d'un m o u v e m e n t de trans-
l a t i o n d i r i g é d a n s le
sens
de la proptigation de
l a l l a m m e , il e s t é v i d e n t q u e l e c h e m i n p a r c o u r u
p a r la l l a m m e a u b o u t
de l'unité de t e m p s sera
la s o m m e des vitesses de
pagation ; cette
t r a n s l a t i o n et de pro-
dernière
sera
d'ailleurs
g r a n d e q u e d a n s u n m é l a n g e en repos en
des remous occasionnés
p a r le m o u v e m e n t
g a z . Mais le r e f r o i d i s s e m e n t
nage
du
tube
est
proportionnel
de
du
a m e n é p a r le voisiau
l l a m m e p é n é t r e r a d o n c d a n s le t u b e
même temps avant
plus
raison
s'éteindre,
temps,
la
p e n d a n t le
et p a r
suite
aura parcouru un chemin plus considérable qui
lui suffira p o u r t r a v e r s e r u n
tube qui
l'arrêtait
dans u n m é l a n g e en repos. Les d i m e n s i o n s des
t o i l e s m é t a l l i q u e s s u f f i s a n t e s p o u r a s s u r e r l a séc u r i t é d a n s u n m é l a n g e en repos s e r o n t insuffisantes dans un mélange en
mouvement.
Les circonstances q u i m e t t e n t en
mouvement
u n m é l a n g e g a z e u x dans u n e l a m p e p e u v e n t être
extérieures à
la l a m p e
et i n d é p e n d a n t e s de son
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
f o n c l i o n n e m e n t : t e l s 1RS c o u r a n t s d ' a i r ,
t i o n dp l a l a i n p p . ; c e t t e a g i t a t i o n
l'agita-
peut être pro-
voquée encore p a r l a combustion elle-même qui,
en r a i s o n de la d i l a t a t i o n d e s gaz b r û l é s , p o u r r a ,
d a n s c e r t a i n s c a s , r e f o u l e r le m é l a n g e n o n e n c o r e
b r û l é . Que l'on s u p p o s e , p a r e x e m p l e ,
l'inflam-
mation
d'une
capacité
des parois
pleines,
provoquée
q u i soit formée,
partie
par
à l'intérieur
partie
par
des toiles m é t a l l i q u e s ,
se fera e x c l u s i v e m e n t
p a r c e s d e r n i è r e s et a v e c
u n e vitesse d'autant plus grande
tion utile sera m o i n d r e .
cylindre
à parois
l'écoulement
Soit,
pleines
que leur
sec-
par exemple,
dont
une
un
base seule
soit fermée p a r u n e toile m é t a l l i q u e , d a n s lequel
on
provoque
plus en plus
l'inflammation
éloignés
en
des p o i n t s
d e la t o i l e .
Quand
de
l'in-
f l a m m a t i o n se f a i t t o u t p r è s d e l a t o i l e , l a f l a m m e
arrive
sur
cette dernière avec u n e vitesse égale
à celle d e p r o p a g a t i o n ; c'est-à-dire
m
p l u s de o ,60. L a
flamme
qui
est
nu
s ' a r r ê t e a l o r s et s ' é t e i n t
s u r la t o i l e . Si l ' i n f l a m m a t i o n
a été p o r t é e p l u s
bas,
toile, l o r s q u e
à une
flamme
distance
atteindra
r
cette
de la
d e r n i è r e , la
surface
la
en
c o m b u s t i o n sera u n e s p h è r e de r a y o n r q u i s'acc r o î t r a a v e c u n e v i t e s s e l i n é a i r e d e 7 fois
m
soit 4 , 2 0 , p a r
suite de
la
dilatation
n
o' ,6o,
des
gaz
b r û l é s , L a v i l e s s e d ' é c o u l e m e n t à t r a v e r s la toile
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
m é t a l l i q u e s ' o b t i e n d r a en
m u l t i p l i a n t ce c h i l î r e
p a r le r a p p o r t de la s u r f a c e
celle
de
la
sphère.
La
libre
toile
d e la toile à
normale
de
\!\\
mailles au centimètre carré présente u n e surface
l i b r e é g a l e à l a m o i t i é d e l a s u r f a c e t o t a l e . Il e n
r é s u l t e , p a r u n c a l c u l t r è s s i m p l e , q u e si l ' i n l l a u i m a t i o n est portée k u n e d i s t a n c e de la toile
égale au
rayon du
c y l i n d r e , la vitesse
l e m e n t s e r a d e 3o m è t r e s p a r
seconde.
d'écouLe
fait de la c o m b u s t i o n d a n s u n e e n v e l o p p e
seul
mi-
close p e r m e t d o n c de réaliser des vitesses r e l a t i v e m e n t é n o r m e s q u a n d on les c o m p a r e a v e c la
vitesse n o r m a l e de p r o p a g a t i o n d e la f l a m m e et
q u i suffisent l a r g e m e n t p o u r a m e n e r le p a s s a g e
i n s t a n t a n é des i l a m m e s h t r a v e r s les toiles
mé-
talliques.
L ' e x p é r i e n c e m o n t r e q u ' a v e c le gaz d ' é c l a i r a g e
l ' i n f l a m m a t i o n p o r t é e à la b a s e d ' u n c y l i n d r e
à
p a r o i s p l e i n e s d o n t le d i a m è t r e é g a l e la h a u t e u r ,
traverse à tout coup
une
toile
métallique
de
14-ï m a i l l e s f e r m a n t la p a r t i e s u p é r i e u r e . A m e s u r e q u e l a l o n g u e u r s ' a c c r o î t , le p a s s a g e se f a i t
d e p l u s e n p l u s f a c i l e m e n t e n raison d e l ' a c c é l é r a t i o n d e l a v i t e s s e d e p r o p a g a t i u n p a r le fait d e
l'agitation.
Après avoir traversé u n e
t o i l e m é t a l l i q u e , le
g a z , et p a r s u i t e l a f l a m m e , é p r o u v e n t d e s r e -
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
mous
qui augmentent
considérablement
tesse de p r o p a g a t i o n . A i n s i
une tlamme
la viayant
déjà traversé u n e p r e m i è r e toile m é t a l l i q u e , traversera encore
p l u s facilement les a u t r e s toiles
qui p o u r r a i e n t être placées s u r son p a s s a g e . P o u r
q u e d e u x toiles s o i e n t p l u s efficaces q u ' u n e s e u l e
c o n t r e c e s p a s s a g e s d i r e c t s d e l a f l a m m e , il f a u t
qu'elles soient p r e s q u e en contact, ou a u
moins
très voisines, de sorte q u e leur action refroidiss a n t e se fasse s e n t i r s u r u n e m ê m e f r a c t i o n
du
gaz en c o m b u s t i o n et q u e l ' a b a i s s e m e n t de t e m p é r a t u r e d e la f l a m m e soit d o u b l e d e celui q u ' a u rait, d o n n é , u n e toile, s i m p l e . D a n s le c a s d e s t o i l e s
séparées,
les
abaissements
p e u v e n t pas s'ajouter
de température
puisqu'ils s'appliquent
ne
à
des parties différentes du m é l a n g e gazeux. On ne
peut contester
cependant l'accroissement
de
la
sécurité q u e d o n n e a u x l a m p e s la superposition
de plusieurs tamis, m ê m e
s é p a r é s ; m a i s ce r é -
sultat est d ù p r i n c i p a l e m e n t
circulation
de
du
l'atmosphère
rattache
et à celle
gaz
qui
à la plus
intérieure
de la
l a m p e : il s e
à l'action des c o u r a n t s d'air
do l ' a g i t a t i o n
difficile
g ê n e le r e n o u v e l l e m e n t
extérieurs
d e l a l a m p e d o n t , il v a
m a i n t e n a n t être question.
D a n s le m o d e
de passage
de la f l a m m e q u i
vient d'être examiné, réchauffement
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
de la toile
par
la
combustion
flamme
en
ne
joue
arrivant sur
aucun
rùle.
La
la toile la traverse ou
s ' é t e i n t m a i s n e s é j o u r n e j a m a i s à s o n c o n t a c t et
ne peut,
par
seulement,
s u i t e , l'échauffer. Kilo la t r a v e r s e
d'autant
plus facilement
toile était a n t é r i e u r e m e n t
plus
que
chaude.
cette
Il e s t
d ' a u t r e s c o n d i t i o n s d a n s l e s q u e l l e s le m o u v e m e n t
des gaz p e u t p r o v o q u e r r é c h a u f f e m e n t d ' u n e toile
jusqu'au rouge
et
laisser
b r û l é s assez c h a u d s p o u r
a u d e h o r s . Soit u n
ainsi
passer des
porter
cvlindre
en toile m é t a l l i q u e
s e m b l a b l e à u n t a m i s de l a m p e D a v y
exposé à
l'action d ' u n m é l a n g e gazeux lancé, suivant
direction
normale
à
gaz
l'inflammalion
l'axe
du
cvlindre.
une
L'in-
f l a m m a t i o n p o r t é e à l ' i n t é r i e u r d u c y l i n d r e , soit
par une
flamme,
que,
se
sans
la t r a v e r s e r
soit p a r u n e étincelle
propagera jusqu'à
la
toile
électri-
métallique
t o u t d ' a b o r d , si la v i t e s s e d u
m é l a n g e gazeux n'est pas trop forte. Elle
sub-
sistera s a n s s'éteindre a u contact de la toile p a r
l a q u e l l e p é n è t r e le g a z , e l l e
s'éteindra
t r a i r e v e r s la s o r t i e d e s g a z o ù
au
con-
il n ' a r r i v e p l u s
q u e des gaz b r û l é s . Mais d e ce còlè la t e m p é r a ture
de
la t o i l e s ' é l è v e r a
progressivement jus-
q u ' à u n e c e r t a i n e l i m i t e , f o n c t i o n à l a fois d e l a
v i t e s s e d e c i r c u l a t i o n d e s g a z et d u
rayonnement
extérieur.
toujours
Les gaz
brûlés
auront
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
une
t e m p é r a t u r e p l u s élevée q u e celle J e la toile et
l'écart sera d ' a u t a n t p l u s c o n s i d é r a b l e q u e la vitesse de circulation
sera plus
forte.
La
vitesse
c r o i s s a n t , il a r r i v e r a u n m o m e n t o ù les gaz sort a n t s s e r o n t assez c h a u d s p o u r e n f l a m m e r le m é lange combustible qui a circulé a u t o u r du tamis
s a n s y p é n é t r e r , et p a r suite sans b r û l e r . D'après
ce q u i v i e n t d ' ê t r e d i t , c e t t e i n f l a m m a t i o n
exté-
r i e u r e s e r a o b t e n u e p o u r u n e t e m p é r a t u r e d e la
toile d ' a u t a n t p l u s b a s s e q u e la v i t e s s e d e c i r c u lation des gaz sera plus considérable. Aussi p o u r
les v i t e s s e s s u f f i s a m m e n t fortes, le p a s s a g e a r r i v e
à être p r e s q u e instantané.
L e s e x p é r i e n c e s de la C o m m i s s i o n f r a n ç a i s e d u
g r i s o u o n t m o n t r é q u e la vitesse m i n i m a
néces-
saire p o u r p r o j e t e r la f l a m m e en d e h o r s d ' u n cylindre de î centimètre, de diamètre
fait a v e c la
toile de 144 m a i l l e s était de :
Grisou
Gaz d'éclairage.
. . . . . .
'-i mètres.
o ,Ko.
m
A u x v i t e s s e s d e 5 m è t r e s p a r s e c o n d e , le p a s sage est
sensiblement
instantané
pour
le
gaz
d'éclairage.
C e s q u e l q u e s d o n n é e s s u r les t o i l e s m é t a l l i q u e s
r é s u m e n t t o u t e la t h é o r i e d e s l a m p e s d e s û r e t é .
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
DEUXIÈME
CHAPITRE
PARTIE
PREMIER
C A U S E S DES A C C I D E N T S
19. G é n é r a l i t é s . — L e s études théoriques sur
le d é g a g e m e n t d u g r i s o u e t les c o n d i t i o n s d e son
i n f l a m m a t i o n p e r m e t t e n t d e se f a i r e u n e i d é e g é nérale du mode
mais
elles n e
de production
f a i r e p r é v o i r a priori
qui
des
accidents ;
suffisent p a s à elles seules p o u r
toutes
p e u v e n t se r e n c o n t r e r
elles p e r m e t t e n t e n c o r e
les
dans
circonstances
la
pratique ;
moins d'apprécier
l'im-
p o r t a n c e relative réelle des différentes causes de
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
d a n g e r . Il f a u t r a p p r o c h e r c e s é t u d e s d e l ' o b s e r v a t i o n d i r e c t e d e s f a i t s ; l e s a c c i d e n t s si n o m b r e u x
q u i s e s o n t p r o d u i t s d a n s les m i n e s
de
houille
p e u v e n t f o u r n i r des e n s e i g n e m e n t s p r é c i e u x . On
serait m ê m e tenté de croire qu'il suflil
d'ouvrir
les s t a t i s t i q u e s d e s a c c i d e n t s p o u r être i m m é d i a t e m e n l r e n s e i g n é d ' u n e façon p r é c i s e s u r les c a u ses q u i les o n t a m e n é s . E n réalité l ' o b s e r v a t i o n ,
e n ce q u i c o n c e r n e les a c c i d e n t s
de m i n e s ,
est
b e a u c o u p p l u s difficile q u e l ' e x p é r i m e n t a t i o n ,
ces d e u x m é t h o d e s d o i v e n t être e m p l o y é e s
curremment
pour arriver
à des résultats
et
concer-
tains.
L a difficulté d a n s l'observât ion, c'est-à-dire d a n s
les e n q u ê t e s a p r è s a c c i d e n t s , p r o v i e n t d a n s b i e n
d e s cas de ce q u e t o u s les t é m o i n s de I a c a t a s l r o p h e
sont m o r t s ; c'est
a l o r s de la s i m p l e i n s p e c t i o n
des lieux q u ' i l faut tirer des d é d u c t i o n s trop souv e n t h a s a r d é e s . Si les t é m o i n s s o n t
est s o u v e n t t r o m p é p a r
v i v a n t s , on
le t é m o i g n a g e
de gens
q u i o n t i n t é r ê t à se d i s c u l p e r d ' i m p r u d e n c e s
qui
pourraient entraîner pour eux des responsabilités
p l u s ou m o i n s g r a v e s . D a n s la m a j o r i t é des cas,
il e s t i m p o s s i b l e
causes premières
ment,
de connaître avec certitude
d'un
accident ;
les
malheureuse-
p l u t ô t q u e d ' a v o u e r s o n i g n o r a n c e , o n se
fait t r o p s o u v e n t u n p o i n t d ' h o n n e u r d e t r o u v e r
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
c o û t e q u e c o û t e u n e e x p l i c a t i o n q u i est généra*l e m e n t le s i m p l e r e f l e t d e s i d é e s t h é o r i q u e s à l a
m o d e . C'est a i n s i q u e d e n o m b r e u x d o c u m e n t s ,
qui par l'impression acquièrent une autorité déf i n i t i v e , v i e n n e n t é t a b l i r le r ù l e t o u r à t o u r
pondérant
poussières,
des
variations
des
pré-
barométriques,
dégagements
instantanés,
des
des
l a m p e s i n s u f f i s a m m e n t protégées contre les courants d'air. Les statistiques sont donc incapables
à elles s e u l e s de faire c o n n a î t r e les c a u s e s e x a c tes d e s a c c i d e n t s , l e u r s e n s e i g n e m e n t s
doivent
seulement
fournit
être r a p p r o c h é s de c e u x q u e
l'expérimentation
pour
les
corroborer
et
les
compléter.
Un
p r e m i e r fait
qui découle
immédiatement
des statistiques est relatif à l ' i m p o r t a n c e
cidents
de
grisou
qui
est
beaucoup
d e s acmoindre
q u ' o n n e le c r o i t s o u v e n t . S u r le n o m b r e t o t a l d e s
ouvriers tués
dans
l'exploitation
des m i n e s
de
h o u i l l e , il n ' y e n a g u è r e q u ' u n c i n q u i è m e d o n t
la m o r t
sur
soit d u e à des explosions
le n o m b r e
proportion
d e g r i s o u et
des ouvriers blessés
est d i x
fois
plus
la
même
faible e n c o r e . L e s
c h u t e s de p i e r r e s , les a c c i d e n t s d a n s les m a n œ u vres des cages
et des w a g o n n e t s
ne
tuent pas
b e a u c o u p d e m o n d e à la f o i s , m a i s p a r l e u r r é pétition fréquente
arrivent
à un
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
chitïre impor-
tant. Les
chutes de pierres
l'éboulement
plus
de
du charbon
morts
t o m b a n t d u toit
entraînent
q u e les a c c i d e n t s
deux
du
et
fois
grisou
et
d i x fois p l u s d e b l e s s u r e s .
Voici p o u r différents p a y s la p r o p o r t i o n
d'ou-
v r i e r s t u é s p a r l e g r i s o u s u r 100 m o r t s :
Paj s
France, .
Autriche .
Angleterre
Belgique .
Propoi Lion p . " '
.
.
Si l'opinion p u b l i q u e
Epoque
()
d e iflHo à iHH1H76 à 1H80
1870 k 1 ^ 4
1 8 J I h. 1N7 1
:\%
ÏS
se p r é o c c u p e
beaucoup
p l u s des accidents de grisou que des a u t r e s
ces de
danger
mines,
c'est
souvent
inhérentes
¡1 l ' e x p l o i t a t i o n
q u e ces accidents
l'importance
de
prennent
véritables
t u a n t d ' u n seul c o u p p l u s i e u r s
sourdes
trop
désastres
centaines
d'ou-
v r i e r s . L e p l u s g r a v e q u i s e soit, p r o d u i t , c e l u i d e
O a k s colliery ( Y o r k s h i r e ) le
12
décembre
18G6
a a m e n é l a m o r t d e 3Gi o u v r i e r s .
20. Causes des accidents. —
taillée des accidents d u
L'étude
dé-
grisou montre que tout
a c c i d e n t est la c o n s é q u e n c e d e t r o i s c a u s e s
dis-
t i n c t e s et i n d é p e n d a n t e s d o n t le c o n c o u r s s i m u l -
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
t a n é est n é c e s s a i r e .
L a connaissance précise de
ces c a u s e s d ' a c c i d e n t s et de l e u r i m p o r t a n c e rel a t i v e e s t i n d i s p e n s a b l e p o u r a r r i v e r , e n l e s faisant
disparaître,
à
supprimer
grisou ou tout au m o i n s
les accidents de
à e n r é d u i r e le
nom-
grisou
mine
bre.
Ces c a u s e s s o n t :
i
Q
L'accumulation
du
dans
en q u a n t i t é suffisante p o u r d o n n e r
des m é l a n g e s explosifs
plus
ou
la
naissance
à
moins
volu-
2° L ' i n f l a m m a t i o n d u m é l a n g e e x p l o s i f
préa-
mineux ;
lablement formé ;
3° L ' a c t i o n m e u r t r i è r e d e l ' e x p l o s i o n
o u v r i e r s . T r o p s o u v e n t les o u v r i e r s
dehors du
champ
d'action
p l o s i o n t r o u v e n t la m o r t
été b r û l é s o u
tués
par
immédiat
comme
sur
les
placés
de
en
l'ex-
ceux qui
projection.
C'est
ont
ainsi
qu'à l'accident de S e a h a m ( D u r h a m ) , H septembre
\
1880, l ' e x p l o s i o n
ne
tua
directement
que
o u v r i e r s e t e n fit p é r i r i n d i r e c t e m e n t 160 e n
raison
de
certaines conditions
particulières
à
l'exploitation de la m i n e qui a u r a i e n t p u ne pas
e x i s t e r et p a r s u i t e n e p a s e n t r a î n e r c e t t e m o r t a lité e n r a y a n t e .
21. Causes d'accumulation
Les
diverses
causes
d'accumulation
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
du
grisou. —
du
gri-
sou
doivent au
tance
relative
point
de v u e
êlre rangées
de leur
dans
impor-
l'ordre
sui-
vant :
i°
Ventilation
insuffisante
ou
mal
C'est là d e b e a u c o u p la c a u s e l a p l u s
des a c c u m u l a t i o n s
de
grisou.
aérées naturellement, qui
bientôt
complètement
Dans
dirigée.
fréquente
les mines
heureusement
disparu
auront
e n F r a n c e , il s e
produit à certaines époques de l'année des ralent i s s e m e n t s et
ventilation.
répandu
m ê m e des arrêts complets
Ce p r o c é d é
d'aérage
de
autrefois
la
très
a été la cause de n o m b r e u x accidents,
p a r t i c u l i è r e m e n t à D l a n z y e t d a n s le b a s s i n d e
S a i n t - E t i e n n e . D a n s les m i n e s aérées m é c a n i q u e ment,
la suspension
totale de l'aérage p e u t en-
c o r e se p r o d u i r e p a r s u i t e d e l ' a r r ê t d u v e n t i l a t e u r r é s u l t a n t soit d ' u n
accident a u x
machines,
soit d ' u n e s i m p l e négligence, o u p a r s u i t e d ' u n e
obstruction accidentelle du puits. P l u s fréquemm e n t encore l'insuffisance
les t r a v a u x
de la v e n t i l a t i o n d a n s
résulte de la m a u v a i s e
direction de
l'air d a n s l a m i n e q u i n'est p a s c o n d u i t en q u a n tité suffisante
a u x points où
se d é g a g e la
gri-
sou.
Cette i n s u f f i s a n c e et cette m a u v a i s e
organisa-
t i o n de la v e n t i l a t i o n o n t été la c a u s e i m m é d i a t e
d e s g r a v e s a c c i d e n t s q u i s o n t v e n u s , d a n s ces der-
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
n i è r e s a n n é e s f r a p p e r à c o u p s r e d o u b l é s le b a s sin de S a i n l - E l i ' n n o .
a" L'existence
ment
remblayés
d'un
grand
de
vieux
et
non
nombre
travaux
ventilés
insuffisama é l é la
d'accidents,
m e n t d a n s les m i n e s a n g l a i s e s q u i
cause
particulièrene sont
ja-
m a i s r e m b l a y é e s . D a n s ces m i n e s , c h a q u e c h u t e
du
toit r e n v o i e
une
dans
bouffée d'air
les g a l e r i e s et
chantiers
g r i s o u t e u x q u i se
reconnaît
au m o i n s à la l a m p e
pas produit
nombre
d a n s le cas o ù
il n e s'est
d'accidents. En France, u n
certain
des g r a n d s accidents produits dans
des
m i n e s r é p u t é e s p e u g r i s o u t e u s e s o n t p u être occasionnés
formées
par
des
accumulations
de
grisou
d a n s les v i e u x t r a v a u x , o u s i m p l e m e n t
d a n s les videg des r e m b l a i s , p u i s chassées d e h o r s
soit sous l'action d ' u n c o u p de m i n e tiré a u v o i s i n a g e , soit
soit
par
une
p a r u n affaissement ra p i de du toit,
simple
tions normales
modification
aux
condi-
d ' a é r a g e q u i a fait v a r i e r la - r é -
partition de la pression a u x
d i v e r s p o i n t s d e la
mine.
La troisième cause d'accumulation
du grisou
d o i t ê t r e r a p p o r t é e à c e r t a i n s dégagements
maux
(soufflard,
anor-
outburst, dégagement
t a n é ) d ' u n e i n t e n s i t é e x c e p t i o n n e l l e et
instan-
dont une
ventilation normale ne peut annihiler complète-
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
m e n t l'effet. C e s d é g a g e m e n t s , t r è s r a r e s et p e u
i m p o r t a n t s en F r a n c e et e n A l l e m a g n e , n e
peu-
v e n t , d a n s ces p a y s être r e n d u s r e s p o n s a b l e s d'auc u n g r a n d a c c i d e n t ; il n ' e n e s t p a s d e m ê m e
en
B e l g i q u e et s u r t o u t e n A n g l e t e r r e o ù ils o n t
oc-
casionné à plusieurs reprises de très graves
ex-
plosions.
La
statistique des
mines
anglaises
d o n n e , p o u r les a c c i d e n t s a u n o m b r e d e 4 3 q u i
pendant
plus
la période
1870-1880, o n t
de 6 m o r t s , les p r o p o r t i o n s relatives
v a n t e s p o u r les d i v e r s e s
causes
f
occasionné
sui-
d'accumulation
du grisou :
Ventilation insuffisante ou mal dirigée .
3;
B r
Dégagements exceptionnels ( i traçage.
soufflards, dégagements instantanée). .
'21
17
Total
22.
Causes
d'inflammation
— Les causes que
l'on
considère
IOO
du
grisou.
généralement
c o m m e plus directement responsables des
d e n t s q u e les c a u s e s d ' a c c u m u l a t i o n
sont étudiées avec u n
du
accigrisou
s o i n p a r t i c u l i e r d a n s les
e n q u ê t e s a p r è s a c c i d e n t s et les s t a t i s t i q u e s f o u r nissent à leur e n d r o i t des r e n s e i g n e m e n t s
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
assez
complets.
Voici
le
résumé
de ces
statistiques
p o u r les p r i n c i p a u x p a y s m i n i e r s :
FRANCE
800
ACCIDENTS DE
183.O
A l88"i.
.1.1
•20
ifl
10
Total.
.
.
IOÛ
BELGIQUE
18794l3
ACCIDENTS DE
J'LI
1831 A
i
Lampes de sûreté
3o:
Total.
.
1.3
.
100
ANGLETERRE
43 A C C I D E N T S A Y A N T O C C A S I O N N É L A MOUT DE P L U S
DE 6
O U V R I E R S DE
18-O
A
1880.
?
37
•j
28
:«
Total.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
.
.
100
PRUSSE
D E i860 A 1880.
(i(l
20
Tirage à l a poudre
10
10
Total
IOO
AUTRICHE
1H69 A 18K6.
DE
Lampes à feu nu
f>
I
•4
8
100
Total
2 3 . L a m p e s à f e u n u . — D a n s t o u s les p a y s ,
sauf en B e l g i q u e , où d e p u i s l o n g t e m p s la réglementation
ont
causé
est
le
très sévère, les
plus grand
l a m p e s à feu
nombre
m a i s elles n e seraient placées
nu
d'accidents,
qu'en seconde
g n e p o u r la g r a v i t é des a c c i d e n t s . E l l e s n e
e n effet e m p l o y é e s q u e d a n s d e s m i n e s
lisont
peu gri-
souteuses ou d u m o i n s s u p p o s é e s telles ; on c o m prend
q u e , d a n s ces c o n d i t i o n s ,
d'une
accumulation
isolée
l'inflammation
de grisou
ne puisse
p a s se p r o p a g e r à d ' a u t r e s a c c u m u l a t i o n s n i
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
par
suite
s'étendre
au
loin en
d'ouvriers. Pourtant
sionnées
par
frappant
quelques
les l a m p e s
beaucoup
explosions
à feu n u o n t
occa-
été
très
meurtrières :
Mine de Burgk, bassin Je P l a u e n . a août
iSfiq
2-(î victimes
Mine de Bnïekenberg, bassin de Zwickau,
i décembre i8^g
89
//
Mine de Blantyre,Ecosse, 2 3 octobre 187^. 207
// *
or
U n assez
grand
n o m b r e d'accidents d u s ù la
m ê m e c a u s e o n t fait c h a c u n p r è s d ' u n e v i n g t a i n e
d e v i c t i m e s . T a n t ô t les l a m p e s à feu
employées
elles
dans
n'étaient
l'être q u e d a n s
toute la
n u étaient
mine ; plus
employées
souvent
ou n'étaient
certaines régions
censées
de la m i n e ré-
p u t é e s n o n g r i s o u t e u s e s . T a n t ô t les o u v r i e r s p o r t e u r s d e s l a m p e s à feu n u d é p a s s a i e n t les l i m i t e s
qui
leur étaient tracées,
d ' a u t r e s fois l e
p é n é t r a i t d a n s les q u a r t i e r s s u p p o s é s
soit
par
l'aérage,
suite d'un
soit p a r
grisou
indemnes
renversement accidentel de
suite
d'un
c o u r a n t d'air à la s u i t e d ' u n
refoulement
du
dégagement brus-
q u e de grisou.
24. T i r a g e à la poudre.
flammation
placée a u
quence, mais
—
La cause
d'in-
second r a n g c o m m e fré-
do b e a u c o u p
au premier
g r a v i t é d e s a c c i d e n t s e s t le tirage
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
à la
comme
poudre.
L'agi talion p r o d u i t e d a n s l'air p a r l'explosion des
coups de m i n e paraît favoriser la p r o p a g a t i o n a u
loin de l'inflammation
du
grisou. Cette agita-
t i o n p r o d u i t u n d o u b l e effet ; e l l e m e t e n
mou-
v e m e n t le g r i s o u a c c u m u l é d a n s l e s c l o c h e s , l e s
r e m b l a i s et l ' a m è n e au
contact de la f l a m m e de
l a p o u d r e o ù il s ' e n f l a m m e . E n o u t r e , l a c o m b u s t i o n d u m é l a n g e en m o u v e m e n t se fait a v e c u n e
très g r a n d e
explosion
rapidité, produisant
qui
une
véritable
m e t en m o u v e m e n t de
nouvelles
quantités de grisou. A u contraire, l'inflammation
produite au
contact d'une flamme dans un
l a n g e en r e p o s se fait a v e c u n e e x t r ê m e
et n e p e u t p a r
mé-
lenteur
suite se p r o p a g e r en dehors des
l i m i t e s de l ' a c c u m u l a t i o n de g r i s o u o ù elle a p r i s
n a i s s a n c e . L a d y n a m i t e e m p l o y é e d e p u i s u n certain temps
d a n s les m i n e s de h o u i l l e
n'a
occa-
sionné q u e de très rares accidents. On v e r r a en
effet p l u s l o i n e n é t u d i a n t l ' u s a g e
d a n s le g r i s o u q u e , t a n d i s
que
des
explosifs
la p o u d r e
noire
e n f l a m m e i n f a i l l i b l e m e n t le g r i s o u , l a d j m a m i t e
n e p r o d u i t l e m ê m e effet q u e d ' u n e f a ç o n t o u t à
fait e x c e p t i o n n e l l e .
25. Accidenta dus a u x lampes de sûreté.
— La troisième
cause
d'inflammation
s o u p r o v i e n t d e l ' u s a g e d e s lampes
du
gri-
de sûreté.
Il
s e m b l e q u e si e l l e s m é r i t a i e n t l e u r n o m , e l l e s n e
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
devraient jamais
fait, à p a r t
la
occasionner
lampe
de
d'accidents.
Davy
qui,
En
sous
l'in-
l l u e n e e des c o u r a n t s d ' a i r , laisse p a s s e r la f l a m m e
a u d e h o r s , t o u t e s les l a m p e s
plus
perfectionnées :
de
lampe
sûreté un
Clanny
peu
(Boty),
lampe Mucseler, larnpe Marsaut, lampe
Fumât
n'ont
d'acci-
p o u r ainsi dire j a m a i s occasionné
dents lorsqu'elles s o n t fermées et e n b o n état d e
conservation. Le n o m b r e relativement
considé-
r a b l e d ' i n l l a m m a t i o n s de g r i s o u q u i l e u r est i m putable
provient
fermeture
d'ouverture
incomplète
ou
de
des
lampes,
de
détérioration
de
l e u r s o r g a n e s . S u r l e s 1200 a c c i d e n t s r e l e v é s e n
F r a n c e e t e n B e l g i q u e d e 1820
à 1880, i l n ' y e n
a q u e 6 qui soient a t t r i b u a b l e s à des l a m p e s
de
s û r e t é a u t r e s q u e la l a m p e D a v y en b o n é t a t
de
conservation.
h'nuverlure
des
lampes
p a r les o u v r i e r s est
une cause fréquente d'inflammation
elles
sont
ouvertes
pour
les
du
grisou;
rallumer,
pour
donner plus de lumière, pour allumer une pipe
et, c h o s e p l u s
difficile à c r o i r e , p o u r
rechercher
le g r i s o u d a n s l e s c l o c h e s .
L e s fermetures
incomplètes
résultent
d'un
vissage i n c o m p l e t de l ' a r m a t u r e , de l'emploi
verres
ne
p o u v a n t par suite élre serrés sur l ' a r m a t u r e ,
ou
C
M
A
T
K
H
i
.
ia
.. —
pas
la h a u t e u r
Grisou.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
normale
de
et
I.K
n'ayant
6
de l'oubli
d'une
p i è c e d e la l a m p e q u i , p a r s o n
a b s e n c e l a i s s e du. j e u , u n e d e s
d e u x toiles p a r
exemple
Enfin
dans certaines lampes.
d a n s les
l a m p e s à cuirasse, les t a m i s q u i s o n t cachés p e u vent être c o m p l è t e m e n t oubliés.
Les
détériorations
les
plus
fréquentes
des
l a m p e s s e p r o d u i s e n t d a n s l a m i n e p e n d a n t le t r a vail par la c h u t e des pierres ou le choc des pics.
Souvent
dans
le t r a n s p o r t s i m u l t a n é p a r
l'ou-
v r i e r d e s a l a m p e e t d e s o n p i c , la p o i n t e d e
ce
d e r n i e r vient faire de petits t r o u s d a n s
le
d e l a l a m p e e t e n l è v e k ce t a m i s t o u t e
efficacité.
D ' a u t r e s f o i s , l e mauvais
lampe
résulte d'un
étal d e s o r g a n e s d e l a
d é f a u t île s u r v e i l l a n c e à l a
lampisterie. Les mailles des
t o i l e s se s o n t p r o -
gressivement élargies p a r l'usure ou
par
tamis
déformées
d e s f r o t t e m e n t s ; le d i a p h r a g m e d e s l a m p e s
Mueselei' a été fendu
trop loiu p o u r
l'introduc-
t i o n d e l a c h e m i n é e , le p i q u e - f e u e s t t r o p m i n c e
p o u r le trou q u i lui d o n n e p a s s a g e .
26. Causes
Enfin
il e x i s t e
diverses
toute u n e
d'inflammation.
ilammalion variées, d'importance
les trois p l u s fréquentes
lumettes
qui,
p a r les f u m e u r s ,
en Angleterre
et
—
série de causes d'iumoindre dont
s o n t l'usage
les
des
foyers
al-
d'aérage
s u r l o u l en Belgique, ont
a m e n é d ' a s s e z n o m b r e u x a c c i d e n t s et l e s
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
incen-
dies
r é s u l t a n t du la c o m b u s t i o n
houille. Enfin
l e s foi/ers
j o u r près de l'orifice
plus d'accidents
croire.
dégagements
17 a v r i l
des
qu'on
Même, en
s p o n t a n é e de la
et l u m i è r e s
puits ont
ne
dehors
serait
des
instantanés
placés
tenté
<?as
comme
le
celui
du
1879 à F r a m e r i e s , q u i a m e n a u n é c o u l e -
p u i t s , il
grisou
de
d'immenses
m e n t c o n t i n u et p r o l o n g é de g r i s o u p a r
des
au
occasionné
arrive
atteint
parfois
la s u r f a c e
qu'une
avant
de
l'orifice
bouffée
s'être
s a m m e n t d i l u é e d a n s l'air et s ' a l l u m e a u x
de
suffifoyers
d e s m a c h i n e s b r û l a n t e t b l e s s a n t les o u v r i e r s d e
la
surface, De
observés
produit
en
nombreux
Belgique;
en F r a n c e e n
m i n y et u n a u t r e
exemples
un
1890
en ont été
cas s e m b l a b l e s'est
aux
mines
de Fir-
a n t é r i e u r e m e n t a u x m i n e s de
Bessèges.
On
peut
r é p a n d u de
prévoir
que l'usage
de plus en
l ' é l e c t r i c i t é d a n s les m i n e s
plus
amènera
aussi q u e l q u e s i n f l a m m a t i o n s de grisou soit p a r
s u i t e d e la p r o d u c t i o n d ' é t i n c e l l e s é l e c t r i q u e s , soit
par réchauffement résultant du passage du cour a n t d a n s les c o n d u c t e u r s .
P a r c o n t r e , l e s é t i n c e l l e s p r o d u i t e s p a r le c h o c
des pics et b a r r e s à m i n e s u r la p i e r r e d u r e
pa-
raissent,
ce q u i a é t é d i t a
di-
complètement inolïcnsives.
De
verses
contrairement à
reprises,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
nombreuses
France
expériences
et e n
d'obtenir
faites
Allemagne
s u r ce sujet
n'ont
d'inflammation
du
jamais
grisou.
d ' é c l a i r a g e est a u c o n t r a i r e f a c i l e m e n t
en
permis
Le
gaz
enllammé.
C'est u n e g é n é r a l i s a t i o n t r o p h â t i v e d e ce d e r n i e r
fait d e p u i s l o n g t e m p s c o n s t a t é q u i a v a i t fait c o n c l u r e a u d a n g e r des étincelles d a n s les m i n e s .
27. Causes d'aggravation des accidents.
—
Les causes de la
certains accidents
gravité
exceptionnelle
s o n t faciles
à
de
établir. L'une,
d ' e n t r e elles r é s u l t e de la disposition en b o u c l e
du
circuit,
d'aérage
deux extrémités
deux
atteintes par
ainsi paralyser
qui
permet
en
rapprochant
qu'elles
un même
soient
les
toutes
accident, qui peut
complètement l'aérage. L e
p r o c h e m e n t des p u i t s d'entrée et de sortie
rapd'air,
t r è s f a v o r a b l e p o u r l a c o m m o d i t é de, l ' e x p l o i t a t i o n , a été l ' u n i q u e c a u s e de la g r a v i t é e x c e p t i o n nelle des plus
g r a n d s accidents de
m i n e . C'est
a i n s i q u e l o r s d e l ' a c c i d e n t d e S e a h a m a u q u e l il
a été fait a l l u s i o n p l u s h a u t (§ 2 1 ) ( ' ) , u n e l é g è r e
explosion produite au voisinage du puits a a m e n é
la d é s o r g a n i s a t i o n dus n o m b r e u x b a r r a g e s , croise-
( ' ) AGUILLON. — Note sur les explosions
survenues
aux houillères de Seaham
et Penygraig
(Angleterre).
Annales des mines, XX, ilfî, 8 ° série.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
m o n t s et p o r t e s d ' a é r a g e d o n t le n o n fonctionnement
a m e n a l'arrêt i m m é d i a t de la ventilation
dans
la p l u s
g r a n d e partie de la m i n e et
ainsi l'asphyxie
causa
d e t o u s les o u v r i e r s q u i y tra-
v a i l l a i e n t . L e m ê m e fait s'est r e p r o d u i t s u r u n e
plus
ou
moins
grande
échelle dans u n
grand
n o m b r e d'autres accidents. Lors de l'accident de
F r a m e r i e s (§ 2 7 ) (') le r a p p r o c h e m e n t
des deux
p u i t s fut é g a l e m e n t , m a i s p o u r d e s motifs
rents, la seule cause de la gravité
diffé-
de l'accident.
P e n d a n t (pie le g r i s o u b r û l a i t à l'orifice d ' u n d e s
p u i t s t o u s les o u v r i e r s a u r a i e n t réussi à se s a u ver p a r le second p u i t s , ce q u ' i l s o n t e n v a i n t e n t é
d é f a i r e , si s o n o r i f i c e n ' a v a i t p a s é t é r é u n i a v e c
celui d u p r e m i e r p u i t s s o u s u n m ê m e
bâtiment
qui fut bientôt tout en f l a m m e .
Mais la c a u s e de b e a u c o u p la p l u s fréquente d e
l ' a g g r a v a t i o n d e s accidents de g r i s o u est la p r é s e n c e d e poussières
de houille
r é p a n d u e s d a n s les
c h a n t i e r s et les galeries soit s u r le sol, soit s u r les
chapeaux des boisages. A u m o m e n t d'une explosion, ces poussières mises e n suspension dans d u
gaz c h a u d , s'enflamment en utilisant
l'excédent
d ' o x y g è n e q u e le g r i s o u n ' a p a s b r û l é , et le v o -
(') MALLAKD
et
VICATHK. —
Note
sur
e
l'accident
F r a m e r î r s — Annales des mines, 8 série, X V , f ^ f i .
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
de
l a m e des gaz brûlés ainsi que leur
température
s o n t c o n s i d é r a b l e m e n t a u g m e n t é s . E t , ce q u i est
p l u s g r a v e e n c o r e , c e s p o u s s i è r e s se t r o u v a n t a i n s i
soulevées
en
proportion
bien plus grande
que
colle q u i p e u t ê t r e b r û l é e d o n n e n t n a i s s a n c e à d e
l'oxyde
de
carbone,
gaz é m i n e m m e n t
q u i déjà à la dose de i °/
m o r t . Il en
0
amène
résulte q u e tous
toxique
r a p i d e m e n t la
l e s o u v r i e r s q u i se
t r o u v e n t a p r è s u n e e x p l o s i o n , m ê m e assez faible,
s u r le p a s s a g e d o l a b o u f f é e d e s
d a n t son c h e m i n e m e n t
gaz brûlés
v e r s le p u i t s d e
pensortie,
s o n t t u é s p a r le g a z o x y d e d e c a r b o n e . L e
sou
seul qui
n'est j a m a i s
à l'oxygène
de l'air n e d o n n e r a i t q u e
carbonique
et
vriers
brûlés
non
ce g a z
n'amènerait
qu'une
gri-
en excès par rapport
de
l'acide
pour
les o u -
asphyxie
passagère
souvent sans gravité.
Ce d a n g e r d e s p o u s s i è r e s e n p r é s e n c e d e s
langes
mais on
explosifs
ne
s ' e n e s t p a s c o n t e n t é et o n a
leur attribuer
mé-
do g r i s o u est déjà t r è s g r a v e ,
voulu
d a n s les a c c i d e n t s u n rôle b e a u -
c o u p p l u s c o n s i d é r a b l e e n c o r e . A la s u i t e d e p u b l i c a t i o n s n o m b r e u s e s d e Al. G a l l u w a y ( ' ) e t d ' e x -
(') (HLI.OWAY, — On ihe influence of Coal Dust in collieries
explosion.
Proceedings of the Royal Society.
XXIV, 3 5 ' , ; XXXII, 4 0 4 ; XXXIII, 4 S et 4 o .
7
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
9
péi'ienccs
du
professeur A b e l (') en A n g l e t e r r e ,
b i e n d e s p e r s o n n e s o n t a d m i s q u e les p o u s s i è r e s
mêlées à l'air
pur
pouvaient
donner
naissance
à des explosions comparables par leur intensité
et l e u r d é v e l o p p e m e n t a u x v é r i t a b l e s e x p l o s i o n s
de g r i s o u . Mais cette o p i n i o n est contredite p a r
foutes les o b s e r v a t i o n s et
fisamment
les e x p é r i e n c e s
précises. P o u r soutenir
cette
suf-
théorie
on a d ' a b o r d i n v o q u é la f o r m a t i o n de c r o û t e s de
c o k e s u r les b o i s a g e s à l a s u i t e des
explosions;
m a i s il d o i t n é c e s s a i r e m e n t s ' e n i o r m e r
dans
la
distillation des poussières échauffées p a r la comb u s t i o n d u g r i s o u . O n a fait v a l o i r e n s e c o n d lieu
qu'avant u n g r a n d n o m b r e d'accidents considér a b l e s p e r s o n n e n ' a v a i t s i g n a l é d a n s la m i n e l a
présence de q u a n t i t é s
l'explication
exceptionnelles de grisou ;
beaucoup
plus
n a t u r e l l e de ce fait
est q u e d a n s les m i n e s e n q u e s t i o n o n n e se p r é o c c u p a i t n u l l e m e n t d e la c o n s t a t a t i o n
du grisou ;
p a s m ê m e d a n s les g a l e r i e s et m o i n s e n c o r e d a n s
les v i e u x
travaux. Aujourd'hui
q u ' u n très petit n o m b r e
de contrôle du
grisou
de
encore
il n ' y a
m i n e s où le s e r v i c e
commence
1
à
s'organiser
f ) ABEL. —. Some of dangerous properties
(Lecture delivered at the Ro?al Institution
Britain, a.t avril iSSa).
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
of dust
of Great
d ' u n e façon
convenable,
il n ' y e n a p a s o u l'on
se p r é o c c u p e de c o n n a î t r e la c o m p o s i t i o n de l'atmosphère
c o n t e n u e d a n s les v i e u x
travaux
et
remblais. Enfin, en troisième lieu, on a mis
avant
des
expériences faites
à
petite
en
échelle
s u r la c o m b u s t i b i l i t é des p o u s s i è r e s en a d m e t t a n t
qu'il devait y avoir proportionnalité entre l'intens i t é d e s effets o b t e n u s e t l e d é v e l o p p e m e n t
c o n d u i t s et galeries où la
dre.
Cette
flamme
proportionnalité
n'existe pas, car
résulte d'expériences faites a u x m i n e s de
que
la l o n g u e u r
des
pouvait s'étenil
Liévin
de flamme obtenue dans
une
galerie artificielle de u n
mètres de l o n g u e u r est
moindre
galerie
que
dans une
de 4 °
mètres.
L e s e x p é r i e n c e s faites p a r MM. M a l l a r d et Le
Chatelier (') s o u s les a u s p i c e s de la C o m m i s s i o n
du grisou ont m o n t r é d'autre part qu'il y
avait
u n t r è s p e t i t n o m b r e d e c h a r b o n s d o n t les p o u s sières mises en suspension d a n s l'air f o r m e n t des
m é l a n g e s c o m b u s t i b l e s ; q u e la f l a m m e s'y p r o pageait beaucoup
trop lentement
naissance à de véritables
pour
explosions,
donner
enfin
que
(!) MALLARD et L E CHATELIER. — Du rôle des poussières de houille dans les accidents de mines (PièceR
annexées aux procès-verbaux de la Commission du
grisou, 11, p. ?~o).
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
CAUSES
D'AGGRAVATION
DES
ACCIDENTS
l'addition à l'air de q u a n t i t é s de grisou
89
inférieu-
r e s à la l i m i t e d ' i n f l a m m a b i l i t é n ' a u g m e n t a i t p a s
d ' u n e façon b i e n a p p r é c i a b l e la c o m b u s t i b i l i t é d e s
p o u s s i è r e s ; le r é s u l t a t c o n t r a i r e q u i p o u v a i t s e m b l e r a priori
assez
vraisemblable
a v a i t été
af-
f i r m é à m a i n t e s r e p r i s e s , m a i s s a n s p r e u v e s suff i s a m m e n t p r é c i s e s . l i e m ê m e f a i t a été c o n t r ô l é
d e p u i s p a r des e x p é r i e n c e s faites p l u s e n
grand
p a r M . S i m o n , a u x m i n e s d e L i é v i n . E n o u t r e , la
discussion des accidents attribués a u x poussières
a montré que tous
les g r a n d s a c c i d e n t s se s o n t
p r o d u i t s d a n s des m i n e s t r è s g r i s o u t e u s e s et q u ' i l
a suffi p o u r e m p ê c h e r l e u r r é p é t i t i o n , a u x m i n e s
de B l a n z y , p a r e x e m p l e ,
d ' a m é l i o r e r la v e n t i l a -
t i o n , ce q u i n e p e u t d i m i n u e r le d a n g e r des p o u s sières. Les m i n e s à poussières très
ÏDllammables,
m a i s n o n g r i s o u t e u s e s , n ' o n t j a m a i s été le t h é â tre de g r a n d s accidents. Les i n f l a m m a t i o n s réelles d é p o u s s i è r e s s o n t t o u j o u r s très l i m i t é e s ,
explosives.
des coups de m i n e débourrants qui
simplement
non
E l l e s o n t t o u j o u r s été p r o d u i t e s p a r
enflamment
la p o u s s i è r e q u ' i l s a v a i e n t m i s e en
suspension.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
CHAPITRE II
P R E C A U T I O N S C O N T R E LES A C C I D E N T S
2 8 . G é n é r a l i t é s . — Le concours s i m u l t a n é de
trois causes distinctes étant indispensable
l a p r o d u c t i o n d ' u n a c c i d e n t , il s u f f i r a i t
pour
de
faire
d i s p a r a î t r e c o m p l è t e m e n t les c a u s e s d ' u n e
seule
espèce p o u r s u p p r i m e r
dents.
On
ne peut
d u m ê m e c o u p les acci-
songer à
annuler
complè-
t e m e n t les c a u s e s d e la g r a v i t é des a c c i d e n t s , o n
n e p o u r r a i t le f a i r e q u ' e n
r e t i r a n t les
en
M a i s il n e s e m b l e
i m p o s s i b l e a priori
supprimer
soit
les
pas
causes
cessant
ouvriers
d e la m i n e , c'est-à-dire
d'exploiter.
d'accumulation
g r i s o u , soit les c a u s e s d ' i n f l a m m a t i o n .
de
du
Pendant
l o n g t e m p s les efforts o n t é t é d i r i g é s v e r s la s u p -
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
p r e s s i o n d e s c a u s e s d ' i n f l a m m a t i o n ; la
décou-
v e r t e d e l a l a m p e d e s û r e t é p a r D a v y fit u n m o ment
espérer
q u e le r é s u l t a t , d é s i r é a l l a i t
atteint. Mais l'expérience n'est pas v e n u e
être
confir-
m e r ces p r é v i s i o n s ; si les a c c i d e n t s s o n t d e v e n u s
moins nombreux
sûreté,
ils
sont
d e p u i s l'usage des l a m p e s de
par
plus graves, à un
contre
devenus
beaucoup
p o i n t q u e l'on a été j u s q u ' à
p r é t e n d r e q u e la d é c o u v e r t e de D a v y n ' a v a i t fait
qu'augmenter
mines
suffit
de
les d a n g e r s de l ' e x p l o i t a t i o n
h o u i l l e . C'est là
pour
de rapprocher
du
n o m b r e da v i c t i m e s p r o d u i t e s p a r le g r i s o u
les
quantités
en
des
u n e e x a g é r a t i o n ; il
faire justice
de charbon
exploitées
annuellement
q u i , d e p u i s le c o m m e n c e m e n t d u s i è c l e , o n t é t é
en
rapidité extrême;
elles
ont p l u s q u e d é c u p l é et les accidents n ' o n t
croissant
avec u n e
heu-
r e u s e m e n t p a s s u i v i la m ê m e p r o g r e s s i o n .
Il
de
n'en
sûreté
est p a s m o i n s
en
permettant
certain
le
milieux é m i n e m m e n t grisoufeux
indirecte
de q u e l q u e s
mines. Toutes
grandes
les t e n t a t i v e s
exclusif la disparition
q u e la
travail
lampe
dans
a été la
des
cause
catastrophes
ayant
des causes
pour
de
objet
d'inflamma-
tion sont c o n d a m n é e s à rester é g a l e m e n t stériles.
11 e s t c e r t a i n q u ' à u n m o m e n t o u l ' a u t r e
une
n é g l i g e n c e se p r o d u i r a e t le b é n é f i c e r é s u l t a n t d e s
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
précautions prises qui a u r o n t retardé
pourra
être
p l u s g r a n d e d e cet a c c i d e n t .
les a c c u m u l a t i o n s
mettre
d ' u n e façon
ble d'annuler
gravité
On ne peut espérer
davantage arriver jamais à supprimer
ment
l'accident
e n p a r t i e c o m p e n s é p a r la
complète-
d u g r i s o u . Il f a u t
générale
qu'il
rigoureusement
d e s c a u s e s d ' a c c i d e n t s ; il f a u t
est
une
ad-
impossi-
quelconque
se c o n t e n t e r
réduire leur fréquence au m i n i m u m .
de
L'atténua-
t i o n s i m u l t a n é e de ces différentes c a u s e s
permet
d'ailleurs d'obtenir u n e sécurité déjà très g r a n d e ,
presqu'absolue.
chacune
C'est q u ' e n
effet,
si
isolément
des causes d ' a c c i d e n t se p r o d u i t
rarement,
assez
la probabilité de leur r e n c o n t r e ,
in-
dispensable pour u n accident, deviendra infinim e n t p e t i t e . P o u r fixer l e s i d é e s , s u p p o s o n s q u e
la fréquence
des accumulations de
équivalente à une accumulation
t o u t e la m i n e p e n d a n t
grisou
de g r i s o u
la
fréquence
soit équivalente
pendant
dans
une journée entière, sur
mille j o u r n é e s de travail ; s u p p o s o n s de
que
soit
des
causes
même
d'inflammation
à l ' e m p l o i d e l a m p e s à feu
nu
u n e j o u r n é e e n t i è r e s u r 1000 j o u r n é e s
d e t r a v a i l . L a p r o b a b i l i t é d e la r e n c o n t r e des acc u m u l a t i o n s d e g r i s o u et d e s l a m p e s à f e u
par
suite
la probabilité
d'un
accident sera
nu,
de
ÏOUDUOO . c ' e s t - à - d i r e q u ' i l se p r o d u i r a e n m o y e n n e
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
u n a c c i d e n t t o u s l e s ,'5ooo a n s ; c e l a p e u t p a s s e r
en
pratique
pour
une
sécurité absolue. Si, a u
c o n t r a i r e , o n n e s'est p r é o c c u p é q u e d e s c a u s e s
d'inflammation
mulation,
sans réduire
les causes
c ' e s t - à - d i r e si l ' o n
travaille
d'accunormale-
m e n t d a n s le g r i s u u c o m m e c e l a s ' e s t v u
d a n t t r o p l o n g t e m p s , d a n s les m i n e s de
pen-
houille,
e t se v o i t p a r f o i s e n c o r e , ce n ' e s t p l u s t o u s l e s
3ouo
ans
que
se
produira
un
accident,
mais
t o u s l e s t r o i s a n s . C ' e s t - à - d i r e q u e la s é c u r i t é s e r a
nulle, l'exploitation
d e v i e n d r a i m p o s s i b l e et la
m i n e d e v r a ê t r e a b a n d o n n é e . B i e n q u e l e s chiffres e m p l o y é s
d a n s ce calcul
soient de
fantai-
sie, ils n e d o i v e n t p a s s'écarter b e a u c o u p de la
réalité
des
faits
et d o n n e n t
d'une
façon
assez
e x a c t e les l i m i t e s d a n s l e s q u e l l e s p e u t se m o u voir la sécurité des m i n e s de h o u i l l e s u i v a n t les
soins apportés à leur exploitation.
29.
Précautions
contre
les
accumula-
t i o n s ç r r i s o u t e u s e s . — Si des p r é c a u t i o n s
doi-
v e n t ê t r e p r i s e s s i m u l t a n é m e n t c o n t r e les c a u s e s
d'inflammation
e t les c a u s e s d ' a c c u m u l a t i o n
du
g r i s o u , il s ' e n f a u t c e p e n d a n t q u e c e s d e u x o r dres de précautions
a i e n t le m ê m e d e g r é
cacité. L ' e n g o u e m e n t
p o u r les m e s u r e s
d'effipréven-
tives des causes d'inflammation qui a résulté de
la découverte de D a v y
et qui
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
a
été
entretenu
plus
récemment
p a r les t r a v a u x
des
Commis-
s i o n s d u g r i s o u a fait t r o p l o n g t e m p s n é g l i g e r l e s
p r é c a u t i o n s c o n t r e les a c c u m u l a t i o n s d u g r i s o u
qui peuvent
cependant
c o u p p l u s efficace.
tion
En
avoir u n e action
« ' o p p o s a n t à la
des a c c u m u l a t i o n s
façon
incomplète,
on
beau-
produc-
de grisou, m ê m e
diminue
à
d'une
la fois et
le
n o m b r e et la g r a v i t é des a c c i d e n t s ; en r é d u i s a n t
seulement
tion
la fréquence
on d i m i n u e bien
des causes
d'inflamma-
le n o m b r e des a c c i d e n t s
m a i s o n a u g m e n t e , p a r c o n t r e , c o m m e il n é t é d i t
plus haut, leur gravité en p e r m e t t a n t a u x
mulations
de
grisou de
devenir plus
accu-
considé-
rables.
C e s d e u x effets o p p o s é s s e c o m p e n s e n t p a r t i e l l e m e n t . D e p l u s les c a u s e s d ' i n f l a m m a t i o n s o n t h
la merci de centaines d'ouvriers
rants du
l'ait
danger,
et toujours
souvent
m ê m e de l ' h a b i t u d e ; la n a t u r e
s'oppose
à ce q u e
l'on
igno-
n é g l i g e n t s p a r le
des
puisse jamais
choses
compter
sur leur prudence. Les mesures a prendre
tre les a c c u m u l a t i o n s
contraire
nel
de
du
grisou
dépendent
au
à peu près exclusivement du person-
d i r i g e a n t de la m i n e a u q u e l on est en d r o i t
demander
des
garanties spéciales
g e n c e et de c a r a c t è r e . D e g r a n d e s
ont
con-
été
réalisées
dans
cette
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
voie
d'inlelli-
améliorations
depuis
une
vingtaine
d'années,
coup a gagner
persévérant
faire
dans
celte direction,
on arrivera
tuant
h
acci-
plusieurs centaines d'ouvriers
à la
a c c i d e n t s d o n t la f r é q u e n c e n ' a fait q u ' a u g -
menter
cupé
beau-
disparaître complètement les g r a n d s
dents
fois,
m a i s il r e s t e e n c o r e
e t il e s t p e r m i s d ' e s p é r e r q u ' e n
tant
qu'on
de p a r e r
s'est e x c l u s i v e m e n t
aux
causes
préoc-
d'inflammation
du
grisou.
P a r m i les m e s u r e s p r o p r e s
à éviter les acci-
d e n t s d u g r i s o u n o u s n ' é t u d i e r o n s ici e n d é t a i l q u e
celles q u i ont trait à l'inflammation
du
c'est-à-dire les m o i n s i m p o r t a n t e s . L e s
grisou,
mesures
b e a u c o u p p l u s efficaces q u i v i s e n t les a c c u m u lations du grisou
e t l a g r a v i t é d e s a c c i d e n t s se
r a t t a c h e n t e n effet d i r e c t e m e n t
à
l'exploitation
des m i n e s q u i fera d a n s cette E n c y c l o p é d i e l'obj e t d ' u n e é t u d e spéciale d o n t s'est c h a r g é M. D e lafond, I n g é n i e u r en chef des m i n e s . On n e fera
d o n c q u e r é s u m e r ici b r i è v e m e n t c e s d e r n i è r e »
mesures préventives.
30. Suppression des poussières de houille.
—
Les précautions à prendre pour atténuer
gravité
des
accidenta
sembleraient,
d'après
la
ce
qui a é t é d i t p l u s h a u t , d e v o i r être p r i n c i p a l e m e n t
d i r i g é e s c o n t r e les p o u s s i è r e s ; m a i s on n e v o i t
pas
jusqu'ici
de
procédé
réellement
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
efficace
p o u r l u t t e r c o n t r e ce d a n g e r . L ' e n l è v e m e n t des
poussières
d a n s toute la m i n e est é v i d e m m e n t
impossible ; on a proposé d'empêcher
lèvement
par
quantité d'eau
liante, elles ne
suspension
l'arrosage.
Mouillées
suffisante
pour former
leur souavec
pourraient plus être
une
une pâte
mises
en
d a n s l'air et e n c o r e m o i n s être b r û -
l é e s . S e u l e m e n t l e u r a r r o s a g e p o u r être efficace
devrait
ê t r e fait d a n s t o u t e la m i n e et e n
les p o i n t s
où
l e s p o u s s i è r e s se d é p o s e n t ,
b i e n s u r l e s o l d e s g a l e r i e s q u e s u r le
tous
aussi
chapeau
des b o i s a g e s et, en r a i s o n de l ' é v a p o r a t i o n r a p i d e
r é s u l t a n t de la circulation de l'air, cet arrosage
devrait être répété t o u s les j o u r s . L e poids d'eau
à répandre ainsi pour compenser
peut être estimé à 1 %
c u l e d a n s la m i n e , soit p o u r u n
par seconde,
à
l'évaporation
du poids d'air qui ciraérage de 5o"'
4<>ooo k i l o g r a m m e s p a r
3
vingt-
q u a t r e h e u r e s . D a n s toutes les tentatives
faites
jusqu'ici, on n'a e m p l o y é q u e des quantités infinitésimales d'eau qui ne pouvaient avoir a u c u n
elîot u t i l e .
Les
seuls
procédés
pratiques pour
atténuer
la g r a v i t é des accidents consistent à disposer les
t r a v a u x et l e u r
a é r a g e i n t é r i e u r de façon
cas d'explosion
le p l u s
petit
nombre
d'ouvriers soient atteints simultanément.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
qu'en
possible
Puis-
q u e t o u t o u v r i e r s e t r o u v a n t s u r le p a s s a g e d e s
gaz produits
p a r u n e explosion est n é c e s s a i r e -
ment
on devra toujours
perdu,
renvoyer
l'air
s o r t a n t des r é g i o n s grisouteuses de la m i n e
par
la voie la p l u s directe a u x p u i t s du r e t o u r
d'air
s a n s j a m a i s lui faire s u i v r e les voies de r o u l a g e ,
ou t o u t a u t r e p a r t i e d e la m i n e où les o u v r i e r s
séjournent
normalement.
En
second
lieu,
m i n e devra être divisée en u n e série de
tiers i n d é p e n d a n t s aérés c h a c u n
par une
la
quarsubdi-
vision distincte du c o u r a n t d'air principal. Enfin
il f a u t
s'arranger
l'aérage
pour
(m'en cas d'explosion,
ne puisse pas être c o m p l è t e m e n t
sus-
p e n d u d a n s t o u t e la m i n e par la destruction
des
p o r t e s e t b a r r a g e s q u i s e r v e n t à d i r i g e r le c o u rant
d'air.
Cette
permanence
de la
ventilation
a p r è s u n a c c i d e n t n e p e u t en g é n é r a l ê t r e o b t e n u e
q u ' a v e c l'aérage d i a g o n a l d a n s l e q u e l les
puits
sont
placés
aux
deux
extrémités opposées
c h a m p d ' e x p l o i t a t i o n . Il e s t t h é o r i q u e m e n t
sible
de
l'obtenir
également
avec
deux
du
pos-
puits
v o i s i n s d a n s l e c a s d e c o u c h e s i n c l i n é e s . 11 s u f f i t
d e l a i s s e r e n t r e les p u i t s et les g a l e r i e s d ' a é r a g e
qui
y aboutissent
quelques
mètres
u n e é p a i s s e u r de r o c h e r
qui
est
plus
que
de
suffisante
p o u r résister à t o u t e s les e x p l o s i o n s . Mais en fait,
l o r s q u e les p u i l s s o n t v o i s i n s , on établit t o u j o u r s
I.K
CuiTKLipR —
Grisou
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
7
e n t r e e u x p o u r les c o m m o d i t é s d e
l'exploitation
des c o m m u n i c a t i o n s directes qui ne sont j a m a i s
fermées
que
d'une
façon
tout
à
fait
précaire
par des portes en bois.
3 1 . V e n t i l a t i o n d e s m i n e s . — Les mesures
propres à éviter
les
accumulations
de
s e r é d u i s e n t t o u t e s à u n e ventilation
faite
que possible des
faites
pour absorber
é c h o u é , et ce q u e
miques
travaux.
ou
l'on
Les
par-
tentatives
d é t r u i r e le g r i s o u
sait
de ce corps p e r m e t
sera certainement
grisou
aussi
ont
des propriétés chid'affirmer
qu'il en
longtemps,vraisemblabIerneut
m ê m e toujours ainsi.
La quantité d'air
nécessaire
pour
rendre
le
g r i s o u inexplosif doit être telle q u e la p r o p o r t i o n
de grisou d a n s le m é l a n g e soit inférieure à 6
B
/ .
0
M a i s s i l ' o n sa t e n a i t p r è s d e c e t t e l i m i t e p o u r l a
c o m p o s i t i o n d e l'air s o r t a n t d e la m i n e , on p o u r rait être certain q u e d a n s l'intérieur des travaux
l'atmosphère
serait
qui pénètre dans
partout
la m i n e
qu'une partie qui
explosive. De
arrive jusqu'aux
des e x p é r i e n c e s faites a u x m i n e s
en
Belgique,
une
|
proportion
ont
donné
d e 36 ° / .
0
l'air
il n ' y e n a , e n e t l e t ,
pour
de
chantiers;
l'Agrappe,
la p e r t e
C'est-à-dire
que
d'air
les
s e u l e m e n t de l'air p a r c o u r a i e n t réellement les
t r a v a u x t a n d i s q u e le d e r n i e r t i e r s s e r e n d a i t d i -
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
rectement
du
puits
d'entrée au
puits de sortie
d'air. E n A n g l e t e r r e , la perte a été trouvée p l u s
forte
encore
et dépasse parfois
'/„. Enfin
5o
d é g a g e m e n t d u grisou est irrégulier d ' u n
à l'autre de la m i n e et la p r o p o r t i o n
le
point
moyenne
de grisou observée à la sortie, résulte des c o m p e n s a t i o n s q u i se p r o d u i s e n t e n t r e d e s m é l a n g e s
les u n s p l u s g r i s o u t e u x , les a u t r e s m o i n s g r i s o u l e u x q u e la m o y e n n e .
tions de grisou
l'air
renferme
Pour
éviter les a c c u m u l a -
d a n s l a m i n e , il f a u t d o n c q u e
beaucoup
moins
de
G °/
de ce
0
gaz à la sortie. S a n s qu'il soit possible de
fixer
u n chiffre a b s o l u , il s e m b l e q u ' e n se t e n a n t a u x
e n v i r o n s d e o,5
%
de grisou
on
soit
actuelle-
m e n t dans des conditions convenables. Une ten e u r de o,i
B
/
0
serait u n résultat magnifique q u i
n'est c e r t a i n e m e n t j a m a i s atteint d a n s les
g r i s o u t e u s e s les m i e u x
1
"/„
ques
qui
correspond
retours
ventilées. La
toujours,
d'air p a r t i c u l i e r s
pour
des
0
quel-
quartiers
les p l u s g r i s o u t e u x , à des t e n e u r s d ' a u
2 °/
mines
t e n e u r de
moins
q u i ne doivent pas être dépassées, est u n e
l i m i t e q u ' i l n e faut j a m a i s a t t e i n d r e .
La
fixation
cessaire
dans
du volume
une
mine
d'air
minimum
grisouteuse
ne peut être déterminée d'une façon
né-
donnée
rationnelle
q u e d ' a p r è s la m e s u r e d e l a q u a n t i t é d e g r i s o u
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
rjui s e d é g a g e . Ces o b s e r v a t i o n s
grisouinétriques
d ' u n e i m p o r t a n c e capiLale p o u r la s é c u r i t é , d e v r a i e n t élre faites
quotidiennement
dans toutes
l e s m i n e c g r i s o u t e u s e s , il f a u t e s p é r e r q u ' à b r e f
délai ce p r o g r è s s e r a r é a l i s é d ' u n e
rale.
Mais
grisoumétriques
tuent u n e infime minorile.
d'air
tente de
géné-
a u j o u r d ' h u i les m i n e s o ù l'on fait d e s
observations
volume
façon
minimum
procédés
sérieuses
consti-
Pour déterminer
nécessaire, on
empiriques
qui
le
se con-
consistent à
é t a b l i r u n e r e l a t i o n d é t e r m i n é e e n t r e le v o l u m e
d'air
n é c e s s a i r e et la q u a n t i t é de h o u i l l e e x t r a i t e
o u le n o m b r e d ' o u v r i e r s
demment une
corrélation
d u grisou et l'extraction,
nombre d'ouvriers.
haut à propos du
Mais
employés.
e n t r e le
et p a r
11 y
a évi-
dégagement
suite aussi
le
les chiffres cilés p l u s
dégagement
du grisou
mon-
t r e n t q u e , d ' u n e m i n e à l ' a u t r e , la r e l a t i o n
en-
tre ces d e u x g r a n d e u r s est t r è s v a r i a b l e , e t de p l u s
q u e d e g r a n d e s v a r i a t i o n s d a n s l'activité d e l'extraction d ' u n e m i n e ne font q u e très p e u varier
le d é g a g e m e n t d u g a z .
Ces r é s e r v e s faites o n p e u t d o n n e r c o m m e v o l u m e d'air
m i n i m u m n é c e s s a i r e p o u r les
mines
très g r i s o u t e u s e s les chiffres de :
ino
litres p a r seconde p o u r 1 t o n n e
p a r ?. \ h e u r e s .
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
extraite
L'administration des mines françaises d e m a n d e
u n n o m b r e de m è t r e s c u b e s d'air p a r s e c o n d e c o m p r i s e n t r e yg e t
de l'extraction j o u r n a l i è r e ; en
Belgique cette limite descend j u s q u ' a u ~ ,
mais
en m ê m e
pays
lernps on r e c o m m a n d e d a n s ce
de ne pas
descendre pour
chaque
ouvrier
du
p o s t e l e p l u s o c c u p é a u - d e s s o u s d e 3o à :5o l i t r e s
d'air passant réellement au
chantier.
Si l ' o n s e r e p o r t e a u x e x p é r i e n c e s d e l a C o m mission
prussienne
du
p o u r le d é g a g e m e n t d e
riant de i o °
3
à
mS
yo
grisou
qui
ont
donné,
ce g a z , des c h i l î r c s
par
va-
t o n n e de houille,
voit q u e la p r o p o r t i o n de
^
ou
100 l i t r e s
on
d'air
p a r t o n n e donnerait au puits de sortie u n m é l a n g e
r e n f e r m a n t d e 0,1 ° /
0
à 0,8 ° /
0
ce q u i r e n t r e b i e n
d a n s les p r o p o r t i o n s a d m i s s i b l e s .
Pour
assurer l'aérage des mines
grisouteuses
l ' e m p l o i d e v e n t i l a t e u r s m é c a n i q u e s est s e u l a d missible.
L'insuffisance
et
l'irrégularité
v e n t i l a t i o n n a t u r e l l e , les d a n g e r s d e la
tion p a r foyer doivent faire
de
la
ventila-
proscrire d'une
fa-
çon absolue leur usage.
Ces p r o c é d é s
barbares
d'aérage
complètement
disparu
auront bientôt
dos m i n e s g r i s o u t e u s e s en F r a n c e .
M a i s le fait d ' e n v o y e r d a n s la m i n e u n e q u a n tité d ' a i r s u f f i s a n t e p o u r d i l u e r le g r i s o u n e suffit
p a s à l u i seul p o u r éviter les a c c u m u l a t i o n s
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
de
g r i s o u , il f a u t
e n c o r e le d i r i g e r v e r s
tous
les
p o i n t s o ù le g r i s o u s e d é g a g e e t n e p a s le l a i s s e r
se r e n d r e par u n
d'entrée au
chemin
puits
de
quelconque
sortie
b e a u c o u p l e p o i n t le p l u s
d'air.
du
C'est
puits
là
de
délicat de la ventila-
t i o n et q u i l a i s s e e n c o r e b e a u c o u p à d é s i r e r d a n s
un trop grand n o m b r e de mines.
Par
le
fait d e s
nécessités de
toute m i n e est sillonnée
l'exploitation,
de galeries en
nombre
c o n s i d é r a b l e e n t r e l e s q u e l l e s l'air t e n d à se p a r tager, en s u i v a n t de préférence
celles q u i
s e n t e n t le p l u s c o u r t c h e m i n d u
puits
pré-
d'arrivée
au p u i t s de sortie d'air. P o u r l'obliger à passer
p a r les t r a v a u x neufs q u i c o n s t i t u e n t
m e n t la v o i e d e p l u s
obligé
grande
générale-
résistance, on
est
de f e r m e r les a u t r e s i s s u e s a u m o y e n de
p o r t e s d o n t le f o n c t i o n n e m e n t est
précaire.
Kilos
ne
toujours
très
sont jamais étanebes,
sont
f r é q u e m m e n t o u v e r t e s p o u r les b e s o i n s de l'exploitation et p e u v e n t m ê m e ,
par
inadvertance,
être laissées c o m p l è t e m e n t ouvertes p e n d a n t
un
t e m p s assez l o n g .
Pour
atténuer
autant
que possible
l'effet
de
c e s n é g l i g e n c e s i n é v i t a b l e s , il f a u t o r g a n i s e r l e s
t r a v a u x de façon
nombre
de
portos
à avoir besoin du
possible,
et
à
plus petit
conserver,
m ê m e pendant leur ouverture, une certaine ven-
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
t i l a t i o n d a n s t o u s les q u a r t i e r s
deux conditions exigpnt
d e la m i n e . Ces
q u e les voies les p l u s
courtes où l'air p e u t passer lui o p p o s e n t déjà u n e
r é s i s t a n c e n o t a b l e , q u i n e soit p a s t r o p faible p a r
r a p p o r t à celle d u c i r c u i t n o r m a l . O n est forcément
conduit
à la d i s p o s i t i o n
connue sous
le
n o m d ' a é r a g e d i a g o n a l , d o n t l ' i m p o r t a n c e a été
d é j à r e c o n n u e p l u s h a u t a u p o i n t d e v u e d e l'att é n u a t i o n d e la g r a v i t é d e s a c c i d e n t s . E n f i n
les
portes doivent être a u m o i n s doubles et p o u r v u e s
do systèmes
mécaniques
d'enclanchement
rendent impossible l'ouverture
simultanée
qui
des
deux.
L ' a i r a m e n é d a n s les t r a v a u x e n a c t i v i t é d o i t
encore être conduit j u s q u ' a u front de taille q u i
e s t t o u j o u r s le s i è g e d ' u n d é g a g e m e n t n o t a b l e d e
grisou.
Le déplacement continuel
du front
t a i l l e p a r le f a i t d e l ' a b a t a g e c o m p l i q u e
de
consi-
d é r a b l e m e n t c e t t e t r o i s i è m e p h a s e d e la v e n t i l a t i o n q u i n ' e s t p a s m o i n s i m p o r t a n t e q u e les d e u x
précédentes. L'aérage
chantiers ainsi que
ventilateurs
à
bras,
par
s i m p l e diffusion
leur aérage au
doivent
être
moyen
des
de
absolument
p r o s c r i t s d a n s les m i n e s g r i s o u t e u s e s ,
particu-
l i è r e m e n t d a n s les t r a v a u x en r e m o n t e . Ces p r o c é d é s , t o u t à fait i n s u f f i s a n t s p o u r é v i t e r l e s a c c u m u l a t i o n s d e g r i s o u , o n t été la c a u s e d ' u n si
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
g r a n d n o m b r e d ' a c c i d e n t s q u ' o n s ' é t o n n e de les
rencontrer encore dans certaines mines grisout e u s e s . Si p a r l a d i s p o s i t i o n d e s t r a v a u x le c o u rant d'air ne vient pas
lécher
f r o n t d e t a i l l e , il f a u t l'y
n a t u r e l l e m e n t le
amener
en totalité ou
en partie au m o y e n , soit de c l o i s o n n e m e n t s divisant en deux l'ouvrage,
ques, ou
soit de t u y a u x m é t a l l i -
mieux y conduire
l'air au m o y e n
de
v e n t i l a t e u r s secondaires actionnés p a r l'air c o m primé, comme
c e l a se f a i t à B l a n z y . C e l t e
der-
n i è r e d i s p o s i t i o n a le g r a n d a v a n t a g e d e n e p a s
e x i g e r de nouvelles portes et de ne pas a u g m e n t e r la r é s i s t a n c e d u c i r c u i t g é n é r a l d ' a é r a g e . E l l e
a par contre l'inconvénient d'être exposée à des
arrêts accidentels.
T o u t e s ces p r e s c r i p t i o n s s ' a p p l i q u e n t
a u x tra-
v a u x neufs, des précautions semblables sont n é cessaires p o u r les v i e u x t r a v a u x o ù les
lations de grisou sont d'autant plus
accumu-
redoutables
q u ' o n n'est pas averti de leur présence. Mais cette
q u e s t i o n des v i e u x t r a v a u x est e n c o r e
l'inconnu
et t r o p s o u v e n t on n é g l i g e de s'en o c c u p e r .
point
de
vue
de la s é c u r i t é
Au
c'est actuellement,
d a n s les m i n e s q u i p a s s e n t p o u r b i e n t e n u e s le
p o i n t d e b e a u c o u p l e p l u s f a i b l e . Il s e m b l e
que
l e s e u l p r o c é d é e f f i c a c e c o n t r e le d a n g e r d e s v i e u x
t r a v a u x soit l e u r r e m b l a y a g e c o m p l e t ; l e s r e m b l a i s
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
d o i v e n t en o u t r e p e n d a n t les p r e m i e r s m o i s
qui
s u i v e n t l e u r m i s e e n p l a c e et j u s q u ' à l e u r t a s s e m e n t complet être ventilés
par
des galeries r é -
servées au milieu d ' e u x et pas trop distantes l ' u n e
de l'autre. Sous a u c u n prétexte on ne doit aband o n n e r au milieu des r e m b l a i s des galeries
non
remblayées qui pourront même, plusieurs années
après l'exploitation,
précautions
ont
se r e m p l i r
de grisou.
une importance
les c o u c h e s m i n c e s ,
capitale
Ces
dans
surtout lorsqu'il existe
voisinage des n i v e a u x
au
g r i s o u l e u x d u s à la p r é -
sence de petites couches n o n
exploitées ; elles
ont une
d a n s les
importance moindre
couches
épaisses o ù les r e m b l a i s n e sont j a m a i s très éloig n é s des galeries et s o n t ainsi aérés p a r
sion. Cette ventilation
les m i n e s
sujettes
diffu-
des r e m b l a i s exige, d a n s
aux
incendies,
que tout
le
c h a r b o n soit enlevé avec g r a n d soin et qu'il n ' e n
reste p a s d a n s les v i e u x t r a v a u x .
Toutes
les p r é c a u t i o n s
c o n t r e les a c c u m u l a -
t i o n s de g r i s o u et la g r a v i t é
des
accidents
sont
difficiles à r é a l i s e r , p a r c e q u ' e l l e s d é p e n d e n t
de
la disposition g é n é r a l e des t r a v a u x qu'il est fort
difficile
de modifier
l o r s q u ' i l s o n t été u n e fois
m a l e n g a g é s . Mais ces p r é c a u t i o n s ,
lorsqu'elles
ont été c o n v e n a b l e m e n t prises, assurent u n e s é curité très g r a n d e , b e a u c o u p plus g r a n d e
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
qu'on
n e serait tenté de
aux
incidents
le c r o i r e q u a n d o n
imprévus
qui
peuvent
réfléchit
acciden-
t e l l e m e n t les p a r a l y s e r . L ' e x p é r i e n c e est là p o u r
é t a b l i r d ' u n e f a ç o n f o r m e l l e q u e les g r a n d s accid e n t s de g r i s o u o n t t o u j o u r s d i s p a r u d ' u n e façon
c o m p l è t e dès q u e la v e n t i l a t i o n a été
suffisam-
m e n t o r g a n i s é e . On l'a v u d a n s le b a s s i n h o u i l l e r
d u Gard d ' a b o r d et plus r é c e m m e n t à B l a n z y .
32.
Indicateurs
tionnement
de
la
convenablement
du
grisou.
ventilation
réglé,
une
—
Le
fonc-
exige, p o u r être
connaissance
pré-
c i s e d e s q u a n t i t é s d e g r i s o u q u i se d é g a g e n t , s o i t
dans l'ensemble
de la
m i n e , soit en
ses
diffé-
rents points. De n o m b r e u x appareils indicateurs
d e g r i s o u o n t été p r o p o s é s d a n s ce b u t . L e s s e u l s
q u i soient r é e l l e m e n t p r a t i q u e s u t i l i s e n t la c o m bustibilité du grisou. Tous ceux qui reposent sur
l a d i f f é r e n c e d e d e n s i t é d e ce g a z e t d e l ' a i r ( b a lance hydrostatique, appareil à endosmose,tuyau
sonore) ne d o n n e n t q u e des indications très i n certaines parce qu'ils sont également
influencés
p a r la p r é s e n c e d e l ' a c i d e c a r b o n i q u e , et p a r les
variations
de
pression
et
de
température
de
l'air.
L a c o m b u s t i o n du grisou p e u t être utilisée de
b i e n d e s f a ç o n s p o u r r e c o n n a î t r e e t d o s e r ce g a z .
On peut d'abord, par une véritable analyse chi-
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
i n i q u e , d o s e r l'eau et l'acide c a r b o n i q u e p r o d u i t s ;
ce p r o c é d é ,
le s e u l
rigoureusement
exact,
ne
peut s'appliquer facilement qu'à des échantillons
d'air
r a p p o r t é s a u l a b o r a t o i r e . O n p e u t , e n se-
cond lieu,
observer la flamme
combustion du gaz qui donne
bleue d u e à la
une auréole plus
o u m o i n s g r a n d e a u t o u r d e l a flamme d e s l a m p e s .
Ces i n d i c a t i o n s moins p r é c i s e s o n t le g r a n d a v a n tage de
pouvoir
se faire d i r e c t e m e n t
dans
la
m i n e . Enfin on a proposé divers procédés q u i ne
sont pas encore pratiques m a i s q u i p o u r r o n t le
devenir, d a n s lesquels la combustion d u
grisou
s e m a n i f e s t e p a r l ' i n c a n d e s c e n c e d ' u n fil d e p l a tine,
traversé par u n courant
électrique,
par
l ' a l l o n g e m e n t d e la f l a m m e d e s l a m p e s , e t c .
Les analyses
du grisou
peuvent
d'abord se
f a i r e c o m m e c e l l e de t o u s l e s g a z p a r l a m é t h o d e
v o l u r n é t r i q u e , e n m e s u r a n t les c h a n g e m e n t s d e
volume
qui résultent,
soit
s i m p l e , soit de l'absorption
de l a
combustion
do l'acide carboni-
q u e . M. C o q u i l l o n a i n d i q u é , p o u r la c o m b u s t i o n
des m é l a n g e s g a z e u x très p a u v r e s , l'emploi d ' u n e
s p i r a l e de p a l l a d i u m i n c a n d e s c e n t e e t a p r o p o s é
s o n e m p l o i p o u r le d o s a g e d u g r i s o u . M a i s l ' a p p a r e i l q u ' i l a c o n s t r u i t n e se p r ê t e p a s à d e s m e sures précises, en raison de l'emploi
pour
la
mesure des gaz d'eau qui dissout inévitablement
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
u n e p a r t i e île l ' a c i d e
carbonique
formé,
et p u r
s u i t e de l ' a b s e n c e de. p r é c a u t i o n s c o n t r e l e s v a r i a t i o n s de t e m p é r a t u r e . C e t
rendu
beaucoup
appareil
plus précis
sans
(*) p e u t
être
devenir
plus
c o m p l i q u é . E n p r e m i e r lieu, la spirale de pallad i u m employée pour des motifs théoriques
très
contestables, doit être remplacée par u n e spirale
d e p l a t i n e . Ce m é t a l ,
moins
fusible,
peut
être
chauffé
à
une températu replus
élevée
rend
qui
plus
rapide
la
combustion
des gaz. La
m e s u r e des
g a z doit se
faire
le m e r c u r e
d'une
et
masse
l'invariabilité
donne
ble
la
dans
le
mesureur
doit
pour
assurer
d'eau
suffisante
température.
disposition
d'un
lequel
détermine
de p r e s s i o n q u i
entouré
de
sa
on
résulte
de
sur
être
La
appareil
la
ftq.
5
semblavariation
la c o m b u s t i o n à vo-
(') H . L E CMATEI.IER. — Sur le dosage
(Annales des Mines, 189^).
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
du grisou.
—
liime constant du grisou. U n e pointe qui
le m e r c u r e
sert de point
ner, après combustion,
affleure
de repère p o u r rame-
le v o l u m e de la
masse
g a z e u s e à sa v a l e u r i n i t i a l e . L a s p i r a l e de p l a t i n e
est c o m p o s é e
de
6 spires
de 3 m i l l i m è t r e s
de
, m
d i a m è t r e f a i t e s a v e c u n fil d e o " , 3 d e d i a m è t r e .
En employant l'alliagePt
3 % C u , d o n t la r é s i s -
t a n c e c o n s i d é r a b l e est, s o u s le d i a m è t r e de o
de i "
h m
m m
,3,
, 3 p a r d é c i m è t r e d e l o n g u e u r il f a u t , p o u r
p o r t e r l e fil a u r o u g e b l a n c , u n c o u r a n t d e 6 a m p è r e s . L a c o m b u s t i o n est t e r m i n é e au b o u t d ' u n e
durée d'incandescence
d'une
demi-minute
doit être i n t e r r o m p u e p a r u n e période de
dissement pour assurer
le b r a s s a g e
qui
refroi-
des gaz
et
l e u r p a s s a g e s u r la s p i r a l e . L a v a r i a t i o n d e p r e s sion observée est de
i5
millimètres de mercure
p o u r î "/„ d e g r i s o u .
Un second
p r o c é d é (*),
aussi
précis
que
précédent, p e r m e t , avec des appareils p l u s
ples
tités
e n c o r e , d e f a i r e le d o s a g e
de
g r i s o u . Il
repose
sur
de petites
la m e s u r e
le
simquandes
l i m i t e s d ' i n f l a m m a b i l i t é , son p r i n c i p e est d û à
u n a m é r i c a i n , M. S h a w .
( ' ) H . L E CHATELIER. — Sur le dosage du
grisou
par les limites
d'inflammabilité.
— (Annales des
Mines, 1891, 8 s. XIX, p. 3yfi.
e
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
La proportion d'un
gaz c o m b u s t i b l e , du
gaz
d'éclairage par exemple, qu'il faut ajouter
à
l'air
d'in-
grisouteux
pour
atteindre
la l i m i t e
ilammabilité, est évidemment d'autant
de
moindre
q u ' i l r e n f e r m e déjà p l u s de g r i s o u .
L e v o l u m e x d e g r i s o u c o n t e n u d a n s 100
vo-
l u m e s d e l ' a i r d e la m i n e est a l o r s d o n n é p a r la
formule
en a p p e l a n t :
n , le v o l u m e d u gaz c o m b u s t i b l e ajouté à l'air
de la
mine
pour
avoir
i n o volumes d'un
mé-
l a n g e à la l i m i t e d e c o m b u s t i b i l i t é ;
X , le v o l u m e d u m ê m e g a z q u ' i l f a u t
à de l'air p u r p o u r
avoir
100
ajouter
volumes
de
mé-
l a n g e à la l i m i t e d e c o m b u s t i b i l i t é .
Pour
effectuer
ces
essais, on
se
sert
d'une
éprotivette en verre de 35 m i l l i m è t r e s de d i a m è t r e i n t é r i e u r 200 m i l l i m è t r e s d e l o n g u e u r , e t r é trécie
pour
à sa partie
qu'il
inférieure
soit possible
à
20
millimètres
de la fe rm e r
p o u c e . E l l e esL p r o l o n g é e à s a p a r t i e
avec
le
supérieure
p a r u n t u b e p l u s é t r o i t d e 10 m i l l i m è t r e s d e d i a m è t r e et
25»
m i l l i m è t r e s d e l o n g u e u r (fi g.
6)·
L e v o l u m e d u m é l a n g e g a z e u x est l i m i t é p a r u?i
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
trait tracé à Γιο millimetres au-dessus de l'orifice
inférieur ; le tube supérieur est divisé en j ~ de
ce volume. L'éprouvette étant remplie du mélange gazeux, on en ferme le bas
p;„ s
avec le pouce, puis on la retourne et
l'agite en tous sens pour rendre le
mélange bien homogène. Ensuite on
la relève dans sa position primitive
en attendant que l'on soit prêt à provoquer l'inflammation. Alors on la
in
retourne
ment
on
brusquement
oii
écarte
Veau
et
arrive
le pouce
au
dans
sans
le
aucun
mobas,
re-
on introduit franchement dans
l'orifice une allumette en feu ou
une petite flamme de gaz. Si le mélange est combustible, une flamme
bleu pale descend jusqu'au fond de
l'éprouvette, sinon on ne voit rien
se produire. L'incertitude sur la teneur en gaz déterminée par cette
méLhode n'atteint pas
du volume
total à condition de se conformer
\
strictement aux indications données
plus haut et qui sont indispensables pour éviter
les combustions incomplètes au voisinage de la
limite d'inflammabilité.
tard,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
dans
la
m i n e on s'est servi j u s q u ' i c i e x c l u s i v e m e n t
Pour
l'estimation
rapide
du
grisou
de
l ' a u r é o l e b l e u e q u e la p r é s e n c e d e ce g a z p r o d u i t
a u t o u r de la f l a m m e des l a m p e s . Cette
qui
accuse
la
combustion
q u e les m é l a n g e s
tement
auréole
d u gaz est d u e à ce
trop p a u v r e s p o u r être
inflammables
le
deviennent
direc-
lorsqu'ils
sont échauffés à u n e t e m p é r a t u r e suffisante
par
la f l a m m e . Cette auréole est d ' a u t a n t p l u s g r a n d e
q u e le m é l a n g e
est p l u s r i c h e
v o l u m e de la f l a m m e
e n g a z et q u e le
e s t p l u s g r a n d . .Mais e l l e
est très p e u b r i l l a n t e et n ' e s t p a s visible
l'œil
est ébloui par
lorsque
le v o i s i n a g e d ' u n e
flamme
éclairante. T o u s les artifices q u i p r o c u r e n t
avec
ce p r o c é d é u n e c e r t a i n e s e n s i b i l i t é c o n s i s t e n t ii
d i m i n u e r l'éclat d e s f l a m m e s ou à les
masquer
p a r des é c r a n s et des v e r r e s a b s o r b a n t s . L e s e x p é r i e n c e s f a i t e s p a r M M . M a l l a r d et L e C h a t e l i e r ( ' )
sous
les auspices
d e la C o m m i s s i o n d u g r i s o u ,
o n t m o n t r é q u e l'on p o u v a i t , p a r ce p r o c é d é , o b t e n i r les r é s u l t a t s s u i v a n t s :
En employant
la
flamme
de l ' h y d r o g è n e
a le g r a n d a v a n t a g e d ' ê t r e à la fois t r è s
(*)
MALI.ARD
et
LE CHATKLIF.R. —
Sur
les
qui
chaude
procédés
propres à déceler la présence du grisou dans
l'atmospheres des mines (Annales d e s Mines, 7 série, XIX, p.
18S).
0
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
et
pas
le
grisou
éclairante,
à
partir
on
reconnaît
facilement
de j °/ . Mais j usqu'ici
n'a pas
trouvé de procédés pratiques pour
cendre
dans
la
on
0
mine
des
lampes
à
des-
hydro-
gène.
L a f l a m m e de l'alcool très p e u é c l a i r a n t e , m a i s
un peu
m o i n s c h a u d e q u e celle de l ' h v d r o g è n e ,
p e r m e t d e r e c o n n a î t r e le g r i s o u d i f f i c i l e m e n t
partir
de i ,
facilement
à
partir de \ "/„.
lampe indicatrice du grisou
à
Une
fondée s u r ce
prin-
cipe a été réalisée u l t é r i e u r e m e n t p a r u n
Alle-
m a n d n o m m é Pieler. Elle c o m m e n c e à être
très
r é p a n d u e d a n s les h o u i l l è r e s o ù elle p e r m e t
un
c o n t r ô l e r a p i d e d e t o u s les r e t o u r s d'air ; m a i s
elle n e doit p a s être m a i n t e n u e
ges
renfermant
s'échauffe
Elle
plus
3 °/
considérablement
cesse d ' a i l l e u r s
donner
de
des
d a n s les
de
0
et
gaz,
elle
l'alcool distille.
à ces t e n e u r s
indications
mélancar
précises.
élevées
La
de
hauteur
des a u r é o l e s p o u r c h a q u e t e n e u r en g a z p e u t var i e r d u s i m p l e a u d o u b l e s u i v a n t le r é g l a g e
de
la m è c h e de la l a m p e . E n f i n
de
la t e m p é r a t u r e
l ' a t m o s p h è r e o ù e l l e e s t p l o n g é e , l a n a t u r e e t le
d e g r é de l'alcool e m p l o y é s e m b l e n t avoir u n e inf l u e n c e très m a r q u é e s u r ses i n d i c a t i o n s . Il
faut
d o n c d a n s c h a q u e h o u i l l è r e faire u n e g r a d u a t i o n
spéciale d e la l a m p e P i e l e r a u
L i CILLTELIEH — G r i s o u .
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
moyen
de
quel$
q u e s analyses des a t m o s p h è r e s grisouteuses dans
lesquelles elle a été o b s e r v é e .
M. C h e s n e a u ,
ingénieur
des Mines, a r é c e m -
m e n t apporté des p e r f e c t i o n n e m e n t s
importants
a. l a l a m p e à a l c o o l . E n a j o u t a n t u n p e u d e c h l o rure
de
c u i v r e h l'alcool
il
a rendu
l'auréole
b e a u c o u p p l u s b r i l l a n t e et p a r t a n t p l u s visible.
E n f i n , p a r u n d i s p o s i t i f i m i t é de la l a m p e F u m â t ,
il a o b t e n u l ' e x t i n c t i o n c e r t a i n e do la l a m p e d a n s
les m é l a n g e s explosifs ce q u i a u g m e n t e b e a u c o u p
son d e g r é de sécurité.
Les flammes des lampes à huile employées pour
l'éclairage ordinaire
d a n s les m i n e s
brillantes p o u r laisser apercevoir
les e n t o u r e .
Mais en
baissant
sont
trop
l'auréole
m è c h e p o u r r é d u i r e la h a u t e u r de
flamme
ingénieur
c o m m e l'a i n d i q u é M.
principal
des
mines
de
la
à 3 ou
4 millimètres ou en l'écrasant s i m p l e m e n t
le p o r t e - m è c h e ,
qui
suffisamment
avec
Fumât,
la
Grand
C o m b e , la f l a m m e p e r d t o u t p o u v o i r é c l a i r a n t e n
devenant bleu
pâle. Elle laisse alors
apercevoir
u n e petite auréole difficilement visible à
de
2 %
4 %·
et t r è s
Pratiquement
avec un
grisou
facilement
peu
à
partir de
conserve à
dans
d'habitude
la
visible
les m i n e s
à
on
de
arrive
r e c o n n a î t r e a i n s i le
teneur de
la l a m p e u n e
partir
à partir
flamme
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
3 %•
un
peu
Si
on
plus
g r a n d e q u i p r é s e n t e alors u n p o i n t b r i l l a n t à son
s o m m e t , o n p e u t , e n la p l a ç a n t e n t r e d e u x é c r a n s
dont l'un masque
à l ' o b s e r v a t e u r la f l a m m e
et
l ' a u t r e p r é s e r v e do t o u t é c l a i r e m e n t le fond
sur
l e q u e l s e p r o j e t t e l ' a u r é o l e , r e c o n n a î t r e le g r i s o u
difficilement
à partir
de
1 %
et f a c i l e m e n t
à
partir de 2 % .
L a f l a m m e des l a m p e s p e u t encore être
sée p o u r r e c o n n a î t r e la p r é s e n c e d u
utilisant l'allongement
un
air
appauvri
quelconque
et
en
en
qu'elles
prennent
oxygène
pour
particulier
par
un
la
disponible.
C'est
là
en
dans
motif
présence
d'un gaz combustible qui s'empare d'une
de l ' o x y g è n e
utili-
grisou
un
partie
phéno-
m è n e d'une très grande sensibilité surtout q u a n d
la f l a m m e
mencer
est
réglée a u p o i n t o ù elle v a com-
à fumer
jusqu'ici
tout
le
et on est loin d'en
avoir
tiré
p a r t i possible. Avec les
lam-
pes à huile ordinaire on p e u t reconnaître
ainsi
f a c i l e m e n t la p r é s e n c e
Mais les v a r i a t i o n s
du
grisou
continuelles
d e p u i s g "/„.
et
irrégulières
des f l a m m e s de ces l a m p e s r é s u l t a n t de la
com-
b u s t i o n d e la m è c h e n e p e r m e t t e n t d e l e s e m p l o y e r
à cet
usage que
pour
comparer
l'air en
deux
p o i n t s v o i s i n s ; p a r e x e m p l e , d a n s u n e c l o c h e et
au
niveau
dont
la
du
sol. Avec
combustion
les
n'altère
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
liquides
volatils
pas la m è c h e ,
on
peut
conserver
hauteur
pendant
de f l a m m e
plusieurs
constante
heures
une
d a n s l'air p u r et
p a r suite utiliser ses v a r i a t i o n s de h a u t e u r
pour
r e c o n n a î t r e et doser la q u a n t i t é de grisou
à l'air. M. Chesneau, a réalisé
une
lampe
elle
a
à alcool
d'une
malheureusement
sur
ce
grande
mêlée
principe
sensibilité ;
l'inconvénient
d'ûtre
très sensible a u x v a r i a t i o n s de t e m p é r a t u r e . Le pétrole
employé
mines
pour
donnerait
l'éclairage
dans
certaines
vraisemblablement
aussi
très bons résultats. Le gaz d'éclairage
avec a v a n t a g e être
e m p l o y é de la m ê m e
façon
à l a s u r f a c e p o u r le c o n t r ô l e p e r m a n e n t d e
expulsé
de
la
mine
par
le
du
perturbatrice
grisou,
des
provient
variations
l'air
ventilateur.
p r i n c i p a l e d i f f i c u l t é q u e p r é s e n t e ce m o d e
servation
de
de
la
de
pourrait
La
d'ob-
l'influence
tempéra-
ture.
Un
dernier
procédé
pour
la c o n s t a t a t i o n
du
g r i s o u q u i a été p r o p o s é p a r M. L i v e i n g c o n s i s t e
à u t i l i s e r l a d i f f é r e n c e d ' é c l a t d e d e u x fils f i n s d e
platine portés
au
rouge sombre
courant, l'un au milieu
p u r , l'autre d a n s l'air
d e r n i e r est échauffé
par
un
même
d'une a t m o s p h è r e d'air
grisouteux à étudier.
d'autant
p l u s p a r la
b u s t i o n l e n t e d u g r i s o u q u e la p r o p o r t i o n d e
gaz est p l u s c o n s i d é r a b l e .
Ce p r o c é d é
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
qui
Ce
comce
n'a
pas encore reçu
une
forme
pratique
donnerait
certainement u n e solution satisfaisante
recherche
du
grisou
le
jour
où dans
rage des m i n e s , les l a m p e s ordinaires
remplacées
par
des lampes
électriques
tives.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
pour
la
l'éclaiseraient,
porta-
CHAPITRE 111
L A M P E S DE S U R E T E
33. L a m p e s à
contre
les
feu
causes
nu.
doivent être aussi variées
mêmes,
sont,
plus
—
Les
précautions
d'inflammation
du
q u e ces c a u s e s elles-
m a i s les p l u s i m p o r t a n t e s de
comme
le
grisou
beaucoup
p r o u v e n t les s t a t i s t i q u e s citées
h a u t , celles q u i se r a p p o r t e n t à
l'éclairage
et à l ' e m p l o i des explosifs.
Le n o m b r e considérable d'accidents
n é s p a r les
lampes
à feu
mi
occasion-
et la g r a v i t é
de
quelques-uns d'entre eux m o n t r e n t qu'elles doivent
être
absolument
proscrites
m i n e s g r i s o u t e u s e s , si p e u
de
toutes
les
q u ' e l l e s le s o i e n t . L a
d i s t i n c t i o n e n t r e les mines à g r i s o u
proprement
d i t e s , où l'on p r e n d des p r é c a u t i o n s spéciales, et
les m i n e s p e u g r i s o u t e u s e s , o ù l'on s'en d i s p e n s e ,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
est a b s o l u m e n t fictive. T o u t e m i n e p e u
grisou-
teusé deviendra un jour ou l'autre, mine à
gri-
s o u ; il s e r a i t p r é f é r a b l e d e n e p a s a t t e n d r e p o u r
la faire p a s s e r d a n s celte s e c o n d e c a t é g o r i e , q u e
l'on ait tué u n
semblerait
nombre
même
s u f f i s a n t d ' o u v r i e r s . 11
raisonnable
d'aller
p l u s loin
et do p r e n d r e s y s t é m a t i q u e m e n t d a n s t o u t e s les
m i n e s d e h o u i l l e les m ê m e s p r é c a u t i o n s q u e
dans
les m i n e s déjà r e c o n n u e s c o m m e g r i s o u t e u s c s .
34. L a m p e s de sûreté. —
sûreté,
pour
I-ea
lampes
d o n t la d é c o u v e r t e suffirait
i m m o r t a l i s e r le n o m
de
à elle
de, D a v y ,
seule
utilisent
les p r o p r i é t é s c o n n u e s d e s toiles m é t a l l i q u e s .
Des c e n t a i n e s do t y p e s de l a m p e s ,
fondés
le m é m o p r i n c i p e , o n t été déjà p r o p o s é s
inventeurs,
mais une demi-douzaine
ont
des
donné
résultats
sur
p a r les
seulement
satisfaisants
dans
la
p r a t i q u e et s o n t e n t r é s d a n s l ' u s a g e c o u r a n t des
m i n e s . C'est q u ' à côté des c o n d i t i o n s d e
sécurité
u n e l a m p e de m i n e doit satisfaire à certaines autres c o n d i t i o n s n o n m o i n s i n d i s p e n s a b l e s de solidité, de simplicité d'entretien, de résistunce à
l'extinction, par agitation ou inclinaison, etc. Et
ces d i v e r s e s c o n d i t i o n s s o n t b e a u c o u p p l u s difficiles
à concilier
qu'on
ne serait
croire à première vue. Après
tenté
s'être
contente d ' u n e l a m p e très p e u sûre en
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
de
le
longtemps
sacrifiant
un
peu
dans
de la sécurité
à la simplicité,
comme
le p r e m i e r m o d è l e d e D a v y , o n e s t a r r i v é
par une réaction inverse à imposer aux
lampes
d e s c o n d i t i o n s de s é c u r i t é e x a g é r é e s e n s a c r i f i a n t
par
c o n t r e les a u t r e s qualités de simplicité
et,
de c o m m o d i t é d ' e m p l o i . Cette s é c u r i t é e x t r ê m e de
certains types de l a m p e est d'ailleurs
beaucoup
p l u s a p p a r e n t e q u e réelle ; les s t a t i s t i q u e s d'accid e n t s d u s a u x l a m p e s d e s û r e t é m o n t r e n t e n effet
q u e ces a c c i d e n t s s o n t p r e s q u e e x c l u s i v e m e n t d u s
à
des détériorations
ou
ouvertures des
lampes
q u i s o n t d ' a u t a n t p l u s à c r a i n d r e q u e les l a m p e s
sont d'une construction plus compliquée.
P o u r a p p r é c i e r la s é c u r i t é des l a m p e s d a n s les
essais d e l a b o r a t o i r e o n les p l a c e a u s e i n de m é langes
explosifs
d'air
et de g a z
d'éclairage
et
l ' o n c h e r c h e à r é a l i s e r les c o n d i t i o n s l e s p l u s fav o r a b l e s p o u r le p a s s a g e
rieur.
En
se
reportant
de la
à
f l a m m e à l'exté-
ce q u i a
été dit
des
p r o p r i é t é s d e s toiles m é t a l l i q u e s , on v o i t q u e ces
expériences
doivent p o u r être concluantes, être
faites de p l u s i e u r s
façons
différentes
: d a n s les
d e u x p r o c é d é s les p l u s u s i t é s , o u b i e n on r e m p l i t
la l a m p e é t e i n t e de m é l a n g e e x p l o s i f et o n
pro-
voque l'inflammation intérieure par u n e étincelle
électrique,
blement
ou b i e n o n e x p o s e la l a m p e
allumée
a
des courants
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
de
préala-
mélanges
explosifs
animés
de
vitesses
plus
ou
g r a n d e s , a y a n t des directions variables
o n fait
de
périodiquement
v a r i e r la
façon à avoir a l t e r n a t i v e m e n t
gaz
ou
u n excès
expériences
ont
d'oxygène.
montré
De
moins
et
dont
composition,
un
excès
de
nombreuses
q u e ces v a r i a t i o n s
de
composition étaient particulièrement redoutables
p o u r la sécurité des l a m p e s s a n s q u e l'on ait p u
donner jusqu'ici
une
explication
bien
eerlaine
de ce fait. L e p r e m i e r essai c o r r e s p o n d d a n s
la
pratique au mode habituel de recherche du
gri-
sou d a n s les c l o c h e s , q u i consiste à élever
dou-
c e m e n t la l a m p e a p r è s l ' a v o i r
m i s e e n feu b a s .
Il r é s u l t e des d i m e n s i o n s e x i g u ë s d e la
flamme
q u e le gaz p e u t r e m p l i r la l a m p e a v a n t d'atteind r e l a f l a m m e e t d e s ' y a l l u m e r . Ce d a n g e r
qui
a l o n g t e m p s p a s s é i n a p e r ç u a é t é s i g n a l é il y a
quelques
a n n é e s par M. Marsaut, directeur
des
houillères de Bessèges.Le second essai correspond
p o u r la p r a t i q u e a u x c o n d i t i o n s a n a l o g u e s
d'agi-
t a l i o n et d e c o u r a n t s d ' a i r q u i p e u v e n t s e r e n c o n trer a c c i d e n t e l l e m e n t d a n s les g a l e r i e s de m i n e s .
35
L a m p e D a v y . — L a l a m p e Davy
propre-
m e n t d i t e (ftg- 7 ) e s t u n e l a m p e d a n s l a q u e l l e
f l a m m e est e n t o u r é e d ' u n c y l i n d r e de toile
t a l l i q u e f e r m é à la p a r t i e s u p é r i e u r e
mailles ont
m
dont
la
méles
o "',5o d'ouverture. Le diamètre d u
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
m
c y l i n d r e d e l o i l e ou t a m i s v a r i e d e o ' " , o 4 à o , o 8 e l
m
m
sa h a u t e u r de o , 15o à o , a o o . L a vitesse m i n i m a
n é c e s s a i r e p o u r l'aire s o r t i r la
Fia, 7
dans
m
flamme
le
est de i , 5 o
gaz
d'éclairage,
ce q u i c o r r e s p o n d r a i t à e n viron 3 m è t r e s p o u r le g r i s o u . A ces faibles vitesses
il f a u t p l u s i e u r s
minutes
p o u r f a i r e s o r t i r la
flamme;
à la vitesse de 5 m è t r e s
d a n s le gaz d ' é c l a i r a g e le
p a s s a g e est i n s t a n t a n é . L a
vitesse
lampe
que
dans
prend
une
sa c h u t e
b r e , ou d a n s la
li-
secousse
que lui c o m m u n i q u e
un
o u v r i e r q u i la tire b r u s q u e m e n t à lui
rer d'un
sif
la
suffit
flamme
c'est
ainsi
produits
les
breux
la
d'uilleurs,
lampe
Davy.
pour
ont
été
La
pouvoir
explo-
pour
projeter
au
dehors ;
que
se
sont
presque
accidents,
qui
la r e t i -
mélange
tous
fort
nom-
occasionnés
éclairant
est
par
en
m o y e n n e d e ^ d e b o u g i e ; l e s jj d e la l u m i è r e d e
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
LAMPE
la
flamme
123
DAVY
s o n t a r r ê t é s p a r l e s fils m é t a l l i q u e s . E n
raison du danger que présente leur emploi,
les
l a m p e s d e ce t y p e d o i v e n t ê t r e a b s o l u m e n t p r o s crites p o u r l'éclairage c o u r a n t d e s m i n e s à g r i s o u .
Elles p o s s è d e n t c e p e n d a n t u n e p r o p r i é t é q u i les
rend très c o m m o d e s p o u r la recherche du g r i s o u et
fait t o l é r e r l e u r e m p l o i d a n s la v i s i t e des c h a n tiers q u i est faite p a r u n s u r v e i l l a n t spécial a v a n t
le c o m m e n c e m e n t d u
flamme
travail des ouvriers. L e u r
se r a l l u m e s p o n f a n é m e n t q u a n d
lalampe,
après avoir été p l o n g é e d a n s u n m é l a n g e
explo-
sif,est r a m e n é e d a n s de l'air p u r ou tout au m o i n s
m o i n s c h a r g é d e g r i s o u ; c'est la s e u l e l a m p e q u i
d a n s ces c o n d i t i o n s no s'éteigne pas
définitive-
m e n t ; d a n s les m i n e s i n s u f f i s a m m e n t
où les a c c u m u l a t i o n s d e g r i s o u a u
ventilées
toit et d a n s
les c l o c h e s s o n t f r é q u e n t e s , l a r e c h e r c h e d u g r i sou serait
r e n d u e t r è s d i f f i c i l e si le s u r v e i l l a n t
a v a i t sa l a m p e é t e i n t e c h a q u e fois q u ' i l
rencon-
tre d u g r i s o u . P o u r cet u s a g e p a r t i c u l i e r o ù
le
p o u v o i r é c l a i r a n t de la l a m p e n ' a q u ' u n e i m p o r tance secondaire, on doit e m p l o y e r u n e
double
é p a i s s e u r d o t o i l e q u i a u g m e n t o n o t a b l e m e n t lu
s é c u r i t é . Mais s u r t o u t on ne doit m e t t r e ces l a m pes q u ' e n t r e les nuiins d ' h o m m e s é p r o u v é s , s u r
le
sang-froid
pour
être
desquels
assuré
qu'en
on
peut
voyant
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
assez
compter
leur l a m p e
se
r e m p l i r d e feu ils s a u r o n t r é s i s t e r a u
mouvement
i n s t i n c t i f q u i fait v i v e m e n t t i r e r la l a m p e à s o i .
36
Lampe Clanny
(Botij,
Wolf,
de Sarre-
b r u c k ) . — Cette l a m p e est u n e l a m p e D a v y d a n s
l a q u e l l e la
toile m é t a l l i q u e a été r e m p l a c é e
tour de la f l a m m e p a r u n verre q u i
considérablement
son
au-
augmenta
p o u v o i r é c l a i r a n t ; il
environ de J de bougie.
est
D e t o u t e s les l a m p e s à
v e r r e , c'est la p l u s s i m p l e p u i s q u e son e n v e l o p p e
n e se c o m p o s e q u e d e d e u x
une
toile
parties, u n verre et
métallique. Au point
sécurité, cette l a m p e p r é s e n t e
périorité
sur
la
lampe
de v u e de
une
Davy
bien
l'action des m é l a n g e s explosifs en
la f l a m m e soit f a c i l e m e n t
grande
la
su-
que
sous
mouvement,
projetée au
dehors.
Celte s é c u r i t é p l u s g r a n d e r é s u l t e d e ce q u e cette
l a m p e s'éteint q u a n d elle est r a m e n é e d ' u n
lange
explosif
à l'air
pur. L'ouvrier
n'a
médonc
p a s la faculté, c o m m e a v e c la l a m p e D a v y , de
l ' e x p o s e r u n g r a n d n o m b r e de fois à l ' a c t i o n d e s
m é l a n g e s explosifs. Elle s'éteint
part du temps
ment
dans
l'agitation
un
quand
elle est
mélange
de l'air
m e n t s u r la l a m p e
même
introduite
explosif, en
q u i fait a r r i v e r
des
mélanges
la
plulente-
raison
de
alternativecombustibles
et non c o m b u s t i b l e s , lorsqu'elle traverse la zone
q u i c o r r e s p o n d à la l i m i t e d ' i n l l a m m a b i l i t é .
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
La
sécurité est n o t a b l e m e n t a u g m e n t é e encore
pur
la s uper pos ition de d e u x toiles m é t a l l i q u e s
qui
n ' o n t p a s l ' i n c o n v é n i e n t d e d i m i n u e r le p o u v o i r
éclairant.
C'est, d e t o u t e s les l a m p e s
démines,
c e l l e q u i r é s i s t e le m i e u x à l ' e x t i n c t i o n p a r a g i tation ou inclinaison.
37.
C'est
Lampe
une
Marsaut
lampe
Clannj
d o n t le t a m i s est
7
entouré
d'un écran métallique qui
la p r o t è g e c o n t r e
l'action
des c o u r a n t s d'air ; des ouv e r t u r e s percées à la base
et au s o m m e t permettent
l ' e n t r é e d e l'air et la s o r t i e
des
fumées
(fig.
écran donne
8).
à la
Cet
lampe
u n e sécurité qui paraît absolue d a n s les
conditions
h a b i t u e l l e s d e s m i n e s ; il
p r é s e r v e d e p l u s le t a m i s
contre
les
délériorations
accidentelles.
En
regard
d e c e s d e u x a v a n t a g e s , il
a l'inconvénient de d i m i nuer
un
peu
Je
pouvoir
éclairant, de faciliter
l'extinction
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
en
gênant
la
circulation de l'air,enfin de p e r m e t t r e p l u s
lement l'oubli
du
t a m i s q u e l'on
faci-
n e voit pas.
C'est a u j o u r d ' h u i p o u r les m i n e s très g r i s o u l o u s e s l a l a m p e q u i e s t le p l u s g é n é r a l e m e n t
préfé-
férée on F r a n c e .
38. L a m p e
M u e s e l e r . — Il s ' a g i t ici
d'une
l a m p e C l a n n y q u i est
fer-
mée au-dessus du verre par
un diaphragme
horizontal
en toile m é t a l l i q u e
¡1 t r a -
vers lequel passe une cheminée
très
rétrécie à
s o m m e t (fig.
son
g). Cette dis-
p o s i t i o n a p o u r effet d ' a m e n e r à c o u p s û r et p r e s q u e
immédiatement
l'extinc-
t i o n d e la l a m p e d a n s
les
m é l a n g e s explosifs, ce q u i
d o n n e u n e g a r a n t i e très i m portante de sécurité.
extinction
résulte
que
les
dans
explosifs
monte
s'arrête.
jusqu'au
Dans
diaphragme
cette p o s i t i o n do
gaz b r û l é s s'échappent
en sens
la
sous
inverse
des
la
à t r a v e r s le
gaz
froids
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
Cette
de
ce
mélanges
flamme
re-
lequel
elle
flamme
les
diaphragme
a u x q u e l i l s se
m é l a u g e n t j u s q u ' à les r e n d r e c o m p l è t e m e n t
in-
c o m b u s t i b l e s et a m e n e r a i n s i l e u r e x t i n c t i o n .
Ou
p e u t cependant avec cette l a m p e o b t e n i r la sortie
de la
flamme
en
dirigeant
un
assez r a p i d e de b a s e u h a u t
courant
gazeux
contre le c h a p e a u ,
c e q u i r e n v e r s e le s e n s d e l a c i r c u l a t i o n d ' a i r à
l'intérieur
et p e r m e t à la
flamme
de se r e n d r e
p a r la c h e m i n é e d a n s le t a m i s d'où
d'air
la projette
ensuite
au
le c o u r a n t
dehors. Malgré
ce
d a n g e r , q u i s u p p o s e la r é u n i o n de c o n d i t i o n s très
rares
dans
la p r a t i q u e , cette
lampe
a pendant
l o n g t e m p s é t é c o n s i d é r é e c o m m e la s e u l e q u i f û t
suffisamment
sûre dans
t e u s e s ; c'est e n c o r e
les m i n e s
celle q u i
est
très grisouactuellement
la p l u s e m p l o y é e d a n s ces m i n e s . Elle a p a r contre le g r a v e d é f a u t d e s ' é t e i n d r e
très
facilement
p a r i n c l i n a i s o n , c'est d e t o u t e s les l a m p e s de sûreté celle q u i p r é s e n t e
ce d é f a u t
au plus
haut
d e g r é . O n p o u r r a i t a t t é n u e r c o n s i d é r a b l e m e n t ce
d é f a u t e n a u g m e n t a n t le d i a m è t r e d e l a
née, mais on détruirait du m ê m e coup la
chemisécu-
rité de la l a m p e . L a c h e m i n é e n ' é t a n t p l u s r e m plie
flamme
de
fumée
laisse passer
dans
du grisou. On ne doit sous
texte modifier
dans
le t a m i s
la
aucun pré-
cette l a m p e les d i m e n s i o n s
réglementaires.
3 9 . L a m p e F u m â t — La l a m p e F u m â t est u n e
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
lampe à alimentation inférieure,c'est-à-dire dans
laquelle l'air est a d m i s en dessous du verre
(fig.iu).
D a n s les l a m p e s p r é c é d e n t e s l'air était a d m i s au,,.
,„
dessusdu verre etdevait
descendre
à la
pour
flamme
arriver
en c i r c u l a n t
en sens inverse des
fu-
m é e s qui s'élèvent nécessairement
en
raison de
leur échauffement.
limentation
L'a-
inférieure
des l a m p e s de sûreté qui
avait été essayée d e p u i s
longtemps,
même
par
Davy,entraîne généralem e n t deu x graves inconv é n i e n t s q u i a v a i e n t fait
renoncer à son emploi.
Ces l a m p e s s o n t très sensibles
au
balancement
et s ' é t e i g n e n t s o u s l'action de la force
fuge
qui
mées
E n o u t r e , d a n s les m é l a n g e s
bustion
la
intérieure
lampe
du
s'échauffe
gaz
rabat
sur
la
fu-
flamme.
explosifs la c o m -
améliore
énormément,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
centriles
le
les
tirage,
toiles
rougissent,
tion
les
verres
se p r o p a g e
au
n'existent que peu
mât,
par
suite
cassent
dehors.
ou
sans
pas
et
l'inflamma-
Ces d e u x
défauts
dans la l a m p e
doute du choix
des d i m e n s i o n s données a u x
Fu-
judicieux
différents
organes.
L a l a m p e s ' é t e i n t c o m p l è t e m e n t d a n s les m é l a n ges explosifs p a r
un
mécanisme
assez
curieux.
A u m o m e n t o ù le gaz v i e n t b r û l e r c o n t r e la toile
inférieure
d'admission
d'air
il s e p r o d u i t
des
m o u v e m e n t s v i b r a t o i r e s a n a l o g u e s à c e u x q u i se
développent
dans
l'harmonica
philosophique ;
ces m o u v e m e n t s a u g m e n t e n t p e u à p e u
d'inten-
sité j u s q u ' a u m o m e n t o ù ils a m è n e n t l ' e x t i n c t i o n
brusque
bon
de la f l a m m e . Cette l a m p e
pouvoir
d'admission
presque
Elle
a
éclairant
de
en
raison
l'air ; elle p e u t
jusqu'à
l'horizontale
a
très
mode
être
sans
seulement l'inconvénient
un
du
inclinée
s'éteindre.
d'être
sensi-
b l e a u m o u v e m e n t p e n d u l a i r e p r o d u i t p a r le b a lancement du bras qui p e u t a m e n e r son
extinc-
t i o n . Cet i n c o n v é n i e n t a d i s p a r u d a n s le d e r n i e r
modèle de cette l a m p e grâce à l'adjonction
cuirasse. Au
est
point
comparable
aux
de
vue
de la
lampes
d'une
sécurité, elle
Marsaut
et
Mue-
seler.
40.
Degré
de
sécurité
des
l a m p e s . — C'est i n t e n t i o n n e l l e m e n t
LB CHÀTZLIKR — G r i s o u
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
diverses
que
dans
l e s q u e l q u e s l i g n e s c o n s a c r é e s ici a u x l a m p e s d e
s û r e t é it a é t é à p e i n e f a i t a l l u s i o n a u n o m b r e illim i t é d ' e x p é r i e n c e s e n t r e p r i s e s d a n s ces d i x
der-
n i è r e s a n n é e s p o u r c o m p a r e r le d e g r é d e s é c u r i t é
d o s d i v e r s t y p e s d e l a m p e s . S a n s c o n t e s t e r l e s 1res
grands
services
les p r o g r è s
rendus
par
ces
qu'elles ont a m e n é s
expériences,
dans
la
cons-
truction des l a m p e s de sûreté, on ne peut méconn a î t r e q u ' e l l e s o n t fait accovder u n e
factice à c e u x
importance
des é l é m e n t s de la sécurité
m i n e s q u i se p r ê t e n t à d e s e x p é r i e n c e s
r a t o i r e . On est i n s t i n c t i v e m e n t
ner
une
imporlance
des
labo-
conduit à
prépondérante
d ' u n e question q u e l'on
de
aux
doncôtés
a étudiés soi-même, ou
s u r l e s q u e l s o n t r o u v e le p l u s g r a n d
n o m b r e de
d o c u m e n t s i m p r i m é s . O n est a r r i v é ainsi à classer
les l a m p e s d'après des e x p é r i e n c e s d a n s lesquelles
la vitesse a été
poussée jusqu'à
20
mètres
par
s e c o n d e , c o n d i t i o n q u i n e p e u t se p r é s e n t e r d a n s
les m i n e s . L e d e g r é de sécurité m e s u r é
ratoire
n'a
presque
aucune
espèce de
a v e c le d e g r é d e s é c u r i t é d a n s l a m i n e .
au laborapport
Soit par
e x e m p l e h c o m p a r e r l a l a m p e C l a n n y e t la l a m p e
Mueselcr ;
au
laboratoire
la s é c u r i t é d e la pre-
m i è r e s e m b l e n u l l e ; celle de la s e c o n d e é n o r m e .
S i , a u c o n t r a i r e , o n se r e p o r t e à l a s t a t i s t i q u e d e s
a c c i d e n t s , il n ' y a p l u s d e d i f f é r e n c e
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
appréciable;
la raison
entre
en est facile à c o m p r e n d r e q u a n d
d a n s le détail des accidents ; on voit
presque tous
s o n t le fait
ou ouvertes, tandis q u ' a u
de l a m p e s
type
de
détériorées
laboratoire on n'expé-
r i m e n t e q u e sur des l a m p e s en
curité d'un
b o n é t a t . L a sé-
lampe ne dépend donc pas
seulement des qualités qu'il présente
est en bon état, mais
conditions
Mueselnr
rement
par
entre
beaucoup
les o u v r i e r s
facilement
plus
que
d'autres
moins
d'être détérioré. Ainsi
qui s'éteint
lorsqu'il
beaucoup
de la c h a n c e p l u s ou
qu'il présente
on
que
lampe
sera nécessai-
fréquemment
ouverte
la l a m p e C l a n n y
q u e soient les p r é c a u t i o n s prises
grande
la
contre
quelles
l'ouver-
t u r e . Il n ' e s t p a s i m p o s s i b l e q u ' e n p r a t i q u e c e t t e
s o u r c e d e d a n g e r c o m p e n s e les q u a l i t é s s u p é r i e u res de la l a m p e
gérée accordée
n'est pas sans
fermée. Cette i m p o r t a n c e exaà c e r t a i n s côtés
d'une
question
i n c o n v é n i e n t . Il n ' y a p a s g r a n d
m a l , p e u t - o n c r o i r e , à f a i r e p l u s q u e le n é c e s s a i r e
en fait d e l a m p e s , la s é c u r i t é doit
serait
vrai
si
l'étude
blème de grisou
heureusement
il
n'en
n'en
y g a g n e r . Ce
des autres côtés
du
pro-
souffrait p a s , m a i s
mal-
est p a s ainsi
et
l'esprit
h u m a i n est a i n s i fait q u e l o r s q u ' i l se l a i s s e t r o p
vivement
entraîner dans
une
d i r e c t i o n , il n ' e s t
p l u s c a p a b l e d ' a p e r c e v o i r les d i r e c t i o n s v o i s i n e s .
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
A u j o u r d ' h u i il n'y a p a s u n d i r e c t e u r d o
q u i n e soit p é n é t r é
de
sûreté, par
grand
de
l'importance des
c o n t r e il
y en
mines
lampes
a encore un trop
n o m b r e q u i n e se p r é o c c u p e n t p a s
suffi-
s a m m e n t de l'importance bien p l u s considérable,
au point
d e v u e d e la s é c u r i t é , de l ' a é r a g e et de
l'organisation des t r a v a u x .
La fréquence
des accidents
dus à
l'ouverture
des l a m p e s m o n t r e q u ' i l est i m p o s s i b l e de c o m p ter
sur
la
sagesse des
ouvriers pour
éviter de
s e m b l a b l e s i m p r u d e n c e s . On a c h e r c h é à r e c o u rir à des procédés de
rendent l'ouverture
fermeture
sinon
mécanique
impossible, du
qui
moins
assez difficile p o u r q u e l ' o u v r i e r n ' a i t p a s i n t é r ê t
à l'essayer. Les procédés de
fermeture des
lam-
p e s s o n t u n d e s s u j e t s q u i o n t le p l u s e x e r c é l ' i m a gination
des i n v e n t e u r s . P a r m i
tous
les
systè-
m e s p r o p o s é s , les s e u l s q u i p r é s e n t e n t u n e s i m plicité assez g r a n d e p o u r p r é s e n t e r u n
nement
assuré
sans
exiger
un
fonction-
entretien
trop
c o m p l i q u é sont la f e r m e t u r e h y d r a u l i q u e de Cat r i c e et l a f e r m e t u r e m a g n é t i q u e d e V i l l i e r s d a n s
l e s q u e l s le v e r r o u n e p e u t ê t r e a c t i o n n é d e
térieur
que
par
un
l'eau sous pression. A u j o u r d ' h u i on a
m e n t renoncé à l'usage des fermetures
bles ou
censées
l'ex-
p u i s s a n t a i m a n t ou p a r de
telles ; o n
généraleinouvra-
se c o n t e n t e d ' e x i g e r
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
des
fermetures
ment
visible
qui
laissent
lorsqu'elles
eet o r d r e d ' i d é e
une
trace
la f e r m e t u r e p a r
p l o m b p o r t a n t une
facile-
o n t été forcées.
un
Dans
rivet
de
m a r q u e spéciale est celle q u i
est a c t u e l l e m e n t p r é f é r é e .
4 1 . P o u v o i r é c l a i r a n t . — L e s lampes
c o n c o u r i r à la sécurité
pas seulement
grisou ; un
dos o u v r i e r s
pour
ne doivent
être étudiées au point de v u e du
danger
beaucoup
plus grave
que
l e s a c c i d e n t s d e g r i s o u p a r le n o m b r e d e s m o r t s
qu'il occasionne p r o v i e n t des c h u t e s de
Pour
se p r é m u n i r
vrier
a
contre
besoin d'avoir
ces
une
pierre.
accidents,
l'ou-
l a m p e q u i l'éclairé
b i e n et q u i p u i s s e s ' i n c l i n e r d a n s t o u s les s e n s
p o u r p e r m e t t r e un
examen
facile d u
reconnaissance des pierres prêles
pouvoir
éclairant
d'une
élément
essentiel
toit et la
à tomber.
lampe est
donc
d e s é c u r i t é e t , à ce p o i n t d e
v u e , il f a u t a v o u e r q u e l e s l a m p e s d e
mine
ordi-
naires laissent beaucoup à désirer. L'emploi
l'huile végétale jointe à l'impossibilité
la l a m p e p o u r
Le
un
moucher
la
mèche
de
d'ouvrir
font q u e
le
pouvoir éclairant t o m b e très r a p i d e m e n t à moitié de sa v a l e u r p r i m i t i v e et m ê m e a u - d e s s o u s .
Des e x p é r i e n c e s faites
mission
anglaise
du
s u r ce s u j e t p a r l a
grisou
Com-
o n t d o n n é p o u r le
p o u v o i r é c l a i r a n t d e s l a m p e s C l a n n y et M u e s e l e r
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
les r é s u l t a t s s u i v a n t s
après des durées variables
d ' a l l u m a g e . L ' u n i t é est la b o u g i e anglaise :
Lampo Clanny
D urèo
d'allumage
Lampe
Pouvoiréclairanl
Darée
d'allumage
P o u v o i r éclairanl
5'
o/ji
99'
1
o.3'
nv
9°'
116'
f
y 9'
o,3o
I
°» 7
0,16
D e p u i s q u e l q u e s a n n é e s , des essais o n t été faits
e n A l l e m a g n e et e n A n g l e t e r r e
pour
remplacer
les h u i l e s végétales par des h u i l e s m i n é r a l e s v o latiles (') : q u i
bonner
peuvent
la m è c h e
b r û l e r sans faire
et p e r m e t t e n t a i n s i
char-
d'obtenir
u n éclairage constant p e n d a n t u n g r a n d n o m b r e
d ' h e u r e s . Avec des dispositions de
lampes
con-
venables on est m é m o arrivé à o b t e n i r ainsi des
pouvoirs éclairants
semble pas résulter
de p l u s d ' u n e b o u g i e . Il n e
de danger
spécial de l'em-
p l o i d e c e s c o m b u s t i b l e s , s u r t o u t si l ' o n s e l i m i t e
(') Los lampes, dites à benzine,
qui sont employées
sur une grande échelle en Allemagne brûlent en réalité de l'essence de pétrole d'une qualité déterminée.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
a u x h u i l e s p e u volatiles e n é l i m i n a n t les
ces légères p u r e s o u
Des expériences
essen-
mélangées.
faites p a r la C o m m i s s i o n
an-
glaise du grisou ont m o n t r é que certaines huiles
animales
étaient préférables a u x huiles
les p o u r la c o n s e r v a t i o n d u p o u v o i r
q u e l'on
végéta-
éclairant et
pouvait avec avantage, sans rien chan-
ger aux dispositions des lampes, mêler aces huiles a n i m a l e s o u v é g é t a l e s la m o i t i é
de leur vo-
l u m e d'huile de pétrole.
42. L a m p e s é l e c t r i q u e s d e m i n e s . — Des
essais sont poursuivis depuis u n certain
d ' a n n é e s p o u r c o n s t r u i r e d e s lampes
nombre
électriques
de m i n e s p o r t a t i v e s . L ' e m p l o i de ces l a m p e s s u p p r i m e r a i t c o m p l è t e m e n t les d a n g e r s r é s u l t a n t de
l'éclairage,
des
qu'un
Les
tandis que par
lampes
à
flamme
accroissement
de
perfectionnement
n'obtiendra
sécurité
jamais
insignifiant.
o u v e r t u r e s , la détérioration qui c o n s t i t u e n t
le p r i n c i p a l da*nger
sont
le
on
pas
à
de ces d e r n i è r e s l a m p e s n e
redouter
avec
les
lampes
électri-
q u e s . D a n s les e s s a i s faits j u s q u ' i c i , elles
jamais c o m m u n i q u é l'inflammation au
dans
une
m ê m e au
seule
condition
dont
la
n'ont
gaz
que
réalisation
laboratoire présente de très
grandes
d i f f i c u l t é s : c'est la r u p t u r e d e l ' a m p o u l e d e v e r r e
n o n a c c o m p a g n é e de la r u p t u r e d u f i l a m e n t
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
de
charbon. Presque
toujours
les d e u x se
brisent
e n s e m b l e . U n e l a m p e d e f a b r i c a t i o n a n g l a i s e , la
l a m p e Stella qui
a
été essayée
en
France aux
m i n e s d ' A n z f n , d e L i é v i n , de R o c h e b e l l e , a d o n n é
a u x expériences des résultats
satisfaisants.
Elle
est c o m p o s é e de d e u x a c c u m u l a t e u r s a u p l o m b reliés
à
une
petite
4 volts ; elle
d'éclairage
lampe
fournit
à
incandescence
facilement
douze
avec un pouvoir éclairant
de
heures
m o y e n de
j de b o u g i e , soit la m o i t i é des l a m p e s o r d i n a i r e s .
L a facilité avec l a q u e l l e elle p e u t ê t r e i n c l i n é e et
d i r i g é e d a n s t o u s les s e n s c o m p e n s e d a n s la pratique l'infériorité de son
peut
avec
avantage
p o u v o i r é c l a i r a n t ; elle
remplacer
exclusif d e l'éclairage les l a m p e s
au point de vue
aujourd'hui en
u s a g e . E n f i n l a d é p e n s e j o u r n a l i è r e p o u r le c h a r gement
des
accumulateurs
serait inférieure
celle qui r é s u l t e de la c o n s o m m a t i o n
à
d'huile. A
s'en t e n i r à ces r é s u l t a t s e x p é r i m e n t a u x , il s e m b l e r a i t q u e le p r o b l è m e de l ' é c l a i r a g e
électrique
d e s m i n e s est c o m p l è t e m e n t r é s o l u , en r é a l i t é il
n ' e n e s t m a l h e u r e u s e m e n t r i e n . II y a u n c ô t é d e
la
question
présentant au point
de v u e écono-
m i q u e u n e i m p o r t a n c e c a p i t a l e q u i est e n v e l o p p é
jusqu'ici d'une
obscurité complète.
On
ignore
ce q u e ces l a m p e s , d o n t le p r i x d e p r e m i è r e a c quisition
e s t d i x fois s u p é r i e u r à celui d e s l a m -
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
p e s o r d i n a i r e s , p o u r r o n t f a i r e d e s e r v i c e . Ce q u e
l'on sait d e la r a p i d e d e s t r u c t i o n d e s a c c u m u l a t e u r s et a m p o u l e s d e l a m p e s
iixe fait
craindre
une
employées à
détérioration
p l u s r a p i d e p o u r les l a m p e s p o r t a t i v e s
exposées
à des c h o c s c o n t i n u e l s . Ces c r a i n t e s s o n t
mées par
le p e u d ' e m p r e s s e m e n t des
poste
beaucoup
confir-
construc-
t e u r s à s e p r ê t e r à d e s e s s a i s i n d u s t r i e l s . M a i s si
le p r o b l è m e n'est pas résolu
aujourd'hui
pspérer qu'il
un
le s e r a d a n s
moins éloigné.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
avenir
il
plus
faut
ou
CHAPITRE IV
E X P L O S I F S DE SUIŒTÉ
43
Généralités. —
A p r è s la l a m p e
reté, l'usage
des explosifs
la c a u s e
plus grand
du
de
n o m b r e d ' a c c i d e n t s , et
m ê m e ces d e r n i e r s a c c i d e n t s , q u o i q u e m o i n s
bz-eux, o n t p r o d u i t
un
plus
grand
temps
qu'en
dehors
plète des explosifs
On
de
il n ' y
noin-
nombre
victimes en raison de la gravité p l u s
rable de chacun d'eux.
sû-
a été d a n s les m i n e s
de
considé-
a cru p e n d a n t longla
suppression
avait
aucun
commoyen
d'atténuer leur danger. Les p r o d u i t s de leur combustion atteignent u n e t e m p é r a t u r e de plusieurs
m i l l i e r s d e d e g r é s q u i d e v r a i t l a r g e m e n t suffire à
a l l u m e r u n g a z i n f l a m m a b l e à G.u)".
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
On e s t c e p e n d a n t a r r i v é à t r o u v e r d e s e x p l o s i f s
q u i p r é s e n t e n t u n e sécurité relative assez g r a n d e ,
c'est-à-dire
qui n'enflamment
que
g r i s o u , les résultats s o n t d u s a u x
rarement
le
t r a v a u x de la
la C o m m i s s i o n des s u b s l a n c e s e x p l o s i v e s ; ils o n t
été e x p o s é s d a n s u n
rapport
de M.
Mallard
(')
d o n t o n n e p o u r r a d o n n e r ici q u ' u n r é s u m é b i e n
sommaire.
44. Déflagration et détonation des explos i f s . — P o u r c o m p r e n d r e c o m m e n t des explosifs
peuvent détoner au milieu du grisou
lumer,
il
faut
rapprocher
la
du grisou d'exiger un certain temps
ment pour s'allumer
sans
de celle des
d'échauffe-
explosifs
brisants, de présenter un refroidissement
moment
rapide
p a r s u i t e d e la
d'une partie importante
l'al-
propriété capitale
dits
extrê
transformation
de leur c h a l e u r en tra-
v a i l m é c a n i q u e . L a p r o p a g a t i o n de la c o m b u s t i o n
d a n s ces e x p l o s i f s diffère C o m p l è t e m e n t de ce q u i
se p a s s e
avec
les
poudres
proprement
dites.
U n p r i s m e de p o u d r e noire chauffé en u n de ses
1
i ) MALLARD. — Rapport sur l'étude des questions
relatives à l'emploi des explosif» en présence du grisou
(Annales des Mines, 8 · série, t. XIV, p. 3ig, 1888).
Notes sur diverses expériences concernant l'emploi
des explosifs dans les mines a grisou. (Annales
des
Mines, t. VII, p. i5 et 0,9, i88y).
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
points
s'enflamme
en
dégageant
d e la
chaleur
q u i se t r a n s m e t t r a p a r c o n d u c t i b i l i t é a u x p a r t i e s
voisines et
en
provoquera
l'inflammation
qui
c o n t i n u e r a ainsi à se p r o p a g e r de p r o c h e en p r o che. La vitesse de cette propagation
intimement
liée à la c o n d u c t i b i l i t é est p o u r la p o u d r e
à l'air
libre d'environ
i3
millimètres
noire
par
se-
c o n d e . C e m o d e d e c o m b u s t i o n e s t c o n n u s o u s le
n o m d e déflagration.
U n p r i s m e d e f u l m i n a t e de
m e r c u r e f r a p p é e n u n de ses p o i n t s
s'enflamme
é g a l e m e n t m a i s la f o r m a t i o n i n s t a n t a n é e d u
gaz
ainsi p r o d u i t exerce s u r la
une
compression
é n e r g i q u e qui en
tour l'explosion
ger
de proche
nisme.
La
non
de
et
à
en
peut
proche par
vitesse
ce
de
de
mécal'explo-
t h e r m i q u e , elle est
la vilcsse
dépasser 5ooo mètres
s'appelle
mode de propagation
d ' o n d e explosive.
de
cas à l'élasticité du corps
grandeur
m o d e de c o m b u s t i o n
à se propa-
le m ê m e
de p r o p a g a t i o n
sa conductibilité
l'ordre
d é t e r m i n e à son
et celle-ci c o n t i n u e
sion est liée d a n s
et
région voisine
est
du
p a r seconde.
détonation,
désigné sous
le
Mais u n
peuvent présenter
nom
Les d e u x explosifs pris c o m m e
modes de c o m b u s t i o n , déflagration
détonation.
Ce
son
exemple ne présentent normalement qu'un
des deux
son
grand
l'un
ou
nombre
seul
ou
d'explosifs
l ' a u t r e de ces m o d e s
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
rie c o m b u s t i o n , s u i v a n t
le p r o c é d é
d'inflamma-
t i o n e m p l o y é . A i n s i la d y n a m i t e , le c o t o n p o u d r e
d é f l a g r e n t a u c o n t a c t de la
flamme
d'une
allu-
m e t t e e t d é t o n e n t p a r le c h o c . I l p e u t m ê m e a r river que s p o n t a n é m e n t l'un des modes d'explosion se t r a n s f o r m e d a n s l ' a u t r e ; les ratés de d é tonation dans l'usage
de la d y n a m i t e sont
e x e m p l e d u p a s s a g e de la d é t o n a t i o n
gration,
inversement
il a r r i v e
à la
parfois
qu'une
cartouche de d y n a m i t e a l l u m é e avec u n e
flamme
après avoir hrùlé tranquillement quelques
t a n t s se m e t à d é t o n e r
Le refroidissement
stion
qui
résulte
et
un
défla-
ins-
brusquement.
des p r o d u i t s de la c o m b u d'une
transformation
de
c h a l e u r en travail m é c a n i q u e et d u m é l a n g e des
gaz brûlés
avec
l'air
a m b i a n t se fait d a n s
d e u x m o d e s d'explosion d ' u n e façon bien
ces
diffé-
rente.
D a n s le c a s d e l a d é f l a g r a t i o n
travail m é c a n i q u e ,
dont
à l'air libre,
le
la m e s u r e est égale a u
p r o d u i t d u v o l u m e d u gaz p a r la pression
atmo-
s p h é r i q u e , n e r e p r é s e n t e p a s 1 "/„ d e l a c h a l e u r
t o t a l e ; le m é l a n g e des g a z b r û l é s et c h a u d s a v e c
l'air se fait c o m m e p o u r t o u t e s les
flammes
u n e d u r é e de t e m p s q u i se chiffre a u
T^O e t m ê m e p a r ^
de
moins
dans
par
seconde. Avec des durées
de refroidissement aussi g r a n d e s des explosifs à
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
t e m p e ra t u ros
de
combustion
très basses,
infé-
r i e u r e s à 1000°, p o u r r a i e n t s e u l s n e p a s a l l u m e r
le g r i s o u . O r , j u s q u ' i c i o n n e c o n n a î t p a s d ' e x p l o sifs d é f l a g r a n t s , d o n t l a t e m p é r a t u r e d e c o m b u s tion soit inférieure
à 2000°. T o u s l e s
explosifs
d é l l a g r a n t s d o i v e n t d o n c e n f l a m m e r le g r i s o u .
45. Abaissement
de température
par la
d é t e n t e . — A v e c les explosifs b r i s a n t s
froidissement
le
e s t t o u t a u t r o e t se p r o d u i t
reavec
u n e vitesse, c o m p a r a b l e à celle d e p r o p a g a t i o n de
l a c o m b u s t i o n e l l e - m ê m e . S o i t u n e c a r t o u c h e do
dvnamite sphérique
de 1 centimètre
de
rayon
d o n t la d é t o n a t i o n est p r o v o q u é e a u c e n t r e ; l'exp l o s i o n a u r a a t t e i n t la surface, a u h o u t de
^ucorHi
de
s e c o n d e , et les g a z p r o d u i t s p e n d a n t u n t e m p s si
court n'auront pas p u en raison
de l e u r
se déplacer d ' u n e q u a n t i t é a p p r é c i a b l e . L a
bustion
sera produite à volume, constant
loppant une température d'environ
pressions de plusieurs dizaines
inertie
comdéve-
3ooo° et des
de milliers d'at-
m o s p h è r e . Ces p r e s s i o n s n e p e u v e n t p a s ê t r e m e surées, mais
leur existence est démontrée
f a ç o n é v i d e n t e p a r l e s effets
d'une
m é c a n i q u e s si puis-
s a n t s q u e subissent les corps s u r lesquels l'explosif e s t s i m p l e m e n t p o s é . L e s g a z c o m p r i m é s v o n t
bientôt r a p i d e m e n t se détendre avec transformation en travail d ' u n e fraction de l e u r c h a l e u r s e n -
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
sible ; celle-ci p e u t ê t r e r i g o u r e u s e m e n t
calculée
q u a n d o n c o n n a î t l e u r p r e s s i o n et l e u r t e m p é r a ture initiale. E n prenant c o m m e pression initiale
10000 a t m o s p h è r e s , c e q u i e s t d e b e a u c o u p i n férieur
à la r é a l i t é , o n o b t i e n t p o u r
différents
explosifs les r é s u l t a t s s u i v a n t s •
T e m p e ra
t lira
Kxplosifs
initiale
Tempërature
finale île
COÏO-
de
btistion
détente
Gy°
Coton entiécanitricj u e
a 636»
3n',°
3acjo»
[ fio p. coton nitrique
Mélange j
,,
( oop.azotate a ammoniaque
On voit q u e
la m a j e u r e p a r t i e
p e u t être t r a n s f o r m é e
de
celle
|f)0°
fi0 2 °
de la c h a l e u r
e n t r a v a i l e t la t e m p é r a -
ture abaissée ainsi pour
dessous
2
certains
explosifs
d'inflammation
du
au-
grisou.
CeLte d é t e n t e e s t d ' a i l l e u r s t r è s r a p i d e e t n e d o i t
pas
dépasser
de
d'explosif considérée
seconde
pour
la
puisse y avoir des explosifs dont
la
détonation
n ' a l l u m e p a s le g r i s o u . T o u s c e s c a l c u l s
sent expressément
quantité
ici ; on c o n ç o i t d o n c q u ' i l
suppo-
q u e la r é a c t i o n c h i m i q u e est
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
t e r n i i n é e q u a n d la d é t e n t o c o m m e n o e , a u t r e m e n t
dit q u e la vilesse p r o p r e d e la réaction est s u p é r i e u r e à celle de sa p r o p a g a t i o n . Cela s e m b l e ô t r e
le cas d e la n i t r o g l y c é r i n e ; m a i s il n ' e n est p a s
t o u j o u r s ainsi ; la réaction c h i m i q u e p e u t ,
pen-
d a n t la période de d é t o n a t i o n
dite,
s'arrêter à
proprement
u n e étape intermédiaire. Ainsi l'azo-
tate de c u i v r e a m m o n i a c a l d o n t la r é a c t i o n e x p l o sive finale est d o n n é e p a r l ' é q u a t i o n c h i m i q u e :
3
2
(Az0 ) Cu, 4 AzIP =
C u -h 3 A z
2
+
G H?0
d o n n e d a n s sa d é t o n a t i o n à l'air l i b r e de l ' o x y d e
de cuivre des v a p e u r s
nitreuses
n i a q u e . Ces r é a c t i o n s
bien plus
importantes
et
incomplètes
dans
le cas
de
l'ammo-
sont
encore
des
mélan-
g e s m é c a n i q u e s d e différents c o r p s d o n t les prod u i t s de la d é c o m p o s i t i o n d i r e c t e p e u v e n t
mutuellement.
L'effet
de ces r é a c t i o n s
réagir
incom-
plètes s u r la t e m p é r a t u r e finale a p r è s détente p e u t
s u i v a n t les cas se faire s e n t i r d a n s u n e d i r e c t i o n
opposée. Si la réaction ne s'achève
détente, la t e m p é r a t u r e
finale
pas après
est
a b a i s s é e ; m a i s si e l l e se c o n t i n u e , d o n n a n t
quelque
sorte
u n e déflagration
la
évidemment
partielle
eu
après
u n e d é t o n a t i o n p a r t i e l l e , la t e m p é r a t u r e e n
est
é l e v é e . Ces d e u x cas se r e n c o n t r e n t d a n s la p r a tique.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
AHA1S.SE.MENT D E T E M P E R A T U R E P A R
LA
DETENTE
14")
E n f i n il a r r i v e p o u r c e r t a i n s e x p l o s i f s b r i s a n t s ,
le c o t o n o c t o n i t r i q u e p a r e x e m p l e , q u e , p a r s u i t e
d ' u n d é f a u t d ' o x y g è n e les p r o d u i t s d e l à r é a c t i o n
renferment du charbon, de l'oxyde de
de l ' h y d r o g è n e
carbone,
qui peuvent postérieurement
à
la d é t e n t e s ' e n f l a m m e r a u c o n t a c t de l'air.
D a n s le c a l c u l i n d i q u é p l u s h a u t s u r l ' a b a i s s e m e n t de t e m p é r a t u r e p r o d u i t p a r la d é t e n t e , on a
c a l c u l é la q u a n t i t é d e c h a l e u r t r a n s f o r m é e e n t r a vail s a n s se p r é o c c u p e r de l a n a t u r e p a r t i c u l i è r e d e
c e t r a v a i l . Ce p o i n t m é r i t e d ' ê t r e c o n s i d é r é d e p l u s
près car cette t r a n s f o r m a t i o n de c h a l e u r en
vail
n'est
que
p a s s a g è r e ; le t r a v a i l
tra-
retourne
b i e n t ô t à l ' é t a t d e c h a l e u r il n ' a f a i t q u e s e r v i r a u
transport
do la c h a l e u r e n r e n d a n t
exceptionnellement
sa
diffusion
rapide.
L e t r a v a i l d e la d é t e n t e d ' u n e x p l o s i f d é t o n a n t
à l'air libre est d é p e n s é au p r e m i e r m o m e n t
p r o d u i s a n t d a n s l'air a m b i a n t u n e onde
m é e q u i se p r o p a g e i n d é f i n i m e n t
en
en
compri-
s'amortis-
s a n t p r o g r e s s i v e m e n t p a r le f a i t d e l a p r o d u c t i o n
de c h a l e u r r é s u l t a n t des r e m o u s de l'air. La chal e u r est ainsi diffusée
dans une masse
indéfinie
d'air, q u i ne peut s'échauffer q u e d ' u n e q u a n t i t é
insensible. Mais ce résultat
final
a été p r é c é d é
s u r le p a s s a g e d e l ' o n d e c o m p r i m é e , ( l ' o n é c h a u f fernent b e a u c o u p p l u s considérable, qui dépasse
Lfc CFIATEI.IEB — G r i a a u .
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
10
certainement
la t e m p é r a t u r e c l ' i n f l a m m a t i o n
rlu
g r i s o u a u v o i s i n a g e de l'explosif, là o ù les p r e s s i o n s soni e n c o r e très c o n s i d é r a b l e s . P o u r q u e l'inf l a m m a t i o n n e s e p r o d u i s e p a s il f u u l q u e l a d u rée de c o m p r e s s i o n en c h a q u e p o i n t de l'air soit
a s s e z f a i b l e p o u r n e p a s d o n n e r le t e m p s ¿1 lu c o m b u s t i o n d u g a z d e c o m m e n c e r . Il e s t é v i d e n t q u e
ce t e m p s
est d ' a u t a n t
plus
g r a n d q u e la m a s s e
d e l'explosif q u i se d é t e n d est p l u s c o n s i d é r a b l e .
Les chances d'inflammation du grisou sont donc
d ' a u t a n t p l u s f o r t e s q u e le p o i d s d e l ' e x p l o s i f e s t
plus grand.
Quand
l'explosif
est e n t o u r é d ' u n e
enveloppe
a y a n t u n e c e r t a i n e m a s s e c o m m e les p a r o i s d ' u n
tube
de p l o m b , u n e partie du travail m é c a n i q u e
c o m m u n i q u é e au m é t a l s o u s f o r m e de force vive,
n'est p l u s d i s p o n i b l e p o u r la c o m p r e s s i o n d u g a z ,
les c h a n c e s d ' i n f l a m m a t i o n e n s o n t
d'autant
di-
minuées.
Quand
l'explosif
dre dans
tous
a u l i e u d e p o u v o i r se d é t e n -
les s e n s est e n f e r m é d a n s u n t r o u
de m i n e d o n t les p a r o i s n e c è d e n t p a s , les c o n d i tions sont au contraire
presque
siné
lout
dans
les
f o r m e d e force
le t r a v a i l
bien
plus
défavorables,
produit reste
emmaga-
gaz de la d é t o n a t i o n , p a r t i e
vive de translation,
sous
partie sous
f o r m e de force v i v e d e s r e m o u s i n t é r i e u r s ; la vi-
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
tessG d o t r a n s l a t i o n s e
tranforrne
p i d e m e n t a u m i l i e u d e l ' a i r en
L i e s et b i e n t ô t c e s
d'ailleurs ra-
remous sembla-
remous restituent
s o u s f o r m e de c h a l e u r . A u s s i d a n s les
m i n e faisant, c a n o n ,
l'énergie
coups
la t e m p é r a t u r e
finale
gaz b r û l é s est n é c e s s a i r e m e n t b i e n p l u s
La p r o j e c t i o n
du
bourrage atténue
m e n t c e t effet d ' a u t a n t
plus
que
sa
de
des
élevée.
partielleniasse
est
plus considérable.
T o u t e s ces c o n s é q u e n c e s
théoriques
g o u r e u s e m e n t vérifiées p a r
46.
mage
Influence
sont
ri-
l'expérience.
des explosifs
d u g r i s o u . — Les explosifs
sur
l'allu-
défiagrants,
la p o u d r e n o i r e , e n f l a m m e n t t o u j o u r s les m é l a n ges c o m b u s t i b l e s de grisou quelles q u e soientles
conditions de leur e m p l o i .
E n p l a ç a n t l a p o u d r e n o i r e au m i l i e u d ' u n s a c
p l e i n d ' e a u , l ' i n f l a m m a t i o n se p r o d u i t e n c o r e .
11 s e m b l e p o u r t a n t q u e , d a n s u n c o u p d e m i n e
bien
bourré
d o n t les p a r o i s
résisteraient
à
la
r u p t u r e assez l o n g t e m p s p o u r laisser la c o m b u s t i o n s ' a c h e v e r , on d e v r a i t o b t e n i r p a r d é t e n t e u n
refroidissement
analogue
brisants.
conclusion
Cette
à celui
des
est bien
explosifs
vraisem-
b l a b l e , m a i s il n ' e s t p a s p o s s i b l e d a n s la p r a t i q u e
de
réaliser les c o n d i t i o n s
parois
ne
v o u l u e s . O u b i e n les
cèdent pas du tout
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
et l'effet d e
l'ex-
plosif e s t n u l , o u Lien les p a r o i s c è d e n t el elles
l e f o n t t o u j o u r s a l o r s a v a n t l a fin d e l a c o m b u s tion ; de la p o u d r e e n f l a m m é e
est projetée
dans
le g a z q u i s ' a l l u m e .
L a t e m p é r a t u r e de combustion par son élévation
rend
l'inflammation
de plus
e n p l u s cer-
taine. L e mélange en proportion variable de d y namite et
d'azotate d ' a m m o n i a q u e
donne
explosifs dont la t e m p é r a t u r e de détonation
v a r i e r d e i 2 5 o ° à 2960°. L ' e x p é r i e n c e
que
d e s c a r t o u c h e s s e m b l a b l e s d e 5o
a
des
peut
montré
grammes
d é t o n a n t à l'air libre n ' a l l u m e n t pas le grisou,
q u a n d l e u r t e m p é r a t u r e d e c o m b u s t i o n e s t infé0
r i e u r e à 2200 , ce q u i c o r r e s p o n d à la corn p o s i t i o n ,
60 p a r t i e s d e d y n a m i t e
e t 4°
parties d'azotate
d ' a m m o n i a q u e . Elles l'allument à coup s û r pour
les p r o p o r t i o n s de d y n a m i t e s u p é r i e u r e s .
L ' i n f l u e n c e de la m a s s e des e n v e l o p p e s solides,
qui
e n t o u r e n t l'explosif
et
peuvent
absorber
u n e p a r t i e d e s o n é n e r g i e , se d é m o n t r e e n e n f e r m a n t des cartouches de d y n a m i t e , des amorces de
fulminate dans des tubes métalliques d'épaisseur
croissante. Ainsi une cartouche de dynamite de
5o g r a m m e s e n f e r m é e
25 m i l l i m é t r é s
dans
u n tube d'étain d e
de d i a m è t r e intérieur et 3 milli-
mètres d'épaisseur a l l u m e le g r i s o u , t a n d i s qu'elle
n e lefait plus Iorsquele diamètre i n t é r i e u r r e s t a u t
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
le m ê m e , l ' é p a i s s e u r e s t p o r t é e à 7
millimètres.
Les m e s u r e s c a l o r i m é t r i q u e s o n t m o n t r é q u e la
fraction de l ' é n e r g i e a b s o r b é e p a r la p r o j e c t i o n d u
t u b e e s t d e 20 "/„ d a n s l e p r e m i e r c a s e t d e 33
d a n s le s e c o n d . C e r t a i n e s a m o r c e s
de m e r c u r e ,
les a m o r c e s
non
au
%
fulminate
renforcées
d e la
m a r i n e , a l l u m e n t r é g u l i è r e m e n t le g r i s o u ; elles
cessent de le faire l o r s q u ' o n les e n t o u r e d ' u n
de cuivre
de u n
d e m i - m i l l i m è t r e de
fil
diamètre
enroulé à spires serrées.
L a pression
initiale
des gaz q u i se
détendent
a u n e i n f l u e n c e n o n m o i n s n e t t e : o n p e u t la faire
varier p o u r u n m ê m e explosif en faisant varier
sa densité de c h a r g e m e n t ,
c ' e s t - à - d i r e le
d'explosif
l'unité
renfermé
dans
de
poids
volume.
A i n s i les a m o r c e s a u f u l m i n a t e de m e r c u r e r e n forcées n ' a l l u m e n t p a s le g r i s o u , t a n d i s q u e les
amorces
non renforcées
primées
et p a r
suite
qui
gement moindre, l'allument.
sous la charge de
5o
sont
ont une
moins
com-
densité de char-
La dynamite,
grammes
n'allume
qui
pas
le g r i s o u d a n s l e s t u b e s d ' é t a i u d e ¿ 5 m i l l i m è t r e s
s u r 3i m i l l i m é t r é s de d i a m è t r e , l ' a l l u m e d a n s les
mêmes
tubes
q u a n d , a u lieu de r e m p l i r t o u t le
diamètre des tubes, on y laisse u n espace
annu-
laire vide.
L ' a c c r o i s s e m e n t d e poids
des cartouches
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
d'ex-
plosifs
augmente
l'aptitude
qu'elles
ont
pour
a l l u m e r le g a z . L e s m é l a n g e s d e Go d y n a m i t e et
4o a z o t a t e d ' a m m o n i a q u e
q u i n ' a l l u m e n t p a s le
g r i s o u a l a c h a r g e d e 5o g r a m m e s l ' a l l u m e n t à
l a c h a r g e d e 100 g r a m m e s . L e s m é l a n g e s d e 20 c o ton o c t o n i t r i q u e et 4° a z o t a t e d ' a m m o n i a q u e
n'allument pas
à la c h a r g e
a l l u m e n t à l a c h a r g e d e 200
de
sur
nettement
aux
M.
l'inflammation
établie
mines
Simon
de
par
Liévin
4
( )
de
du
des
mine
gaz
débour-
a
été
expériences
sous
ingénieur
qui
grammes
grammes.
E n f i n l ' i n f l u e n c e d e s coups
rants
îoo
la
très
faifes
direction
divisionnaire
de
de
ces
m i n e s . L e s e x p l o s i f s 20 d y n a m i t e , 80 a z o t a t e d ' a m o n i a q n e et g , 5 c o t o n
o c t o n i t r i q u e , go
nzotale
d ' a m m o n i a q u e q u i n ' a l l u m e n t p a s l e gaz
rage
en
d'éclai-
d é t o n a n t à l'air l i b r e s o u s la c h a r g e
de
5o g r a m m e s , l ' a l l u m e n t
lorsqu'ils sont chargés
sans
canon
bourrage dans
un
d ' a c i e r ; il s u f f i t
m
d ' u n b o u r r a g e de s a b l e de o ,02 de h a u t e u r
empêcher
plus
l'inflammation.
Avec
f o r t e d e 200 g r a m m e s il f a u t
m
une
un
p l u s é p a i s d e o , o 5 . Cet a c c r o i s s e m e n t
1
pour
charge
bourrage
du
dan-
f ) SIMON. — Note relative à des essais faits
aux
Mines de Liévin, sur les explosifs
de sûreté.
Annales
de» mines, 8· Série, t . XVI11, p. HSo, 1890.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
ger des
coups débourrants
et
considérations
des
r é s u l t e d a n s ce
théoriques
cas
développées
p l u s h a u t s u r le m o d e d e d i f f u s i o n d e l a c h a l e u r
et a u s s i d e c e q u e c e s e x p l o s i f s
d é t o n e n t très in-
c o m p l è t e m e n t ii l ' a i r l i b r e e t d é g a g e n t p a r
moins
de c h a l e u r
que
dans
épaisses. L e b o u r r a g e suffit
un
tube
gomme.
m
a ,3u
plus
élevée
parois
e n c o r e à a t t é n u e r le
d a n g e r d'explosifs à t e m p é r a t u r e de
beaucoup
suite
à
tels
que
combustion
la
U n e c h a r g e de 55 g r a m m e s
dynamite
bourrée de
n ' a l l u m e p a s le g a z d ' é c l a i r a g e . L e s b o u r -
rages suffisants
dans
le g r i s o u , o n t été t r o u v é s
p l u s faibles e n c o r e .
47.
Calcul
de
températures
la
limite
d'explosion.
inférieure
—
Des
des
diverses
conditions d o n t d é p e n d la p l u s ou m o i n s g r a n d e
sécurité des explosifs, la t e m p é r a t u r e de c o m b u s tion
est celle
qui
a l'influence prépondérante ;
c'est a u s s i la s e u l e q u i s u i t d é t e r m i n é e p a r la n a t u r e de l'explosif et q u i n e p u i s s e être a l t é r é e p a r
la n é g l i g e n c e
des ouvriers c h a r g é s
p l o y e r . Il y a d o n c g r a n d
intérêt
le s e u l m o y e n d e l ' a b a i s s e m e n t
de les
à obtenir,
de cette
empar
tempé-
r a t u r e , la p l u s g r a n d e s o m m e de s é c u r i t é p o s s i ble.
Cette t e m p é r a t u r e de c o m b u s t i o n
peut
m e n t être calculée q u a n d on c o n n a î t la
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
facileformule
de la réaction c h i m i q u e produite. Soit, par exemple, l a n i t r o g l y c é r i n e d o n t la f o r m u l e d e réaction
est :
2
2
4 [cm\OAz0 y]
La
r
quantité
éaction
2
i2C0 -t ioii-0 +
de chaleur
s'obtiendra
de f o r m a t i o n
dégagée
en retranchant
de l'explosif
2
fiAz ^o
dans
cette
la chaleur
à p a r t i r de ses élé-
m e n t s simples, q u e l'on trouve dans les tableaux
de t h e r m o c h i m i e , de la c h a l e u r d e f o r m a t i o n de
l ' a c i d e c a r b o n i q u e et d e l ' e a u
comptée
à partir
des
qui sont produits,
mêmes
éléments.
On a
ainsi :
q =
a l
4?.8,5 — 9 8 , 9 — 3 2 i / , G
Mais les d o n n é e s n u m é r i q u e s de t h e r m o c h i m i e
s e r a p p o r t e n t p r e s q u e t o u j o u r s a u x r é i i c t i o n s effectuées
à pression
constante.
Il faut
dans
c a s a u g m e n t e r l e n o m b r e a i n s i c a l c u l é d e n. 0
e 1 1
ce
,5.
E n a p p e l a n t n le n o m b r e de m o l é c u l e s g a z e u s e s ,
(22 l i t r e s ) p r o d u i t e s d a n s l a r é a c t i o n
considérée
ce n o m b r e e s t ici d e 7 , 2 5 . D ' o ù la c h a l e u r d e d é tonation
à volume
constant
de
la
nitroglycé-
rine :
q =
3 2 9 , G -t-
o,5 X
7,25 - - 336,85
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
Connaissant
cotte
quantité
de
c h a l e u r et la
chaleur spécifique du gaz à v o l u m e constant, on
p e u t d é d u i r e la t e m p é r a t u r e d e c o m b u s t i o n
la f o r m u l e
par
connue
o ù c e s t la c h a l e u r s p é c i f i q u e d u m é l a n g e g a z e u x .
Kn r e m p l a ç a n t e p a r son expression en
fonction
d e l q u i est de la f o r m e
a -+- ht
c =
On a r r i v e à u n e é q u a t i o n d u second d e g r é
fa-
cile à r é s o u d r e .
Mais p o u r éviter les e r r e u r s de calcul t o u j o u r s
p o s s i b l e s , il e s t p r é f é r a b l e d e r é s o u d r e c e t t e é q u a tion p a r la m é t h o d e g r a p h i q u e en se s e r v a n t d e s
valeurs n u m é r i q u e s des c h a l e u r s
d'échaulfement
d u gaz q u i o n t été calculées p o u r c h a q u e t e m p é rature. On a toujours, par analogie
avecd'aulrcs
e x e m p l e s s e m b l a b l e s , u n e idée de la t e m p é r a t u r e
cherchée.
Pour
la
nitroglycérine,
explosif
à
c o m b u s t i o n c o m p l è t e , cette Lempérature doit être
voisine
de 3ooo°.
On
calcule alors la
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
chaleur
d'échauíTeinent
des
produits
de la
combustion
p o u r les t e m p é r a t u r e s v o i s i n e s .
ï'ro lints d e la
O
rm husLion
2
3C O
30«)·
<|8,-.
110
3200·
l
•¡./¡I'O*
i
2S00»
'-'lot
I ".
2
A.?.
Total. .
n,
'h
1
lr,.")
11. 1,7
378
3.Í
"î
7,1
P u i s o n t r a c e la c o u r b e a v a n t p o u r a b c i s s c s et
F,,.
Te m p è r a t u r e s
II
i
:
i
1
o r d o n n é e s les t e m p é r a t u r e et c h a l e u r d ' é c h a u f 2600°
2800°
300ü°
3200°
f e m e n t c o r r e s p o n d a n L e s (fiff. 1 1 ) .
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
E t p a r le p o i n t d e l ' a x e
337",
p o n d a n t a la c h a l e u r
troglycérine, soit
des ordonnées
dee1 d é c o m p o s i t i o n
on
corres-
d e la n i -
trace une
parallèle
à l'axe des aheisses q u i c o u p e la c o u r b e en
point d o n t l'abcisse
un
3aoo°.
donne
p r é c i s é m e n t la t e m -
p é r a t u r e c h e r c h é e q u i est de
L o r s q u e , c o m m e d a n s le c a s d u c o t o n p o u d r e ,
l'explosif n e r e n f e r m e p a s assez d ' o x y g è n e
brûler
t o u t le c a r b o n e , il s e f o r m e à
la
pour
fin l e s
quatre corps
CO
CO
2
II
2
2
II 0
d a n s des p r o p o r t i o n s qui ne p e u v e n t être r i g o u reusement
leur
déterminées. Le m a x i m u m
correspondant
à
la
formation
de
de
cha-
l'acide
c a r b o n i q u e , o n d o i t f a i r e le c a l c u l a v e c c e l t e h y pothèse q u i est
la m o i n s favorable. Mais
l e m e n t les é c a r t s d e s
géné-
températures résultant
de
l ' a c h è v e m e n t d e la r é a c t i o n d a n s u n s e n s ou d a n s
l'autre sont assez faibles.
Les c h a l e u r s de f o r m a t i o n de tous les explosifs
n'ont pas été déterminées d i r e c t e m e n t ; m a i s on
p e u t l e s c a l c u l e r apriori
avec u n e assez g r a n d e ap-
p r o x i m a t i o n au m o y e n des d e u x règles s u i v a n t e s
q u i d é c o u l e n t des m e s u r e s effectuées j u s q u ' i c i :
L a c h a l e u r de s u b s t i t u t i o n
dans un
composé
or ganique d ' u n e molécule d'acide azotique m o n o -
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
: l
h v d r a l é (AzO H
2
(H 0
—
B r
i8 ),
l'état liquide,
GW)
;ï u n e
molécule d'eau
corps
étant pris dans
ces d e u x
dégage
Dans la glycérine,
Dana la cellulose
Dans la benzine, la naphtaline, le phénol, et les composés analogues aux p r é cédents
r
3o°»i,. ,
Si d o n c o n a p p e l l e Q la c h a l e u r
de
formation
du c o m p o s é , à p a r t i r d e ses é l é m e n t s , X celle de
l'explosif et n le n o m b r e de m o l é c u l e s d'acide ni"
trique substituées :
La
simples
température
de
détonation
des
explosifs
é t u d i é s j u s q u ' i c i e s t r é s u m é e d a n s le t a -
bleau ci-après. On a désigné sous
le n o m
plosifs simples ceux qui sont constitués
par
d'exun
composé c h i m i q u e u n i q u e ou u n mélange h o m o g è n e d e p l u s i e u r s c o m p o s é s , tel
q u e la
dissolu-
lion de coton o c t o n i t r i q u e d a n s la n i t r o g l y c é r i n e
qui constitue
la d y n a m i t e
gomme,
ou par u n
m é l a n g e d'explosif semblable avec u n e
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
matière
inerte
(silice), m a i s qui
mélanges
mécaniques
ne
de
renferme
plusieurs
pas
de
composés
chimiques distincts :
•ï.Vio
Coton endécanitrique
2<jf)0
17. "10
I I.'ÎO
L e d e r n i e r de ces c o r p s n'est p a s à p r o p r e m e n t
parler u n
façon
e x p l o s i f ; s e u l il n e d é t o n e
complète
mercure.
sous l'action
du
Mais mêlé à d'autres
quantité convenable,
pas
d'une
fulminate
de
explosifs et
en
il d é t o n e p a r f a i t e m e n t
a b a i s s a n t la t e m p é r a t u r e de c o m b u s t i o n
p l o s i f a u q u e l il e s t m ê l é e t c e l a p l u s
ou
de
en
l'ex-
moins
c o m p l è t e m e n t , s u i v a n t q u e l'explosif ajouté d o n n e
ou n o n p a r sa décomposition
d u gaz
combusti-
b l e q u i , e n se c o m b i n a n t à l ' o x y g è n e
disponible
de l'azotate d ' a m m o n i a q u e , fournisse u n n o u v e a u
supplément
de chaleur.
Tous
les
explosifs
de
s û r e t é e m p l o y é s a u j o u r d ' h u i e n F r a n c e d a n s les
m i n e s â grisou sont constitués p a r de semblables
m é l a n g e s d a n s lesquels l'azotate
est
de
beaucoup
l'élément
d'ammoniaque
prépondérant.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
On
c h e r c h e à a u g m e n t e r a u t a n t q u e p o s s i b l e la p r o p o r t i o n d e ce s e l p o u r a b a i s s e r
d'inflammation,
la
température
m a i s l'on est limité par l'apti-
t u d e à la d é t o n a t i o n q u i décroît r a p i d e m e n t .
48. Aptitude
à
la
détonation. —
L'apti-
t u d e li l a d é t o n a t i o n n e d é p e n d p a s s e u l e m e n t d e
la n a t u r e de l'explosif, m a i s a u s s i d e s c o n d i t i o n s
d a n s l e s q u e l l e s il e s t
clos
à
parois
employé.
résistantes,
la
Dans un
vase
détonation
est
p l u s f a c i l e q u ' à l'air l i b r e ; u n e x p l o s i f e n p o u d r e
détone plus facilement
que
l o r s q u ' i l est
com-
p r i m é . M a i s la r é a l i s a t i o n d e ces c o n d i t i o n s f a v o r a b l e s à la d é t o n a t i o n
compatible
Ainsi
les
est en
grande
partie
a v e c les n é c e s s i t é s d e la
seuls
explosifs capables
in-
pratique.
de
détoner
c o n v e n a b l e m e n t d a n s u n trou de mine, s o n t c e u x
qui
détonent déjà
complètement à
l'air
libre.
Des explosifs q u i , d a n s les e x p é r i e n c e s e n v a s e
clos, avaient d o n n é de b o n s résultats ont
com-
p l è t e m e n t é c h o u é q u a n d on a v o u l u les e m p l o y e r
d a n s l a m i n e . C e l a t i e n t à ce q u ' i l r e s t e n é c e s s a i r e m e n t u n v i d e e n t r e la c a r t o u c h e et
les
parois
toujours irrégulières du trou, et s u r t o u t e n t r e les
d i v e r s e s c a r t o u c h e s c o n s é c u t i v e s p l a c é e s d a n s le
t r o u , ce q u i e m p ê c h e l a p r o p a g a t i o n d e l a d é t o n a tion d ' u n e cartouche à l'autre. L'emploi de l'explosif p u l v é r u l e n t a i e g r a v e i n c o n v é n i e n t d'exiger
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
ln f o r a g e d ' u n p l u s g r o s t r o u d e m i n e p o u r l o g e r
le m ô m e p o i d s d ' e x p l o s i f , e t s u r t o u t d e d i m i n u e r
c o n s i d é r a b l e m e n t s o n effet u t i l e p a r c e q u e l a p r e s sion
maxima
obtenue
décroît
très
rapidement
a v e c l a d e n s i t é d e c h a r g e m e n t . On s ' a r r ê t e g é n é ralement à u n sylème m i x t e q u i consiste a e m ployer
l'explosif sous
forme de rondelles
com-
p r i m é e s percées a u c e n t r e . P a r la s u p e r p o s i t i o n
de ces r o n d e l l e s d a n s la c a r t o u c h e , o n réserve u n
vide central q u i est r e m p l i d'explosif p u l v é r u l e n t
destiné à servir de détonateur intermédiaire.
49. Explosifs
d e s û r e t é . — L e s explosifs à
p l u s faible t e m p é r a t u r e de d é t o n a t i o n d o n t l ' e m ploi s'est m o n t r é p r a t i q u e d a n s les
mines
font a u j o u r d ' h u i e n F r a n c e l'objet d ' u n e
et q u i
fabri-
cation courante sont les suivants :
Composition
Azntriie d'aminoTiiarjue 80
Tempe rature ite
dpton ni ion
TtyniimilB n» 1. 2 0
i',fiR°
D y n a m i t e ero m m G ii 2 0/Q de colon. 1 2 .
i
//
S3
U
9 0 , o C o t o n octoQÎtrique 9 , 5
I /|JO»
tl
9 5 , 5 Tri nitron apli taliriQ 4 , 5
>',',.-.<>
Ces e x p l o s i f s o n t , d a n s les e x p é r i e n c e s p r é l i m i n a i r e s , p u d é t o n e r à l'air libre s o u s la c h a r g e d e
2 o o g r a m m e s d a n s d e s m é l a n g e s explosifs de g ri-
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
sou
sans les a l l u m e r . A la c h a r g e
m e s ils n ' a l l u m e n t
beaucoup
pas non
plus inflammables
plus
de 5o g r a m les
mélanges
f o u r n i s p a r le g a z
d ' é c l a i r a g e . Ces e x p l o s i f s n e s e m b l e n t p a s s u s c e p t i b l e s d ' é p r o u v e r , a u m o i n s à l ' a i r l i b r e , le m o d e
de décomposition dit déflagration
a n a l o g u e à la
c o m b u s t i o n do la p o u d r e n o i r e . Q u a n d le r é g i m e
de détonation
vient à cesser,
l'extinction
p l è t e se p r o d u i t ; o n n ' a p a s à r e d o u t e r
com-
les ratés
d e d é t o n a t i o n q u i se p r o d u i s e n t p a r f a i s a v e c c e r tains
explosifs
exemple.
brisants,
la
dynamite
Ce s o n t là les e x p l o s i f s
actuellement
les p l u s
par
sûrs
connus.
U n e seconde catégorie d'explosifs u n peu plus
p u i s s a n t s q u e les p r é c é d e n t s , p a r
pérature
do d é t o n a t i o n
suite
plus élevée
et
à
tem-
partant
u n p e u m o i n s sûrs, sont é g a l e m e n t fabriqués en
F r a n c e et e m p l o y é s d a n s les m i n e s
grisouteuses
p o u r l'abatage des roches particulièrement dures :
Composition
TemriératnrR
de iliilonatioQ
i8w°
1!
70
D y n a m i t e g o m m e à 2 0/o de cntnii. 30.
I8I:>
1770"
187 a
0
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
Ces e x p l o s i f s
m o i n s s û r s q u e les
précédents
en raison de l e u r t e m p é r a t u r e de c o m b u s t i o n p l u s
élevée
voir
ont,
de
présenter
par déflagration.
plus,
l'inconvénient
accidentellement
Dans
les
la
de
pou-
combustion
expériences de labo-
r a t o i r e la d é f l a g r a t i o n n ' a j a m a i s p u ê t r e o b t e n u e
par l'action d ' u n e f l a m m e ou de c h a r b o n
on a observé
ardent,
mais dans
Iss m i n e s
parfois
de
semblables
déflagrations à la suite des ratés
de
détonation.
La
déliquescence
de l'azotate
d'ammoniaque
oblige de conserver ces explosifs d a n s des enveloppes a b s o l u m e n t i m p e r m é a b l e s
à
l'humidité.
O n e m p l o i e g é n é r a l e m e n t à c e t effet d e s
papiers
e n d u i t s de paraffine, cire, ou suif. L e s e n v e l o p p e s
de m a t i è r e s c o m b u s t i b l e s s o n t u n e s o u r c e de d a n ger sérieux ; d a n s la détonation à l'air libre elles
n ' o n t jamais l e t e m p s d e s ' e n f l a m m e r e t p a r s u i t e
ne
peuvent
amener
l'inflammation
d u g a z ; il
n ' e n est p l u s de m ê m e d a n s les t r o u s de m i n e o ù
les gaz c h a u d s r e s t e n t p l u s l o n g t e m p s e n c o n t a c t
avec l'enveloppe et q u e l q u e s
inflammations
été c o n s t a t é e s d a n s d i v e r s e s
mines.
Aux
ont
mines
de G l a n z y , d a n s d e s o b s e r v a t i o n s i n s t i t u é e s à cet
effet, l a p r o p o r t i o n a é t é d e 1 ° /
épais suiffés ; elle a é t é n u l l e
minces
paraffinés.
Ces
0
avec des papiers
avec des
enveloppes
L E CulTELiKn — G r i s o u .
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
en
papiers
papier
11
devraient
être
remplacées
par
des
enveloppes
m é t a l l i q u e s en p l o m b o u é t a i n f o r m é e s , soil p a r
des t u b e s e m b o u t i s , soit p a r des feuilles
minces
e n r o u l é e s et. c o l l é e s . L a r é a l i s a t i o n d e ce
perfec-
t i o n n e m e n t i n d i s p e n s a b l e n ' a été arrêté j u s q u ' i c i
q u e p a r la l é g è r e a u g m e n t a t i o n de p r i x d e r e v i e n t
qui en résulterait.
De n o m b r e u s e s tentatives o n t été faites
pour
abaisser la t e m p é r a t u r e de d é t o n a t i o n des explosifs b r i s a n t s p a r
de matières q u i
se
décomposent p a r l'élévation de t e m p é r a t u r e
l'addition
en
a b s o r b a n t de la c h a l e u r , p r i n c i p a l e m e n t des sels
h y d r a t é s , t e l s q u e le s u l f a t e d e m a g n é s i e ,
l'alun.
Ce p r o c é d é m ê m e p e u t s e m b l e r p l u s r a t i o n n e l
p r e m i è r e v u e q u e celui q u i consiste à a j o u t e r
c o r p s d o n t la d é c o m p o s i t i o n
leur c o m m e
à
un
d é g a g e de la
cha-
l'azotate d ' a m m o n i a q u e et q u i
n'a-
baisse la t e m p é r a t u r e q u e g r â c e à l ' a u g m e n t a t i o n
de la
niasse
d e s g a z p r o d u i t s . E n fait ce p r o c é d é e s t
p e u efficace p a r c e q u e les d é c o m p o s i t i o n s
q u i se
font avec absorption de chaleur exigent réchauffement du corps qui met toujours u n t e m p s relat i v e m e n t l o n g à se, p r o d u i r e . 1 1 f a u t p o u r e m p ê c h e r
l'inflammation
du gaz e m p l o y e r u n
très
grand
e x c è s d e sel e t le p r e n d r e à u n t r è s g r a n d é t a t d e
d i v i s i o n : on c o n s t a t e d a n s l a d é t o n a t i o n à
l'air
libre q u ' i l n ' y a q u e q u e l q u e s c e n t i è m e s d u sel
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
décomposé. D a n s un trou de m i n e la
sition doit è!re
du
contact plus
un
peu
décompo-
plus avancée en raison
prolongé
des gaz
chauds;
ce
r e f r o i d i s s e m e n t p l u s c o m p l e t a u g m e n t e la sécurité,
mais aussi d i m i n u e
sance
considérablement
de l'explosif. U n
explosif
la
puis-
s e m b l a b l e em-
ployé en B e l g i q u e est c o m p o s é de p a r t i e s égales
d e d y n a m i t e g o m m e et d e s u l f a t e d e m a g n é s i e ;
sa sécurité serait c o m p a r a b l e à celle de l'explosif
20
dynamite
e t 80
azotate
d'ammoniaque;
m a i s sa force est m o i n d r e et son p r i x de
revient
doit être p l u s élevé. Les m é l a n g e s à poids é g a u x
de d y n a m i t e o r d i n a i r e
le
carbonate
l'alun
de
ammoniacal,
niaque
se
à
soude,
le
2 J °/
le
de
d
silice
sulfate
de
chlorhydrate
comportent
de
la
même
avec
soude,
d'ammofaçon.
n'est pas impossible
que l'accroissement de
curité résultant
m é l a n g e de
du en
partie
du
à la force
vive
ces c o r p s
qu'ils
p o u r être projetés p a r les gaz de la
et q u ' i l s
jouent
langes
dépend
est
détonation
p a r ces
toujours assez précaire p a r c e
e x c l u s i v e m e n t de la
et d e l ' i n t i m i t é d e l e u r
finesse
soit
absorbent
ainsi u n rùle analogue à
du bourrage. La sécurité obtenue
Il
sé-
celui
mé-
qu'elle
des matières
m é l a n g e ; ces d e u x
con-
ditions sont au contraire sans influence p o u r les
m é l a n g e s r e n f e r m a n t de l'azolate
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
d'ammoniaque
parce
que
la d é c o m p o s i t i o n
de ce corps
continuer à être complète sans que
le
peut
mélange
soit très i n t i m e .
A p r è s l'abaissement de la t e m p é r a t u r e de déton a t i o n , la c o n d i t i o n q u i a le p l u s d ' a c t i o n s u r la
s é c u r i t é d e l ' e m p l o i d e s e x p l o s i f s e s t la g r a n d e u r
du travail m é c a n i q u e qu'ils elfectuent. P o u r augm e n t e r ce t r a v a i l d e d é t e n t e , i l f a u t a c c r o î t r e
la
p r e s s i o n i n i t i a l e et p a r s u i t e l a d e n s i t é d e c h a r g e m e n t ; il y a d o n c i n t é r ê t
à
vide qui existe inévitablement
remplir
entre
l'espace
la
c h e et les p a r o i s ; on a u g m e n t e a i n s i ,
cartou-
du
même
c o u p , l'effet u t i l e d e l ' e x p l o s i f . C e r é s u l t a t e s t o b tenu
avant
très facilement en plaçant a u fond du trou
l'introduction des cartouches
d'explosifs
des m a t i è r e s g é l a t i n e u s e s telles q u e la b o u r r e Chalon-Guérin, ou plus s i m p l e m e n t
pâte coulée d a n s des t u b e s
en
de
la
papier.
colle de
Ces
ma-
tières relluenl. a u t o u r des c a r t o u c h e s et r e m p l i s sent l'espace
v i d e ; il f a u t
éviter
que
pénètre d a n s les explosifs à l'azotate
l'eau
ne
d'ammonia-
q u e , ce q u i les e m p ê c h e r a i t de d é t o n e r ; ce d a n g e r
est à c r a i n d r e p o u r la p r e m i è r e c a r t o u c h e
seule
q u i a d û ê t r e o u v e r t e p o u r i n t r o d u i r e le d é t o n a teur. Le plus
simple
est
d'employer
pour
c a r t o u c h e a m o r c e 25 g r a m m e s d e d y n a m i t e .
explosif
ne c r a i n t pas l'eau et, à c h a r g e
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
la
Cet
aussi
réduite,
son
emploi
ne
saurait
être
dange-
reux.
D a n s le cas des c o u p s d é b o u r r a n t s , le b o u r r a g e
seul est projeté et sa force v i v e s e u l e a m è n e
dépense
de
c h a l e u r ; il y a d o n c g r a n d
une
intérêt
p o u r a t t é n u e r le d a n g e r , t o u j o u r s très g r a v e
dp
ces c o u p s , d e d o n n e r a u b o u r r a g e l a p l u s g r a n d e
longueur possible. On n e doit pas descendre a u dessous de cinq centimètres
d'explosifs
par
100
grammes
d e s û r e t é . D a n s les cas o ù l'on
drait chercher à atténuer
le
danger
vou-
d'explosifs
brisants, à t e m p é r a t u r e de détonation très élevép
c o m m e la d y n a m i t e g o m m e , il f a u d r a i t a u m o i n s
employer u n e hauteur de bourrage triple.
50.
Allumage
des
coups
de
L e s p r o c é d é s q u i s e r v e n t à l a mise
mine.
de
feu
—
des
explosifs s o n t , c o m m e les explosifs e u x - m ê m e s ,
une source de dangers très sérieux. L a
tion des explosifs
brisants
est
détona-
toujours
provo-
quée au moyen d'un détonateur au fulminate
h
r
de
s r
m e r c u r e r e n f e r m a n t d e o " ,5 à i , 5 d e f u l m i n a t e .
Ces d é t o n a t e u r s n e p r é s e n t e n t e n e u x - m ê m e s a u cun
la
d a n g e r , m a i s il n ' e n e s t p a s d e m ê m e
mèche
q u i sert à les a l l u m e r .
pour
Actuellement,
les seuls p r o c é d é s d e t i r a g e des c o u p s de m i n e q u i
présentent u n e sécurité q u e l c o n q u e en présence
du grisou, sont fournis
soit p a r les a m o r c e s
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
à
friction d a n s lesquelles la d é t o n a t i o n
du
nate est provoquée par l ' a r r a c h e m e n t
fulmi-
d'un
ru-
g u e u x c o m m e d a n s les é t o u p i l l e s d e s c a n o n s soit
p a r les a m o r c e s é l e c t r i q u e s d o n t
l'inflammation
est o b t e n u e p a r des c o u r a n t s à faible t e n s i o n .
ne semble pas impossible
cependant
de
Il
perfec-
t i o n n e r la m è c h e o r d i n a i r e de f a ç o n , à r e n d r e sa
c o m b u s t i o n sans d a n g e r ; différents procédés perm e t t e n t déjà d'effectuer son a l l u m a g e
capacités
dans
closes isolées de l'air de la m i n e .
conomie qui résulte
de
l'emploi
de
r e n d très d é s i r a b l e la réalisation
de
la
des
L'é-
mèche
semblables
perfectionnements.
Les m è c h e s , telles qu'elles sont
aujourd'hui
fabriquées, devraient être proscrites des m i n e s à
g r i s o u et r e m p l a c é e s p a r l e s a m o r c e s é l e c t r i q u e s
à. f a i b l e t e n s i o n o u l e s a m o r c e s
s o n t l e s u n e s et l e s a u t r e s s a n s
51.
de
friction
qui
danger.
Calcul théorique de la pression d'une
c h a r g e e x p l o s i v e . — D a n s les r e c h e r c h e s q u i
p e u v e n t être p o u r s u i v i e s afin de t r o u v e r de n o u veaux
explosifs convenables p o u r
l'exploitation
des m i n e s à g r i s o u on a à se p r é o c c u p e r n o n seul e m e n t d e la t e m p é r a t u r e d o n t d é p e n d la s é c u r i t é
mais
encore
de
la
pression
d'explosion
d é p e n d l'effet u t i l e . C e l t e p r e s s i o n
peut,
l a t e m p é r a t u r e , ê t r e c a l c u l é e a priori
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
dont
comme
e n se d o n -
n a n f l ) i c n e n l e n t l u le v o l u m e i l a n s l e q u e l o n
d é t o n e r u n poids c o n n u de l'explosif,
fait
c'est-à-dire
sa d e n s i t é d e c h a r g e m e n t .
L a loi d e M a r i o t t e n ' e s t p l u s
applicable
pressions élevées que produisent
elle doit être
modifiée
formule
—= c ,
t c
PV
férence entre
en
le
ce v o l u m e
les
explosifs,
remplaçant
volume
V
aux
dans
la
p a r l a dif-
et u n e q u a n t i t é
cons-
t a n t e v a p p e l é e c o - v u l u m e q u i e s t le m i l l i è m e d u
v o l u m e de la m ê m e q u a n t i t é de gaz m e s u r é e à la
t e m p é r a t u r e d e o" e t à la p r e s s i o n d e 760. L a loi
de G a y - L u s s a c à v o l u m e c o n s t a n t est e n c o r e
ri-
g o u r e u s e m e n t a p p l i c a b l e d a n s ce cas a u x t e m p é r a t u r e s é l e v é e s . O n a d o n c d a n s le c a s d e s e x p l o sifs la f o r m u l e
P ( V — r) — I l ( a 3 +
7
ou
en
gazeuses
appelant
(une
n
le
nombre
0
de
molécules
m o l é c u l e e s t la q u a n t i t é
de
gai
q u i o c c u p e 2 2 ' " , 3 2 à la t e m p é r a t u r e d e o° e t à l a
p r e s s i o n d e 7G0), e x p r i m a n t l e s p r e s s i o n s
k i l o g r a m m e s p a r c e n t i m è t r e c a r r é , les
P
V en litres.
p (y _
V
n — =
1000 /
n o,o843 (37
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
3
en
volumes
•+- 0
En appliquant
rine chargée
c e t t e f o r m u l e à la
h raison
d'un
nitroglycé-
équivalent
pesant
227 g r a m m e s d a n s u n l i t r e , o n a , c o m m e c e l a a
été dit p l u s h a u t :
n =
7, a 5
t — 3'joo
on en déduit
P
-
k
2
5oo *.
Cette formule n e peut être r i g o u r e u s e m e n t app l i q u é e q u ' a u x p r e s s i o n s i n f é r i e u r e s à 10000 k i l o g r a m m e s car sa vérification e x p é r i m e n t a l e n'a
pu
être
Quand
poussée au-delà de 5ooo
on veut
l'appliquer
kilogrammes.
a u x explosifs
déto-
n a n t sous leur p r o p r e v o l u m e , on est conduit a
calculer des p r e s s i o n s n é g a t i v e s ; cela m o n t r e , o u
bien
q u e la f o r m u l e n ' e s t p l u s exacte a u x p r e s -
sions très élevées ou plus v r a i s e m b l a b l e m e n t q u e
l'excès de pression s'oppose à la p r o d u c t i o n
réactions chimiques qui accompagnent
la
des
déto-
n a t i o n et q u e la d é c o m p o s i t i o n des explosifs cesse
d'être
possible lorsqu'ils sont enfermés dans u n
v o l u m e trop petit.
O n m e t s o u v e n t cette f o r m u l e sous u n e forme
u n p e u différente d a n s laquelle
entre,
du v o l u m e , la densité de c h a r g e m e n t
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
\,
au
lieu
c'est-à-
d i r e le n o m b r e d e k i l o g r a m m e s d ' e x p l o s i f s
ren-
fermés dans u n litre.
E n a p p e l a n t E le p o i d s e n k i l o g r a m m e s d e l a
substance
en
litres
V qui donne n molécules de gaz, nous
contenue
dans
le v o l u m e
avons
la relation
qui, reportée dans l'équation
ci-dessus,
après avoir divisé p a r V les d e u x
n
. o , o 8 4 3 (273
~~~ E
ou
en posant
r
p . 0,0843 ( 2 3
7
et
71 . 2 2,32
E
1000
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
+
donne,
membres
t)
4
C e s d e u x g r a n d e u r s f cl t n e d é p e n d e n t
que
de la n a t u r e c h i m i q u e de l'explosif et n u l l e m e n t
des c o n d i t i o n s de son e m p l o i ; ce s o n t des const a n t e s c a r a c t é r i s t i q u e s q u i , u n e fois d é t e r m i n é e s ,
p e r m e t t e n t de calculer
sion
produite par
très s i m p l e m e n t la pres-
l'explosif
dans
des
circons-
t a n c e s d o n n é e s . P o u r d é t e r m i n e r le c o e f f i c i e n t
on
peut évidemment choisir
arbitrairement
E,
c a r n l u i e s t p r o p o r t i o n n e l ; le p l u s s i m p l e e s t d e
prendre
le
poids
équivalent
de
Q u a n d on applique celte f o r m u l e ,
q u e le t e r m e a
varie peu
d'un
la
substance.
on
remarque
explosif
a l'au-
t r e , d e s o r t e q u e p o u r les d e n s i t é s d e c h a r g e m e n t
p a s t r o p é l e v é e s , la p r e s s i o n P v a r i e d ' u n
explo-
sif à l ' a u t r e , à d e n s i t é d e c h a r g e m e n t é g a l , p r o portionnellement
coefficient
f, q u i p o u r
motif est s o u v e n l e m p l o y é p o u r
au
caractériser
force des explosifs et e s t i m e r l e u r p u i s s a n c e
l a t i v e . L e t a b l e a u s u i v a n t d o n n e p o u r les
cipaux
explosifs,
les v a l e u r s de P
les v a l e u r s d e
pour
une
m e n t d e u,5 e t l e s t e m p é r a t u r e s :
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
de
la
re-
prin-
«, c e l l e s do
densité
ce
f,
charge-
K\[>\O-'\[A
Dynamite gomme
Dynamite n ° i
Coton endi-canitrique.
Coton octonitrique
Acide picrique
EXPLO-ilKS
A
.
.
.
P
3
F
t
quju 0,710 7000 liogn
u, 710 il.". Su •2(1 '|U
0/|()0 O.SflO
2Ljn
H.i.H) 2U*>^
aii:io
g 600 0,877 «."170 2 t a o
L'AZOTATK
TJ'AMMONIAQUK
o,
V.IÏI
Binitronapiitaline .
0,7.")
7700 2 l ( «
(¡'1^0 I8I:"I
G'HIO 1800
1770
II
71 ,"io 187,"!
S',0.". 0 919
70SN 0,897
fiSuo 0,900
7000 11
7(100 0,910
o,3o Dynamite gomme. .
o/fO Dynamite n° i .
o, i;> Coton octonitrique .
0,08.") Binitronaphtaline .
AzotatG de cuivre a m m o -
o.ia Dynamite gomme. .
o,-20 Dynamite no i
0,09:1 Coton octonitrique.
o.o'jT) Trirutronaphtahne .
Azotate d'ammoniaque .
O n v o i t p a r le chilTro
,1 I ")U
0,79(1
0,9'p
17."10
(: [Ou
6-JO.S o.n'i'i ôfl'l" . ',<;«
1 \~w
fjb'oo II
//
OJOÛ
.
0,95:1
:VJ:")0
. fuHo 0.97(1 .Î080 113o
des
pressions
p o n d a n t à o,5 q u e les explosifs a y a n t
corres-
une
tem-
p é r a t u r e d e d é t o n a t i o n d e 1800 o n t u n e f o r c e à
peine s u p é r i e u r e à celle
des explosifs de
L'écart serait moindre encore pour
de c h a r g e m e n t
supérieures.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
des
i5oo.
densités
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
BIBLIOGRAPHIE
GÉNÉRALITÉS
IIATON
DE LA G O U P I L L I È R E . —
Rapport
présenté
au n o m d e la C o m m i s s i o n d u grisou.
les des Mines,
7 série ; X V I I I , 193).
JANET. — T r a d u c t i o n
p a r extrait d u rapport de
la C o m m i s s i o n p r u s s i e n n e d u g r i s o u .
des Mines,
(Anna-
e
(Annales
e
8 s é r i e ; V I I I , 600).
PELLE. — A n a l y s e des r a p p o r t s d e la C o m m i s s i o n p r u s s i e n n e d u g r i s o u . (Annales
des
Mines,
8" s é r i e ; I X , 5<j8).
MALLARD et L E CUATELIEH. —
S u r les t r a v a u x
la c o m m i s s i o n p r u s s i e n n e d u g r i s o u .
les des Mines,
e
8 série ; I X , 638.
LORIECX. — R é s u l t a t s
d e l ' e n q u ê t e faite e n A n -
gleterre p a r u n e commission
accidents
de
(Anna-
des mines
spéciale s u r les
(Annales
des
Mines,
8" s é r i e ; X , i o 3 ) .
WAHRINGTON
S.MYTH.
—
(Traduction).
de la C o m m i s s i o n anglaise d u g r i s o u .
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
Rapport
(Revue
174
I.K
universelle
onisui:
des Mi;:es
E
de Ctajper,
I
série ;
XXII, 121, aitiet 433).
CHES.VEAU. — A n a l y s e
d e s r a p p o r t s de la Com
m i s s i o n a u t r i c h i e n n e d u g r i s o u . (Annales
Mines,
9° s é r i e ; I ) .
AGUII.LOV
sur
des
et
PEUNOLET.
u n voyage
—
A n g l e t e r r e (Publication
grisou.
Dunod,
Rapport,
en Belgique,
de
mission
Allemagne
de la commission
et
du
1881).
JA.MIN. — L e g r i s o u . (Revue
des
Deux-Mondes,
1880).
CUESNEAU. — A n a l y s e d e s t r a v a u x d e la C o m m i s
sion
autrichienne
Mines,
du grisou.
(Annales
des
1892).
PROPRIÉTÉS DU GRISOU
D A V V . — L e g r i s o u . (Annales
Chimie,
i
r o
de Physique
et de
s é r i e t . 1).
MALLAHD et L E C U A T E M E H . —
Recherches expéri
m e n t a l e s et t h é o r i q u e s s u r la c o m b u s t i o n d e s
mélanges
Mines,
gazeux
explosifs.
janvier, février,
(Annales
MAI.LAIW. — S u r la n o n - i n l l a m m a b i l i t é
sou
des
1882).
d u gri
p a r les étincelles p r o v e n a n t d u choc de
l ' a c i e r . [Annales
des Mines,
«99)·
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
P
8- série ; XVIII,
DE
M\RSILLY.
houille.
—
Sur
(Annales
les
gaz
dégagés
des Mines,
5
e
île
la
série ; X I I ,
337)·
LECLEHC. — S u r
l'impossibilité
d'enflammer
grisou p a r les étincelles d ' u n pic,
le
(Industrie
e
Minérale,
3 série; I I I , 1015).
GISEMENT ET DÉGAGEMENT DU GRISOU
E. VAUX.
— Des dégagements
g r i s o u . (Société
s é r i e ; X I I , 4 1 1 cl Revue
1
r e
instantanés d u
de l'Industrie
Minérale.
des Mines
de
i
r o
Cuyper,
série ; X I X , 281).
DUKRWE. — D é g a g e m e n t s instantanés de grisou.
Industrie
Minérale,
3° s é r i e ; I , 5 4 . " ) .
IIAHZÉ. — M e s u r e s à p r e n d r e c o n t r e les d é g a g e m e n t s i n s t a n t a n é s d e g r i s o u . (Ibid
; 3" série, I ,
650).
AKNOULT. — E t u d e s s u r l e s d é g a g e m e n t s i n s t a n t a n é s d e g r i s o u . (Annales
de
Belgique,
XXXVII,
de travaux
publics
1).
MAI.I.AIID. — S u r l e s p r e s s i o n s d u g r i s o u d a n s l a
houille
d'après
W o o d . (Annales
CORNET. — Sur
les expériences
des Mines,
la pression
de Lindsay
e
8 série ; I , 5 3 o ) .
du grisou.
m i e r o y a l e d e B e l g i q u e , m a i 187g).
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
(Acadé-
LAMPES DE SÛRETÉ
DAVY. —
Lampe
(Annales
des
de sûreté p o u r
Mines.
i
r o
les
mineurs.
s é r i e ; I , 177 ; V I I I ,
20Q-222 ; X , 27).
BLAVIER. — R a p p o r t s u r la l a m p e de sûreté D u b r u l l e (Annales
PARRAN.
—
des
Note sur
Mines,
la
5" s é r i e ; X T , i o 5 ) .
lampe
électrique
de
D u m a s et s o n a p p l i c a t i o n a u t i r a g e des c o u p s
d e M i n e (Annales
des mines,
5
R
série; I V , 4 J J ) -
DLMAS. — Note descriptive d ' u n e l a m p e photoé l e c t r i q u e (Société
i
ro
de
l'industrie
Minérale,
série ; I X , 5).
MALLARD. — R a p p o r t s u r la l a m p e D u m a s .
IX,
(Ibid,
113.
L E D O U X . — N o t e s u r l a l a m p e D u m a s . (Ibid,
JX,
118).
CALLOW. — L a m p e
(Ibid, I ,
de sûreté
de M .
Dubriille.
275).
PAHENT. —
Description d'un appareil à nettoyer
l a l a m p e d e s û r e t é . (Ibid,
P A R R A N . •— C o n s i d é r a t i o n
I I I , 97).
sur
quelques
lampes
à g a z e t s u r q u e l q u e s effets d u g r i s o u .
VII,
(Ibid,
331).
MALLARD. —
R a p p o r t de la C o m m i s s i o n
ri-nces de S a i n t - E t i e n n e sus
s û r e t é . (Ibid.
XIII,
723).
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
d'expé-
les l a m p e s
de
D i i i n u L L E , -r. L a m p o
1 ° série ;
d e s û r e t é . (Ibid,
XI, 089).
MARSAI:T.
—
Etude
m i n e u r s . (Ibid,
MAHSAUT.
—
s u r la l a m p o de sûrolé des
2" série;
Etude
s û r e t é . (Ibid,
Mueseler.
de Belgique,
MALLARD.
—
lampe
de
181),
lampe
des
de sûreté de
travaux
publiés
I, p. 3op).
D e l a v i t e s s e a v e c l a q u e l l e se p r o -
grisou
sûreté.
la
(Annales
page l'inflammation
et d e
nouvelle
XIII,
2° s é r i e ;
DEVAUX. — R a p p o r t sur
M.
3ai).
d'une
d a n s les
et de la
(Annales
des
mélanges
d'air
t h é o r i e d e la l a m p e d e
7 série ; V I I I ,
e
Mines),
355).
MAI.LARD e t L E CIIATELIKR,
sûreté
M.
à
propos
Marsaut.
S u r les l a m p e s de
des récentes
(Annales
des
expériences
Mines,
8"
de
série;
I I I , 3.-»).
JANET, — S u r u n s y s t è m e de r a l l u m a g e i n t é r i e u r
des
8
e
lampes
do
sûreté
(Annales
des
Mines,
série ; X I , 191).
JANET. — N o t e s u r d i v e r s s y s t è m e s do f e r m e t u r e
des
lampes
de sûreté.
(Annales
des
Mines,
8« s é r i e ; X V I I , 564).
MALLARD.
nes.
— S u r les l a m p e s
(Ibid,
8" s é r i e ; X V I I I ,
L E CIIATELIEH. —
Rapport
é l e c t r i q u e s dfl m i 699).
au congrès
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
interna-
tional des m i n e s d e 1889 s u r les l a m p e s d e s û r e t é (Industrie
MALLAHD
et
Minérale,
III, S y j ) .
L E CUATKLIER.
—
Influence
du
re-
cuit s u r la résistance des verres d e lampes.
(Pièces
annexées
Commission
Dunod,
FUMÂT.
aux procès-verbaux
du
grisov,
de la
a' fascicule,
p . 67,
1880).
— Note s u r u n e nouvelle lampe des û -
r e t é (Alais,
imprimerie
Brugueirolle,
1884)-
F.XPI.OSIFS
MALLARD. — R a p p o r t
s u r l'étude des questions
relatives à l'emploi desexplosifs
d u g r i s o u . (Annales
des Mines,
en présence
8" s é r i e ; X I V ,
1.J7 e t 3 i ) .
9
MALLAHD. — N o t e s s u r d i v e r s e s e x p é r i e n c e s concernant l'emploi d e s explosifs d a n s les m i n e s
à g r i s o u . (Ibid, X V I I , i 5 e t 9 9 ) .
SIMOX. — N o t e r e l a t i v e
mines
(Ibid,
de Liévin
à des essais
faits a u x
s u r les explosifs d e sûreté
e
8 série; XVIII, 58o).
MALLAHD. — R a p p o r t a u congrès d e s Mines de
1889,
s u r l'emploi des explosifs d a n s les m i n e s
à g r i s o u . (Industrie
Minérale,
6.19).
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
3
e
série ; I I I ,
BRUNEAU. — E t u d e s faites à l ' E x p o s i t i o n d e 1889.
(Mémorial
des poudres
et salpêtres,
1891).
AÉRAGE ET CONTROLE LU GRISOU
M U R G U E . — E s s a i s u r l e s m a c h i n e s d ' a é r a g e (Industrie
XX,
Minérale,
5 ; X V , 81 ; X ,
a" s é r i e ; I I , 4 4 ^ ; I V , 7 4 7 ;
119 ; X I I I ,
6 3 et 3
e
série ;
7
I I I , 5 et 3 g i ) . C o m p a r a i s o n des différents a p pareils de ventilation en usage d a n s le Gard.
(Ibid,
e
2 série; V I I , 477 7 i 3 ) .
F R A N Ç O I S . — E x p é r i e n c e s u r l e v e n t i l a t e u r SiV.
(Ibid,
2° s é r i e , X V , 8 9 ) .
VICAIRE. — E x p é r i e n c e s s u r l ' a é r a g e d e s m i n e s à
g r i s o u . (Ibid,
2° s é r i e ; I V , 5).
COQUILLIOX. — A p p a r e i l s e r v a n t à d o s e r l e g r i s o u d a n s l e s m i n e s . (Ibid,
2" s é r i e ; V I , 4 3 i ) -
S I M O X . — N o t e s u r l a l a m p e P i e l e r . (Ibid,
P I E L E R . — (Traduction).
e
3 série ;
Méthode pour
recon-
naître la qualité d e l'air q u i circule d a n s l e s
m i n e s . (Revue
XV,
Universelle
des Mines,
2" s é r i e ;
140).
MALLAHD ET L E CHATELIER.
—
Sur
les
procédés
propres à déceler la présence d u grisou
l ' a t m o s p h è r e d e s m i n e s . (Annales
7
e
série ; X I X , 186).
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
des
dans
Mines,
180
LE o m s o u
M A L L A R D ET L E CIIATEXIEH, — S u r l ' i n d i c a t e u r
grisou
d e M . L i v e i n g . (Annales
des
de
Mines,
8= s é r i e ; I I I , 3 i ) .
CASTEL. — N o i e s u r l ' a p p a r e i l Goijuillion
l'analyse
d u grisou.
(Annales
des
pour
Mines,
7" s é r i e ; X X , 5 o y ) .
IIAHZK. — D e l ' a é r a g e d e s t r a v a u x
d a n s l e s m i n e s à g r i s o u . (Reçue
préparatoires
des Mines
de
r
Cuyper,
i° série, X X , 4^8).
AUCILLON ( E ) . — S u r l e s a p p a r e i l s d o c o n t r ô l e e t
de surveillance de l'aérage des m i n e s .
des
Mines,
(Annales
7° s é r i e ; X X , » 4 8 ) .
DAYARD. — Avertisseur de grisou d e T h . S h a w .
(Ibid.
e
8 série ; X I X , 379).
L E CHATELIEK. — N o t e s u r l e d o s a g e d u g r i s o u
p a r l e s h u i i t e s d ' i n i l a m m a b i l i t é . (Ibid,
XIX,
9
L E CHATELIER. — R a p p o r t
s u r le
d e M . C o q u i l l i o n . (Pièces
des-verbaux
i
e r
8° s é r i e ;
3 6).
de
la
grisoumèlre
annexées
Commission
fascicule, p . 9a. D u n o d ,
aux
du
prugrisou,
1881).
ACCIDENTS ET RÉGLEMENTATION
VKHFILLEUX, — N o t e s u r u n s y s t è m e d e p o r t e s
destinées à lucaliser les accidents
(Industrie
Minérale,
i
r e
de grisou.
s é r i e ; I X , 4G5).
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
MALLARD et
VICVIUE
(E).—
d e K r a m e r i e s . (Annales
Note
des
sur
l'accident
Mines,
7 ° série ;
XV, 5 .5).
7
AUUILLOX. — S u r l e s e x p l o s i o n s
survenues a u x
h o u i l l è r e s d e S e n h a m e t d e P e n y g r a i g . (Annales
des Mines,
y' s é r i e ; X X , 2 4 8 ) 1
LALI.EMAXD. — S t a t i s l i i p i e g é n é r a l e d e s a c c i d e n t s
do
8
e
grisou
en
France.
(Annales
des
Mines,
série ; X , 0 2 1 ) .
liurj.oM. — S u r l a statistique d e s accidents d a n s
les
mines allemandes.
(Annales
des
Mines,
8° s é r i e ; X V i l l i , 4 5 u ) .
DE
CASTELNAU.
— Note
s u r u n e explosion de
g r i s o u s u r v e n u e a u x mines d e P o r t e s e t S é n é **"
c h a s . (Ibid.
XIII, 5aC).
LAURENT. — Note s u r l'accident d e la M a c h i n e
( N i è v r e ) . (Annales
des Mines,
e
8 série ; X I X ,
ii.jti).
HrsGMiiD.
— Premiers soins à donner a u x ou-
vriers blessés après les explosions d e grisou.
(Pièces
annexées
Commission
du
aux
grisou,
procès-verbaux
de
2* f a s c i c u l e ,
la
p. 161,
Dunod).
LAMÉ FJ.EUKY. — T r a d u c t i o n
des deux
lois a n -
g l a i s e s s u r l e s m i n e s d u 28 a o û t 1 8 6 • e t d u 7
août
18(12. (Annales
des Mines,
182).
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
e
7 s é r i e ; 1J,
B u SOUICIT. — R a p p o r t s u r la r é g l e m e n t a t i o n de
l'exploitation dans
nales
des Mines,
Principes à
les m i n e s à g r i s o u .
η" s é r i e ; X ,
consulter
dans
l'exploitation
m i n e s à g r i s o u . ( P u b l i c a t i o n delà
du grisou.
Dunod,
(An
i5i).
des
Commission
1881).
POUSSIERES ET VARIATIONS BAROMÉTRIQUES
G A L L O W A Y . — (Traduction).
présentent
l'exploitation
Universelle
£aÇ).
S u r les d a n g e r s q u e
les p o u s s i è r e s d e c h a r b o n s
des
mines
des Mines
(Industrie
de houille.
e
de Cuyper,
Minérale,
2
e
dans
(Revue
2 série ; II,
série; VII, ιοί
et I X , 129).
MALLAHD
et
LE
poussières
CHATELIER
de houille
m i n e s . (Annales
(E).
dans
des Mines,
H I L T . — (Traduction).
—
Du
verselle
409
des
8° s é r i e ; I, 5).
et 4 ' 9
dans
d e s m i n e s d e h o u i l l e . (Revue
Mines
des
S u r les d a n g e r s q u e pré-
s e n t e n t les poussières de c h a r b o n
ploitation
rôle
les a c c i d e n t s de
de Liège.
Industrie
l'exUni-
2" s é r i e ; X V I I I ,
Minérale,
e
2 série ;
XIV, i33-uj6 et 58g).
H I L T . — (Traduction).
Expériences sur l'inflam-
mation des poussières en présence du grisou.
(Ibid,
X I X , 420).
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
VITAL.
— Recherches
sur
poussières de houille.
7· série ; VII,
SAUVAGE.
—
grisou
entre
de
de MM.
des Mines,
dustrie
atmosphérique
vue
Mines
KŒHLER.
—
d'après
du
les
(Annales
212).
pression
baro-
du grisou.
(In-
2° s é r i e ; V I , 4 4 5 ) .
Influence de la pression
s u r le d é g a g e m e n t d u g r i s o u .
Minérale,
des
explosions
de la
le d é g a g e m e n t
(Traduction).
(Industrie
les
l'atmosphère
7" s é r i e ; X I ,
Minérale,
HILT. —
des
Mines.
Scot et G a l l o w a y .
MURGUE. — D e l ' i n f l u e n c e
métrique sur
des
180).
Relation
et l ' é t a t
travaux
l'inflammabilité
(Annales
de
3" s é r i e ; I , 299) e t
Cuyper,i"
(Traduction).
série ; XIX,
Re-
392),
Influence des varia-
t i o n s d e la p r e s s i o n a t m o s p h é r i q u e s u r le d é g a g e m e n t d u g r i s o u . (Ibid,
e t Revue
XIX,
SIMON.
des
Mines
de
3
e
s é r i e ; 1, 6 2 7 ) ,
Cuyper.
2"
7
—
Rôle
des
poussières
charbonneuses
d a n s l e s e x p l o s i o n s d e g r i s o u . (Industrie
nérale,
série ;
i 5).
2' s é r i e ; I ,
AUUILLOX. —
Note
Mi-
3n).
sur
les expériences d u pro-
f e s s e u r A b e l p o u r é t u d i e r le r â l e d e s p o u s s i è r e s
dans
Mines,
les
accidents
d e s M i n e s . (Annales
des
7' série ; X X , 1 2 1 ) .
D E CHANCOUHTOIS. — E t u d e d e s m o u v e m e n t s d e
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
l'écurce t e r r e s t r e a u p o i n t du v u e d e l e u r rapp o r t a v e c les d é g a g e m e n t s de g r i s o u .
des
Mines,
8° s é r i e ; I X ,
CIIESN'E.VU. — D e l ' i n f l u e n c e
(Annales
207).
des m o u v e m e n t s du
sol et d e s v a r i a t i o n s d e la p r e s s i o n a t m o s p h é r i q u e s u r le d é g a g e m e n t
des
LE
Mines,
du grisou.
(Annales
8" s é r i e ; X I I I , .'58n).
LIIATELU'H.
—1
nfluence des c h a n g e m e n t s de
p r e s s i o n a t m o s p h é r i q u e s u r le d é g a g e m e n t d u
g r i s o u . (Pièces
de
la
Commission
p . 98, D u n o d ,
annexées
du
aux
yrisou,
1881.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
procès-verbaux
i*
r
fascicule;
TABLE D E S MATIÈRES
PREMIERE
CHAPITRE
Xature
PARTIE
PREMIER
et production
du
grisou
Pflgcs
Composition
Analyse
Formation.
Gisemi'iil.
Rendement
'
Dégagement normal
Dégagements brusques
Influences météorologiques
Accumulation
5
7
I*
16
21
26
^2
40
*2
CHAPITRE
Propriétés
du
II
grisou.
Propriétés physiques .
Propriétés chimiques
Combustion du grisou
Température d'inflammation
Limites d'iunammabiiité
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
44
45
4fi
47
48
Vitesse de propagation de la
flamme
Enregistrement des vitesses dp combustion.
Influence des parois froides
Propriétés des toiles métalliques
DEUXIÈME
Cil VPITRE
Causes
49
51
55
57
PARTIE
PREMIER
des
accidents
Généralités
Causes des accidents
Causes d'accumulation du prison
Causes d'inflammation
Lampes à feu nu
Tirage à la poudre
Accidents dus aux lampes de sûreté .
Causes diverses d'inflammation
Causes d'aggravation des accidents
CHAPITRE
Précautions
.
contre
(Q
72
73
76
78
79
80
82
84
II
les
accidents
Généralités
Accumulations grisouteuses
Suppression des poussières de houille . . . .
Ventilation des mines
Indicateurs de grisou
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
PO
1*3
9'i
1)8
160
CHAPITRE
Lampes
de
III
sûreté
Pâçes.
Lampes à feu nu
Lampes de sûreté
Lampe Davy
Lampe Clanny
Lampe Marsaut
Lampe Mueseler
Lampe Fumât
Degré de sécurité des diverses lampes
Pouvoir éclairant
Lampes électriques de mines
CHAPITRE
Explosifs
de
. . . .
118
119
121
124
125
126
127
129
i33
135
IV
sûreté
Généralités
Déflagration et détonation des explosifs. . . .
Abaissement de température par la détente . .
Influence des explosifs sur l'allumage du grisou.
Calcul de la limite inférieure des températures
d'explosion
Aptitude à la détonation
Explosifs de sdrcté
Allumage des coups de mine
Calcul théorique de la pression d'une charge explosible
BlBLIOOKAPHIE
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
138
139
142
147
151
15S
159
16:>
166
173
ST-AMAND (CHER). IMPRIMERIE DESTENAY
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
BUSSIÈRK
FRÈRES
L I B R A I R I E
Envoi
G A U T H I E R - V I L L A R S
ET
FILS
Quai des Grauds-Augustins, 5 5 .
franco contre mandat-poste
ou valeur sur
LEÇONS
( à l'usage
des
Paris
D E CHIMIE
Élèves
de Mathématiques
spéciales)
PAR
Henri
GAUTIER
Ancien élève de l'Ecole Polytechnique,
Professeur de l'École Monge et au collège Sainle-Barbe,
Professeur agrégé à l'École de Pharmacie ;
ET
G e o r g e s
C H A R P Y
Ancien Élève
de l'École Polytechnique, professeur à l'École Monge.
U n b e a u v o l u m e g r a n d i n - 8 , a v e c 8 3 figures ; 1 8 9 2 . . . 9 fr.
Ces Leçons de Chimie présentent ceci de particulier qu'elles n o s o n t
pas la reproduction des Ouvrages similaires parus dans ces dernière»
années. Les théories générales de la Chimie sont beaucoup plus d é v e loppées que dans la plupart des Livres employés dans r e n s e i g n e m e n t ;
elles sont mises au courant des idées actuelles, notamment e n ce qui
concerne la théorie des équilibres chimiques. Toutes ces théories, qui
montrent la continuité qui existe entre les phénomènes chimiques,
physiques et m ê m e m é c a n i q u e s , sont exposées s o u s une forme facilement accessible. La question des nombres proportionnels, qui est
trop souvent négligée dans les Ouvrages destinés aux candidats aux
Ecoles du Gouvernement, est traitée avec tous les développements
désirables. Dans tout le cours du Volume, on remarque aussi u n s
grande préoccupation de l'exactitude , les faits cités sont tirés des
mémoires originaux ou ont été soumis à une nouvelle vérification,Les
procédés de l'industrie chimique sont décrits sous la forme qu'ils p o s sèdent actuellement. L'ouvrage ne comprend que l'étude des métalloïdes, c'est-à-dire les matières exigées pour l'admission aux Écoles
Polytechnique et Centrale.
En résumé, le Livre de MM. Gautier et Charpy est destiné, croyonsn o u s , a devenir rapidement classique.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
LIBRAIRIE
Envoi
GATJTHIER-VILLARS E T
f r a n c o contre
mandat-poste
e u valeur
FILS
sur P a r t i
COURS
DE PHYSIQUE
DE
L'ÉCOLE
-
POLYTECHNIQUE
P A R M.
J.
QUATRIÈME
AUGMENTÉE
ET
JAMIN
ÉDITION
ENTIÈREMENT
REFONDUE,
PAR
M.
BOUTY,
Professeur à la Faculté des Sciences de Paris.
Quatre Tomes i n - 8 , de plus de 4000 papes, avec 1587 figures et
14 planches sur acier, dont 2 en c o u l e u r ; 1885-IS91. (OIIYBAGE.
COUPLET)
72
On vend séparément
TOME I. — 9
fr.
:
fr.
(*) 1 " f d B c i e u l e . — Instruments de mesure. Hydrostatique ; avec 150 figet 1 planche
5 fr2" fascicule. — Physique moléculaire;
avec 9 3 figures . .
4 frTOME II. —
CBALKUR. —
15
fr.
ER
(*) 1 fascicule. — Thermomêtrie.
Dilatations ; avec 9 8 fig .
5 fr.
(*) 2 " fascicule. — Calorirnétrie ; avec 4 8 fig. et 2 planches .
5 fr.
3° fascicule. — Thermodynamique.
Propagation
de la
chaleur;
avec 4 7
figures
5 fr
TOME III.
—
ACOUSTIQUE; OPTIQUE. — 2 2
fr.
r
l » fascicule. — Acoustique ; avec 1 2 3
figures
, .
4 fr.
[*) 2 " fascicule. — Optique géométrique ; avec 1 3 9 figures et 3 planches
4 fr.
3
fascicule. — htude
des radiations
lumineuses, chimiques
et
calorifiques ; Optique physique ; avec 2 4 9 fig. et 5 planches, dont
2 planches de spectres eu couleur
1 4 fr.
a
(*) L e a m a t i è r e s d a p r o g r a m m e d ' a d m i s s i o n à l ' é c o l e P o l y t e c h n i q u e s o n t c o m p r i s e s daas
les partira s u i v a n t e s de l ' O u r r a g e : T o m e I , l
f a s c i c u l e ; T o m e I I , l " e t 2" f a s c i c u l e » ;
T o m e I I I , 2" f a s c i c u l e .
e T
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
c
ΤΟΚΕ IV ( 1 ™ Partie). — ÉLECTMCITÉ STATIQUE
ET DYNAMIQUE. —
1 3 fr.
i" fascicule. — Gravitation universelle. Electricité statique ; avec 1 5 5 fig.
et 1 planche
7 fr.
2 fascicule. — La pile. Phénomènes électrothermiques
et ëlectrochimiques; avec 1 6 1 iig, et 1 planche
6 fr
e
TOMÏ I V . — (2<" Partie). — MAGNÉTISME; APPLICATIONS. — 1 3 fr.
t
3
e
fascicule. —• Les aimants. Magnétisme.
Slectromagnètisme.
Induction; avec 210
figures
8 fr.
4 fascicule. — Météorologie
électrique;
application}
de
l'électricité.
Théories générales; avec 8 4 iig. et 1 pl
5 fr.
E
TABLES GÉaàiuLES.
Tables générales, par ordre de matières et par noms d'auteurs, des
quatre volumes du Cours de P h y s i q u e . I n - 8 ; 1 8 9 1 . . .
LU c.
Tous tes trois ans, un supplément, destiné à exposer
plis pendant cette période, viendra compléter ce grand
tenir au courant des derniers
travaux.
les progrès accom»
Traité et le main-
P o u r n e pas trop grossir un ouvrage déjà bien volumineux, il a
fallu dans cetle nouvelle édition en souinetlre tous les détails à υ ue révision s-évère, supprimer ce qui avait quelque peu vieilli, sacrifier la
description d'appareils ou d'expériences qui, tout en ayant fait é p o q u e , ont été rendus inutiles par des travaux plus parfaits ; eu un mot,
poursuivre dans s e 3 dernières conséquences la transformation entreprise non sans quelque timidité dans l'édition précédente. Au reste,
pour tenir un livre au courant d'une Scieuce dont le d é v e l o p p e m e n t
est d'une rapidité si eurpreuante, et dans laquelle u n seul résultat
n o u v e a u peut modifier j usq n'aui idées môme qui servent de base à l'ens e i g n e m e n t , il ne suffit pas d'ajouter des faits a d'autres faits : c'est l'ord r e , l'enchaînement, la contexture même de l'ouvrage qu'il faut renouveler. On se ferait doue une idée inexacte de cette quatrième édition du
Cours de Physique de l'école Polytechnique en se bornant à constater
<{ue ces quatre Volumes se sont accrus de près de 5 0 0 pages et de
1 5 0 figures, soit de un septième environ : les modifications touchent,
pour ainsi dire, à chaque page et c'est en réalité au moins le tiers d u
texte qui a été écrit à nouveau d'une manière complète.
D U H E M . — Chargé de Cours à l a Faculté des Sciences de Lille. Leçons
sur fulectricité
ci te Magnétisme.
3 volumes grarjd J n - S , avec ¿ 1 5
figures :
Tome I, 1 8 9 1 ; 1 6 fr.—[Tome II, 1 8 9 2 ; 1 4 fr. — Tome III, 1 8 9 2 ; 1 5 fr.
• J A M I N et B O U T Y . — Cours de P h y s i q u e à l'usage de la c l a s s e
d e M a t h é m a t i q u e s s p é c i a l e s . 2» édition. Deux beaux volumes i n - 8 ,
contenant ensemble plus de 1 0 6 0 pages,avec 4 5 8 ligures géométriques
o u ombrées et 6 planches sur acier ; 1 8 8 6
2 0 fr.
On vend séparément
:
T o m e I . — Instrumenta de Mesure. Hydrostatique. — Optique g é o m é trique. Notions sur les phéuoinèues capillaires. In-8, avec 3 1 2 fig. et
-4 p!
1 0 fr.
T o m k II. — Thermométrie. Dilatations. — Calorinaètrie. ln-8, avec 1 4 6
« g . et 2 pl
.
. .
10 fr.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
LIBRAIRIE
Knvoi
G A U T H I E R - V I L L A R S
franco contre mandat-poste
ET
ou valeur
FILS
»ur Poris
B A R I L L O T ( E r n e s t ) , membre de
M a n u e l de l'analyse des vins.
B
la Société chimique d e Paris. —
Dosage des éléments naturels. Recherche analytique
des falsifications.
Petit i n - 8 , avec nombreuse»
figures et Tables; 1889
3 fr. 50
O N N A M I ( H . ) , Ingénieur-Directeur dea usines de font-de-Pany
et
Malain, Conductmr des Ponts e t Chaussées. — F a b r i c a t i o n et c o n trôle
dea
c h a u x
h y d r a u l i q u e s et ciments. Tbéorle
t i q u e . Influences réciproques
et simultanées des différentes
et
pra-
opérations
et de la composition sur la solidification.
Energie.
Thermodynamique.
Thermochimie, ln-8, avec figures; 1888
6 fr. 50
B O Y S ( C . - V . ) , Membre de la Société Royale de Londres, — B u l l e s
d e S a v o n . Quatre conférences sur la capillarité faites devant un
jeune auditoire. Traduit de l'anglais par C H . - E D . GUILLAUME, Docteur
ès-Sciences, avec de nouvelles Notes de l'Auteur et du Traducteur.
]n- 1 8 jésus, avec 60 figures et 1 planche ; lS9i . . . . 2 fr. 15 c.
C H A P P U I S ( J . ) , Agrégé, Docteur ès Sciences, Professeur de Physique
générale à l'Ecole Centrale, et B E R G E T ( A . ) , Docteur ès Sciences,
attaché au laboratoire dea Recherches physiques de la Sorbonne. —
L e ç o n s d e P h y s i q u e g é n é r a l e . Cours professé à l'Ecole Centrale des
Arts et Manufactures et complété suivant te programme de la Licence
ès Sciences physiques. 3 volumes grand
se Tendant séparément :
TOME I : Instruments de mesure. Chaleur. Avec 175 figures ; 1891. 13 fr.
TOME II : Electricité et Magnétisme.
Avec 305 figures ; 1891. . 13 fr.
TOME III : Acoustique.
Ootique ; Electro-optique.
Avec 193 usures ,
1892
'.
10 fr.
T J E S F O R G E S ( J . ) , Professeur de travaux manuels à l'Ecole industrielle
de Versailles ; ancien Garde d'Artillerie, ancien Chef aux ateliers
des Forges et Fonderies de la M a r i n e de l'Eiat, à Ruelle. — Cour»
pratique d'enseignement m a n u e l ,
à l'usage des candidats aux
Ecoles nationales d'Arts et Métiers et aux Ecoles d'apprentis et d'Elèves mécaniciens de la flotte, et à l'usage des aspirants au certificat d'aptitude pour l'enseignement du travail manuel, des élèves desécoles professionnelles-industrielles, etc. — A j u s t a g e . — F o r g e . —
Fonderie. — Chaudronnerie. — Menuiserie,
l n - 4 oblong, comprenant 76 planches de dessins avec texte explicatif; 1889. .
5 fr.
E N D R È S ( E . ) , Inspecteur général honoraire des Ponts e t
ChausséBS.
—
Manuel
d u
Conducteur
des
Fonts
et
Chaussées.
Ouvrage
in-
dispensable aux Couducteurs et Employés secondaires des Ponts et
Chaussées et des Compagnies de Chemin de fer, aux Gardes-mines,
aux Gardes et Sons-Officiers de l'Artillerie et du Génie, aux Agents
voyers et aux Candidats à ces emplois. Honoré d'une souscription
des
Ministères du Commerce et des Travaux publics, et recommandé
pour
le service vicinal par le Ministre de l'Intérieur,
7 édition modifiée
conformément
au décret du â juin 1888. 3 volumes in-8. . . 27 fr.
e
On vend
séparément:
TOME I : Partie théorique, avec 407 fig. ; et tome II : Partie
pratique, avec fig. 2 vol. in-8 ; 1884
18 f r .
Torna III : Partie technique. In-8, avec 241 fig. 1883 . .
9 fr.
Ce dernier Volume e 3 t consacré à l'exposition des doctrines s p é ciales qui se rattachent à l'Art de l'Ingénieur en général et au service;
des Ponts et Chaussées en particulier.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
-GOULIER (C.-M.).
Colonel da Génie en retraite. — É t u d e s t h é o r i q u e s e t p r a t i q u e s s u rl e sl e v e r s t o p o m é t r i q u e s e t e n p a r t i c u l i e r s u r l a t a c h é o m é t r i e . Un vol. in-8 de xxn-542 pages, arec flg.
et un portrait de l'Auteur, photogravé par Dujardin
J U P T N E R D EJ O N S T O R F F
de C h i m i e m é t a l l u r g i q u e .
(Baron
; 1892 .
Hanns^. — Traité
S fr.
pratiqua
Traduit, de l'allemand par E. Vlasto,
Ingénieur d e s Arts et Manufactures. Edition française, revue et augmentée par l'Auteur. Grand in-8, avec nombreuses figures et 2
planches ; 1891
10 f r .
(Charles). — R é p e r t o i r e c h r o m a t i q u e .
Solution
raisonnée et pratique des problèmes les plus usuels dans t'élude et l'emploi des couleurs. 29 TABLEAUX EN CHROMO représentant 952 teintes
différentes e t définies, groupées e n plus de 600 g a m m e s typiques.
Iu-4, eouteuant un texte de xi-141 pages, vrai traité de la science
pratique des couleurs, accompagné de nombreux diagrammes, et
suivi d'un atlas de 29 tableaux en chromo qui offrent à la fois l'illustration du texte et de nouvelles ressources pour les applications;
1890. (Ouvrage honoré de ta MÉDAILLE D'OH de la Société industrielle du
Nord de la France, 18 janvier 1891).
Broché. . . . 25 f r . | Cartonné . . . 30 f r .
I i È V Y ( M a u r i c e ) . Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Membre
de l'Institut, Professeur au Collège de France et à l'Ecole Centrale
des Arts et Manufactures. — L a S t a t i q u e g r a p h i q u e e t s e s
a p p l i c a t i o n s a u x c o n s t r u c t i o n s . 2 édition. 4 vol. grand i n - 8 ,
avec 4 Atlas de même format. (Ouvrage honoré d'une souscription du
ministère des Travaux
publics).
I PATITIE ; Principes et applications de la Statique graphique pure.
Gr. iu-8 d e x x v m - 5 4 9 pages, avec Atlas de 26 pl ; 1886. . 22 fr.
II PARTIE. — Flexion plane.
Lignes d'influence.
Poutres
droites.
Gr. iu-8 de xiv-345 pages, avec un Atlas de 6 pl ; 1886 . 15 fr.
III" PARTIE. — Arcs métalliques.
Ponts suspendus rigides.
Coupoles
et corps de révolution. Grand iu-8 de ix-418 pages avec u n Atlas
de 6 planches ; 1887
17 fr.
I V Partie. — Ouvrages en maçonnerie.
Systèmes rèliculaires
à lignes surabondantes.
Index alphabétique des quatre Parties. Grand
in-8 de x-330 pages, avec Atlas de 4 planches ; 1888. . . 15 fr.
X A C O T J T U R E
e
r 0
e
1
MIQUEL. — M a n u e l p r a t i q u a d ' A n a l y s a b a c t é r i o l o g i q u e d e s e a u x
In-18 Jésus, avec figures ; 1891
2 fr. 75 c.
Docteur ès Sciences, Ingénieur des Arts et Manufactures, Professeur aux Facultés catholiques de Lille. — C o u r s d e
m a n i p u l a t i o n s d e P h y s i q u e , préparatoire
à la Licence (ECOLE PRATIQUE DB PHYSIQUEJ.Un beau volume i n - 8 , a v e c 166 figures 1883. 12 fr.
W I T Z
(Aima),
W I T Z (Aimé). — E x e r c i c e s d e P h y s i q u e e t applications,
préparatoires
à in Licence
(ECOLE PBATIQUE DE PHYSIQUE).
l u - 8 , avec
114
figures;
1889
"WYROUBOFF
( 2 fr.
(G.). — M a n u e l p r a t i q u e d e C r i s t a l l o g r a p h i e .
Détermination
des formes cristallines,
l u - 8 , a v e c ligures e t 6 planches
e n t a i l l e - d o u c e ; 1889
12 f r .
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
LIBRAIRIE
Envoi
G A U T H I E R - V I L L A R S
franco contre
mandat-poste
E T
FILS
ou valeur sur
Paris
BIBLIOTHÈQUE
PHOTOGRAPHIQUE
La Bibliothèque photographique se compose d'environ 150 volumes
et embrasse l'ensemble de la Photographie considérée au point de vue
de la science, de l'art et des applications pratiques.
A côté d'ouvrages d'une certaine étendue, c o m m e le i-aité de
M. Davanne, le Traité encyclopédique
de M. Fabre, le Dictionnaire
de
Chimie
Photographique
Oe M. Fonrtier, etc., elle comprend une série
de m o n o g r a p h i e s nécessaires à celui qui veut étudier à tond un procédé et apprendre l e s tours de main indispensables pour le mettre eu
pratique. Elle s'adresse donc aussi bien à i'armiteur qu'au professionnel, au savant qu'au praticien.
EXTRAIT
BU
CATALOGUE.
B a l a g n y ( G e o r g e ) , Membre de la Sociélé française de Photographie,
Ducteur en droit. — Traité de Photographie
par les procédés peiliculaires. Deux volumes grand i n - 8 , avec figures ; J889-1890. chaque
volume se v e n d séparément
4 fr.
1
On vend séparément :
D o n n a d l e u . ( A . L·.) Docteur és-scienefs. Traité de Photographie
stèréoscopique.
Théorie et pratique.
Grand in-S avec figures et allas de
20 planches stéréoscopiques et photocollographie ; 1892 . . . 9 fr.
Chatoie ( E . ) , Président du Photo-Club de Neuchatel. — Les travaux de
l'amateur photographe en hiver. 2° édition. In-18 Jésus, avec 2 planches et namhreuse.s figures ; 1892
3 fr.
D a v a n n e . — La Photographie.
Traité théorique et pratique.
2 beaux
volumes grand in-8, avec 234 figures et 4 planches spécimens.
32 fr.
On vend séparément :
I»° PARTIE: Notions élémentaires. — Historique. — Épreuves négatives.
— Principes communs à tous les procédés négatifs. — Epreuves sur
albumine, sur colludion, sur gélatinohromure d'argent, sur pellicules, sur papier. Avec 2 planches et 120 figures; 18S6 . .
16 fr,
II PARTIE : Epreuves positives : aux sels d'argent, de platine, de fer
de chrome. — Epreuves par impresâi}ns photomécaniques. — L i - vers : Les couleurs- on Photographie. £ p r e u v e a stéréoscopiques,
Projections, agrandissements, micrographie. Réductions, épreuves
microscopiques. Notions élémentaires de Chimie ; vocabulaire. Avea
2 planches et 114 figures ; 1888
16 fr.
e
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
F a b r e ( C ) , Docteur èa Sciences. — Traité encyclopédique
de Photo
graphie, 4 b e a u x v o l u m e s gr. in-8, a r e c plus de 700 figures et
2 planches; 1889-1891
48 fr. »»
Chaque volume se vend séparément 14 fr.
Tous les trois ans, un Supplément, destiné à exposer les progrès
accomplis pendant celte période, viendra compléter ce Traité et te maintenir
au courant des dernières
découvertes.
Le p r e m i e r S u p p l é m e n t est mis en souscription. Il est p u b l i a
comme les précédents volumes en cinq fascicules dont le premier a
paru le 15 juillet 1892. La souscription sera close lé 15 décembre 1892.
Prix du supplément pour l^s souscripteurs
10 fr.
Le prix sera porté ultérieurement à
14 fr.
F o u r t l e r (H.). — Dictionnaire
pratique de Chimie
photographique,
contenant une Étude méthodique des (tivers corps usités en Photographie, précédé de Notions usuelles de Chimie et suivi d'une Description détaillée des Manipulations
photographiques.
Grand i n - 8 , avec
ligures; 1S92
8 fr. »»
—- Les Positifs sur verre. Théorie et pratique. Les positifs pour
projections.
Stéréoscopes et vitraux. Méthodes opératoires.
Coloriage et
montage.
Grand in-8, avec figures; 1892
4 fr. 50
— La pratique des projections. TCtude méthodique des appareils. Les
accessoires ; usages et applications diverses des projections. Conduite des séances. 2 volumes in-18 Jésus se vendant ccparémeDt.
I. Les appareils avec 66 figures; 1892;
2 fr. 75
II. Les projections avec figures ...
(Sous presse).
L o n d o (Al, Chef du service photographique a la Salpêtriére. — La
Photographie instantanée. 2° édition. I n - i 8 Jésus, avec belles figures;
1890
2 fr. 75
— Traité pratique du développement.
Étude raisonnée des divers r é v é lateurs et de leur mode d'emploi. 2 édition. In-18 Jésus, avec figures et 4 doubles planches en photocollographie; 1892 .
2 fr. 75
M e r c i e r ( P . ) , Chimiste, Lauréat de l'Ecole supérieure da Pharmacie de
Paris. — Virages et fixages. Traité historique,
théorique et pratique.
2 vol. in-18 Jésus ; 1892
5 fr.
e
On vend séparément
:
r e
l Partie : Notice historique. Virages aux sels d'or.
.
2 fr. 75
11 Partie : Virages aux divers métaux. Fixages . . . .
2 fr.75
Trutat
(E.), Docteur ès sciences, Directeur du Musée d'Histoire
naturelle de Toulouse. — Traité pratique des agrandissements
photographiques. 2 vol. in-18 jôsus, avec 105 figures ; 1891.
9
I" PARTIE ; O b t e n t i o n d e s p e t i t s c l i c h é s ; a r e c 5 2 figures . . .
11" PARTIS : A g r a n d i s s e m e n t s , ; a Y B ^ 5 3
figures
. . . . . .
2 fr. 7 5
2 fr. 7 5
— Impressions photographiques
aux encres grosses. Traité pratique
de
photocollographie
à l'usage des amateurs. IQ-18 Jésus, avec n o m b r e u ses figures et l planche en photocollographie ; 1892 . .
2 fr. 75
V i d a l (Léon), officier de l'Instruction publique. Professeur à l'École
nationale des arts décoratifs. —Manuel pratique
d'Orthochromatisme.
In-18 Jésus avec figures, 2 planches dont une en photocollographie
et un spectre en c o u l e u r ; 1891
2 fr. 7a
V i e u i l l e . — Nouveau guide pratique du photographe
amateur. 3 édit
refondue et beaucoup augmentée. In-18 jêsus avec fig. 1892. 2 fr. 7ï
e
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
SEVDE GÉNÉRALE
DES
SCIENCES
P U R E S
&
A P P L I Q U É E S
araigsant le 15 et le 30 de chaque, mois, par cahiers de 32 page:
grand i n - 8 ' colombier, imprimés à 2 colonnes
avec do nombreuses figures dans le texte.
'DIRECTEUR :
C e t t e Revue,
L o u i s OLIVIER,
à laquelle
DOCTEUR
collaborent
È S SCIENCES
31
membres
de l'Académie des Sciences d e P a r i s et les
s a v a n t s l e s p l u s i l l u s t r e s d e t o u s p a y s , a pour
objet d'exposer, à m e s u r e qu'ils se produisent et en quelque
p a y s q u ' i l s s ' a c c o m p l i s s e n t , l e s p r o g r è s d e s SCIENCES POSITIVES
e t d e l e u r s A P P L I C A T I O N S P R A T I Q U E S : Astronomie,
Mécanique,
Physique,
Chimie,
Géologie,
Botanique,
Zoologie,
Anatomie,
Physiologie
générale
et Physiologie
humaine,
Anthropologie,
—
Géodésie,
Navigation,
Génie civil et Génie militaire,
Industrie,
Agriculture,
Hygiène publique,
privée et
professionnelle,Médecine,
Chirurgie.
Chacun de ses n u m é r o s renferme trois parties :
1 ° L a p r e m i è r e s e c o m p o s e d'ARTidES O R I G I N A U X , d e
g r a n d e s a n a l y s e s c r i t i q u e s e t d e r e v u e s s p é c i a l e s ; le l e c « u r y t r o u v e r a l a synthèse
précise
des grandes
questions
à
?ordre du jour; c e l l e s q u i s e r a p p o r t e n t à l a MÉDECINE s o n t
l a n s c h a q u e n u m é r o l'objet d ' u n article spécial.
2 ° L a d e u x i è m e p a r t i e e s t c o n s a c r é e à I'ANALYSE BIBLIOCRAPUIQDE DÉTAILLÉE d e s l i v r e s e t d e s m é m o i r e s i m p o r t a n t s ,
r é c e m m e n t p a r u s s u r l e s s c i e n c e s mathématiques,
physiques,
naturelles,
médicales;
3° L a t r o i s i è m e p a r t i e r e n f e r m e l e c o m p t e r e n d u d e s
travaux présentés aux A c a d é m i e s et a u x p r i n c i p a l e s
Sociétés savantes d u monde
entier.
Tous ceux qui, à des titres divers, s'intéressent au
progrès théorique
et pratique
des sciences, t r o u v e r o n t d a n s c e t t e
Revue
l e tableau
complet du mouvement
scientifique
actuel.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
SPÉCIMEN D'UN NUMÉRO
I.
—• H . POINCAKÉ, de
diennes.
H,
— D
l'Institut
: Les Geometries
non-Eucli-
R A
MAGNAN e t SÉRIEUX : L e s A l i é n é s p e r s é c u t e u r s ; l e u r s
caractères anthropologiques
et psychiques ;
leur
diagnose.
— J . BERGERON, docteur ès sciences : L a F a u n e d i t e « p r i m o r d i a l e « a-t-elle é t é l a p r c n A r e ? D é c o u v e r t e s r e ' c e n t e s
de l a paléontologie et d e l a p é t r o g r a p h i e s u r ce sujet
(avec de n o m b r e u s e s figures).
III.
IV.
— J . BOUVEAULT, docteur ès sciences .· L a S y n t h è s e d e s a l caloïdes n a t u r e l s (avec e x e m p l e s d e p r é p a r a t i o n ) .
V.
— A n a l y s e bibliographique:
i° S c i e n c e s m a t h é m a t i q u e s ;
2" S c i e n c e s p h y s i q u e s ; 3° S c i e n c e s n a t u r e l l e s ; 4° S c i e n ces m é d i c a l e s .
VI.
— Académies
et Sociétés savantes
de la France et de
N O T A . — L a Revue p u b l i e , a v e c
un
Supplément
d e huit
chacun
colonnes
l'Etranger
de ses numéros,
r e n f e r m a n t : 1° L e s
nouvelles de la Science e t d e l'Enseignement;
2° l e s s o m -
m a i r e s d e 300 p é r i o d i q u e s scientifiques classés p a ro r d r e de
science.
UN
N u m é r o s p é c i m e n s e r a a d r e s s é g r a t u i t e m e n t 'à t o n t e PERSONNE
qui e n fera l a demande.
PRIX DO NUMÉRO:
S
O
c e n t i m e »
ABONNEMENTS : CHEZ GEORGES CARRÉ, ÉDITEUR
58,
rue Saint-André-des-Arts,
farts
Paris
U n an, 1 8 f r . ; 6 mois, 1 0 t e .
Cépartemants Bt AlsacB-Lorralns
Union
postale
--.
—
—
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
20 —
22 —
—
11 —
— 1 2 - »
Q
T R A I T É
DE PHYSIQUE INDUSTRIELLE
PRODUCTION
ET
UTILISATION
DE LA CHALEUR
Par
L.
S E R
Professeur à l'Ecole Centrale d e s Arts et
AVEC LA COLLABO HAT ION DE
L.
GARETTE
et E.
Manufactures.
Mï.
HERSCHER
I n g é n i e u r s d e s A r t s et M a n u f a c t u r e s , M e m b r e s d e la S o c l e te d e s I n g é n i e u r s c i v i l * .
M e m b r e s d e Ja S o c i é t é de m é d e c i n e e t d ' b y g i e u e p r o f e s s i o n n e l l e .
2 forts v o l u m e s i n - 8 " i l l u s t r é s de 790 f i g u r e s .
4 5 fr.
/.
— Principes
généraux
et appareils
considérés
d'une manière
générale
indépendamment
de
toute
application
particulière
(foyers
récepteurs
de
chaleur,
cheminées,
ventilateur,
thermodynamique).
I fort volume
in-8° avec 3t>2 figures.
.
22 / / · . 50
II.
— Chaudières
à vapeur.
— Distillation.
—
Evaporation
et séchage.
— Désinfection.
—
Chauffage
et ventilation
des lieux habités.
1 fort volume
in-8"
avec 428 figures
22 / / · . 50
Le T r a i t é d e P h y s i q u e i n d u s t r i e l l e est avant tout le résumé
du cours professé à Y Ecole Centrale par le savant et regretté
professeur, depuis qu'il occupait la chaire de M. Péclet.
C'est en m ê m e temps un ouvrage absolument pratique,
s'adressant non seulement aux élèves, mais aux Ingénieurs, aux
Architectes,
aux Membres des Comités d'hygiène, etc.
Le second volume est publié avec la précieuse collaboration
de deux h o m m e s bien connus par leur compétence industrielle,
et tient compte, par conséquent, de tous les travaux, de toutes
les découvertes qui se sont produits depuis l'Exposition de 1889.
II traite de deux questions très d i v e r s e s : Les Chaudières
à
vapeur et le Chauffage et la
Ventilation.
Nous l'avons, pour la facilité des lecteurs, publié en deux
fascicules qu'où peut acheter séparément.
JLlBBAime
a. JTASSOIT,
1 « , BOULEVARD
SAIXT-OERMAiy,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
A
PARIS
BIBLIOTHÈQUE
DIAMANT
DES
SCIENCES MÉDICALES ET BIOLOGIQUES
Collection publiée dans le format in-18 raisin,
cartonnée
à l'anglaise
Manuel de Pathologie i n t e r n e , par G. DIEULAFOY, professeur à la
Faculté de médecine de Paris, m é d e c i n des hôpitaux, lauréat
de l'Institut (Prix Moutyon). 6° édition. 2 vol
13 fr.
Manuel du d i a g n o s t i c m é d i c a l , par P. SPILLMAMJ, professeur
à la Faculté de médecine de Nancy et P. HAUSHALTER, chef de
clinique médicale. 2° édition, entièrement refondue . . 6 fr.
Manuel d'anatomie m i c r o s c o p i q u e et d'histologie,par P.-K. L A D SOIS et H. Aloiuu, préparateurs-adjoints d'histologie à la
Faculté de médecine de Paris, préface de M. Matnias De VAL,
professeur à la Faculté de médecine de Paris
6 fr.
S é m é i o l o g i e e t d i a g n o s t i c des m a l a d i e s n e r v e u s e s , par Paul
BLOGQ, chef des travaux anatomo-pathologiques à la Salpétrière, lauréat de l'Institut, et J. UNASOFP
5 fr.
Manuel de t h é r a p e u t i q u e , par le D BERLIOZ, professeur à la Faculté de médecine de Grenoble,précédé d'unepréface de M.BOUCHARD, professeur à la Faculté de médecine de Paris, . 6 fr.
Précis de m i c r o b i e m é d i c a l e et v é t é r i n a i r e , par le D L . - H .
THOWOT, ancien interne des hôpitaux et E.-J. MASSELIN, m é decin-vétérinaire, 2" éd., 75 fig. noires et en c o u l e u r s . 6 fr.
P r é c i s de m é d e c i n e j u d i c i a i r e , par A. LACASSAONE, professeur
à la Faculté de m é d e c i n e de Lyon. 2 édition . . .
7 fr. 50
Précis d'hygiène p r i v é e e t s o c i a l e , par A . LACASSAONE, professeur à la Faculté de médecine de Lyon. 3· édition revue et
augmentée
7 fr.
Précis d'anatomie p a t h o l o g i q u e , par L. BARD, professeur
agrégé à la Faculté de médecine de Lyon
7 fr. 50
Précis t h é o r i q u e e t pratique de l ' e x a m e n de l'œil e t de l a
vision, par le l ) CHAUVEL, médecin principal de l'armée, professeur â l'F.cole du Val-de-Gràce
6 fr.
Le Médecin. Devoirs privés et publics; l e u r s rapports a v e c la
Jurisprudence et l'organisation médicales, pa.r A . DECHAMBHE,
membre de l'Académie de médecine
6 fr.
Guide pratique d'Électrathérapie, rédigé d'après les travaux
et les leçons du D U.NIMUS, lauréat de l'Institut, par M. BONNEFOY. 3 'édition, revue et augmentée d'un chapitre sur
l'élecR
r
e
r
R
e
tricilé
statique,
par
le D
r
DAMOX
6
fr.
Paris : sa t o p o g r a p h i e , s o n h y g i è n e , s e s m a l a d i e s , par Léon
COLTS, directeur du service de santé du g o u v e r n e m e n t militaire de Pari3
6 fr.
L I B R A I R I E
G . U A S S O I f ,
1 2 0 ,B O U L E V A R D
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
S A I N X - Q E R M . A I X ,
A
P A R I S
m
@
DICTIONNAIRE
I
DES ARTS a MANUFACTURES
ET
FORMANT
DE L'AGRICULTURE
UN TRAITÉ
Par Ch.
Aveo la
collaboration
de
COMPLET
DE
TECHNOLOGIE
LABOULAYE
Bavants,
d'Industriels
e t de
Fublicistes
SEPTÈIME ÉDITION, PUBLÉIE EN 5 VOLUMES
REVUH KT COMPLÉTÉE A LA SUITE DE L'EXPOSITION
DE
1889
I m p r i m é e s u r d e u x c o l o n n e s a v e c p l u s d e îi,000
figures
dans le t e x t e . P r i x d e s 5 v o l u m e s : b r o c h é s . 1 2 0 fr.
reliés
1 4 5 fr.
Le Dictionnaire des Arts et Manufactures
est devenu, pan son
grand et légitime succès, un ouvrage classique parmi les ingénieurs et tous ceux qui s'intéressent aux progrès de l'industrie.
C'est un ouvrage de re-cherches et d'études que l'on consulte,
non seulement pour y tr u v e r des renseignements sur sa
propre industrie, mais souvent aussi sur les procédés des industries connexes, et sur le>- questions générales qui intéressent
toute entreprise industrielle. L'Exposition de 1889 a fourni une
abondante récolte d'indications précieuses, m i s e s a preflt par
les collaborateurs de M. Ch. Laboulaye qui continuent SOB
œ u v r e . Parmi les sujets remaniés ou traités à nouveau dans
leur entier, nous citerons : l'électricité (installation d'éclairage,
projets de machine, transport de la force, etc.), le verre, le
sucre, les constructions métalliques, l'éclairage, la métallurgie,
les canaux, le matériel des c h e m i n s de fer, les instruments
d'agriculture, la statistique g r a p h i q u e , la statistique industrielle et agricole, l e 3 institutions de prévoyance (caisses de
retraitas, assurances, sociétés coopératives, réglementation du
travail, syndicats professionnels, etc.). La nouvelle édition du
Dictionnaire
des Arts et Manufactures
est tenue au courant
des
- o r è s , et nous avons lu avec grand intérêt, parmi les
artii J nouveaux, ceux qui se rapportent à la statistique et
aux institutions de prévoyance. Cette nouvelle édition aura le
auccès de ses devancières.
u
LIBRAIRIE
G. «ASSOIT,
ISO, BOULEVARD
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
( E x t r a i t d e La
Naître.)
SAINT-GERMAIN,
A F A
RIS
e
a
T R A I T É DE
MÉDECINE
Publié tous la direction de M M . CHARCOT et BOUCHABD, m e m b r e s
de l'Institut et professeurs à la Faculté de médecine de
Paris et BRISSAED, professeur agrégé, par M M . BABIHSKI, BALLET, BBAIILT, CHARTEMESSE, CHAHHIIV, CHAUFFRD, COURTOIS-SUFriT, GILBERT, GUINON, L E GENDRE, MARPAK, MARIE,
MATHIEU,
NETTER, QETTINOER, ANDRÉ PETIT, RICHARDIÈRE, ROGER, RUAULT,
THIBIFRGK,
L . - H . THOINOT, FERNAHD VIDAL.
6 vol.
in-8.
avec figures
cription
(3 vulumes publiés au 1 " mai 1892) En sous· . 1 1 2 fr.
T R A I T É DE
CHIRURGIE
Publié sous la directiou de M M . Simon DUPLAY, professeur de
clinique chirurgicale a la Faculté de médecine de Paris, et
Paul RECLUS, professeur agrégé, par M M . HEIIGEB, BROCA,
DELBET, DELENS, GÉRARD-MARCHANT, FORGIIE, HARTMANN, H E T DEKREICH, JALAGUIER, KIRMISSON, LAGHANGE, LEJAHS, MICHAUX,
N ÉLTU>, PEYHOT, PofiChT,
POTIIKRT, QLENU, RICARD, SECOND,
TUEFIER, WALTIIKR. 8 forts volumes in-8 avec n o m b r e u s e s
figures (7 volumes publiés au i
mai 1892). En souscription
1 4 0 fr.
F r
T R A I T É DE G Y N É C O L O G I E C L I N I Q U E
ET
OPÉRATOIRE
Par S. Pozzi, professeur agrégé à la Faculté le médecine
de Paris, chirurgien de l'hôpital Lourcine-Pasc '. 2« édition.
1 v o l . i n - 8 , relié toile avec 500 figures dans le tb '.e 30 fr.
LEÇONS
S U R LA P A T H O L O G I E
DE
COMPARÉE
L'INFLAMMATION
Faites à l'Institut Pasteur e n avril et mai 1891, par Elie
METCUNIKOFF, chef de service a l'Institut Pasteur. 1 v o l . in-8
avec 65 figures dans le texte, eu noir et e n couleur et
S planchei en couleur
9 fr.
LE D I A B È T E
PANCRÉATIQUE
Expérimentation,
Clinique,
Anaiomie pathologique,
par le D ' J.
TOIROLOIX, interne, médaille d'or des hôpitaux, membre de
la Société anatomique. i v o l . in-8, avec planches et grapb
ques hors texte
8 frLIRRAÌRIE
G. MASSON, 120, BOULEVARD
<a
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
ST-GERMAIN,
PARIS
REVUE DES SCIENCES
ET DE LEURS APPLICATIONS AUX ARTS ET A L'INDUSTRIE
JOURNAL
HEBDOMADAIRE
ILLUSTRÉ
RÉDACTEUR F.N CHKF : G A S T O N
TISSANDIER
C e t t e r e v u e , si s a v a m m e n t d i r i g é e p a r M . TISSANDIKR, r é p o n d à u n
b e s o i n a c t u e l . T o u s c e u x q u i s e p r é o c c u p e n t u n p e u d e s p r o g r è s scientifiq u e s , d e s d é c o u v e r t e s utiles faites à c h a q u e i n s t a n t , t r o u v e r o n t d a n s s e s
p r é c i e u s e s p a g e s t o u t e s l e s t r o u v a i l l e s i n t é r e s s a n t e s , e n r e g i s t r é e s au j o u r
le j o u r . S a n s p e i n e , il p o u r r o n t profiter d u t r a v a i l a c c u m u l é d a n s c e t t e
v é r i t a b l e E n c y c l o p é d i e . I l s n ' y r e n c o n t r e r o n t p a s s e u l e m e n t les r é s u l t a t s
p r a t i q u e s a u x q u e l s on est a r r i v é ; ils y v e r r o n t é g a l e m e n t les t e n t a t i v e s
faites p a r l e s c h e r c h e u r s d a n s t e l l e ou telle voie, le b u t qu'ils p o u r s u i v e n t ,
les m n y K n s q u ' i l s e m p l o i e n t . A c e t i t r e , La Native
e s t double m o n t utile
a u x i n v e n t e u r s . Kilo p e u t les é c l a i r e r parfois, s o u v e n t l e u r i n d i q u e r d e s
s u j e t s d e r e c h e r c h e s . E n t o u s c a s , c e s e r a t o u j o u r s a v e c profit q u ' i l s l'aur o n t c o n s u l t é e . Bref, c'est u n o u v r a g e v é r i t a b l e m e n t utile p o u r b e a u c o u p
d e g e n s , i n t é r e s s a n t p o u r t o u s . L e t e x t e e n e s t t o u j o u r s r é d i g é d'une
façon b r è v e e t c o n c i s e ; les i l l u s t r a t i o n s s o n t d u e s à nos m o i l l e u r s a r t i s t e s
et g r a v é e s a y e e le p l u s g r a n d soin.
P R I X
DE L ' A B O N N E M E N T
A N N U E L :
Les 37 premeirs vculmes sont en vente, et sont vendus
P a r i s , 2 0 fr. — D é p a r t e m e n t s , 2 5 fr. — U n i o n p o s t a l e , 2 6 fr.
B r o c h é , 10 f r . — R e l i é , 1 3 fr. 5 0 .
Z.IBRAIRIS
CF. MASSQK,
1£Q,
BOULEVARD
SA
1NT-
1
&
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
QERMA
ITF,
—
A
FA
SIS
©
chacun :
TRAT
IEMENT DE LA TUBERCULOSE PULMONAR
IE
D E LA. P L E U R É S I E D'ORIGINE T U B E R C U L E U S E
ET
DES
BRONCHITES
AIGUËS
ET
CHRONIQUES
p a r le
GAIACOL I0D0F0HME SÉRAFON
Et le Gaïacol-Eucalyptol iodoformé Scrafon
E n
solutions
et
en
p o u r
capsules
PRÉPARATION
ET VENTE
duits Pharmaceutiques,
ALIMENTATION /
DES
M A L A D E S
PAR
p o u r
h y p o d e r m i q u e s
l'usage
interne
EN GROS : Société Française de Pro9 et M rue de la Perle,
Paris.
La P O U D R E d e
BIFTECK
ADRIAN
(garantie
pure viande
de
bœuf français) e s t a u s s i i n o d o r e et i n sapide qu'il est possihle de l'obtenir en
l u i c o n s e r v a n t les p r i n c i p e s n u t r i t i f s d e
la v i a n d e . C ' e s t e x a c t e m e n t d e l a c h a i r
m n s c u l a i r e privée de son eau, g a r d a n t
s o u s u n v o l u m e t r è s r é d u i t et s o u s u n
p o i d s q u a t r e fois m o i n d r e , t o u t e s s e s
p r o p r i é t é s n u t r i t i v e s , et c h o s e i m p o r tante, n ' a y a n t rien perdu des principes
nécessaires à l'assimilation de l'aliment.
Se vend en flacons de 250,
et 1 hil.
LES
La P O U D R E
A D R I A N , d'un prix
la p o u d r e d e b i f t e c k ,
l'emploi aux malades
garantie pure viande
rique.
DE
Viande
A l t l E B
injections
bottes de 250.
I
500
gr.
DE
VIANDE
m o i n s élevé q u e
ce qui en p e r m e t
peu fortunés est
de b œ u f d ' A m é -
500
gr. et 1
kil.
V
QUASSINE A D R I A N
e s s e n t i e l l e m e n t différente d e t o u t e s celles d u c o m m e r c e , est la
SEULE d o n t l e s effets r é g u l i e r s a i e n t é t é c o n s t a t é s . E l l e e x c i t e
I'APPÉTIT, d é v e l o p p e l e s FORCES, c o m b a t e f f i c a c e m e n t l e s D Y S P E P S I E S ATONIQUES, les
COLIQUES HÉPATIQUES e t
NÉPHRÉTIQUES.
(Bulle-
t i n g é n é r a l d e t h é r a p e u t i q u e , 15 n o v e m b r e 1882).
D r a g é e s c o n t e n a n t 25 m i l l i g r a m m e s de Quassine a m o r p h e .
Granules
—
2
—
Quassine cristallisée.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
ANÉMIE
D a n s l e s c a s d e CHLOROSE et
d'ANÉMIE
rebelles a u x moyens
thérapeutiques
o r d i n a i r e s lea p r é p a r a t i o n s à base
D'HÉMOGLOBINE
SOLUBLE
DE V . D E S C H I E N S
ÉPUISEMENL
OAFFAIBLISSEMENT
GÉNÉRAL
o n t d o n n é l e s r é s u l t a i s lea p l u s s a t i s f a i s a n t s . Elles n e constipent pas, ne noirc i s s e n t p a s lea d e n t s e t n ' o c c a s i o n n e n t
j a m a i s d e m a u x d ' e s t o m a c c o m m e la
plupart des autres ferrugineux.
Se v e n d s o u s l a f o r m e d e
SIROP, VIN, DRAGÉES
ET ËLIXIR
p r é p a r é s ' p a r A D R I A N e t Gie, 9 r u e d e
la Perle, Paris.
CAPSULES DE TERPINOL ADRIAN
Le TERPINOL a l e s propriétés de f e B s e n c e d e Térébenthine dont il
dérive, mais il est plus facilement absorbé et s u r l o u t très bien toléré,
ce qui le rend préférable.
Il n'offre p a s , comme l'essence de Térébenthine, l'inconvénient
grave c e provoquer chez l e s malades d e s nausées, souvent même des
vomissements.
Le TERPINOL est un diurétique et u n puissant modificateur des sécrétions catarrhales (bronclies, reins, vessie).
Le TERPINOL ADRIAN s'emploie en capsules Je 10 centigramme»
(5 à 10 par j o u i ) .
TRAITEMENT de . SYPHILIS a r , PILULES DARDENNE
a
P
M
POLY-IODURÉES SOLUBLES
S O L U B L E S d a n s t o u s les liquides s e r v a n t do boisson (Eau, lait,
café v i n , bière, etc.) elles p e u v e n t ê t r e p r i s e s e n pilules ou
transformées p a r les malades, en s o l u t i o n s ou en s i r o p s , au
m o m e n t d'en faire u s a g e .
P r e m i e r t y p e ( t y p e faible)
( S y p h i l i s Drdij>Aw«-$*-^t 3 * année)
l
Q u a t r i è m e t y p e (typa fort)
V (accidents tertiaires, yincéraui et cutanea)
2 pik>JC|^}j^yEjour >corrcspon- »j
8 pilule»par jour correspondent
d e n t / o i [ j n c ^ u j i l l e r é e À U o u p e DE \ Â u n centig.bi-iodure de m e r c u r e
Siçéf^ibYSibeçt.
J
[ età4grammesioduredepotassium.
LIANTE ENNITOS l^ôjrfété F r a n ç a i s e de P r o d u i t s P h a r m a c e u t i q u e s ,
^OT Ll r u e d e LA P e r l e , PARIS.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
ENCYCLOPÉDIE SCIENTIFIQUE DES AIDE-MÉMOIRE
COLLABOBATEUB.S
Section
du
Biologiste
MM.
MM.
Arloing ( S . ) .
Auvard.
Ballet (Gilbert).
Bar.
Barthélémy.
Baudouin.
Bazy.
Beauregard ( H . ) .
Berge.
liergonié.
Berne ( G . ] .
Berthant.
Blanc ( Louis ).
Blanchard (II.)
Bonnaira.
Brault.
Brissaud.
Broca.
Brocq.
Brun.
Brun ( d e ) .
Budin.
Castex.
Gazai (du).
Chantemesse.
Charrin.
Cornevin.
Croiizat.
Cuénot (L.).
Dastre.
Deliërain.
Delorme.
Demelin.
Dubois (Raphaël).
Purand-Fardel.
Duval (Mathias).
Faisans.
Féré.
Fernbach (A.).
Feulard.
Filhol ( I L ) .
François-Franck (Clu)
Gamaleïa.
Gariel.
Gérard-Marchant.
Gilbert.
Girard (Aimé).
Girard ( A . - C h . J *
Gley.
Gombault.
Grancher.
Guerne (J. de).
llanot.
Hartmann (H.).
Hébert (A.).
Hennegiiy.
Henocque.
Heydenreich.
Jacquet.
Jollroy.
Johaiinès-Chatin.
Kœhler.
Labit.
Landouzy.
Langlois ( P . ) .
Lannelongue.
Lapersoime ( d e ) .
Lavarenne ( d e ) .
Laveran.
Lavergne.
Layet.
Le Dcntu.
Le grain.
Legroux.
Lermoyez (M.).
Letulle.
Lhôte.
Magnan.
Marfan.
1 Marie ( A . ) .
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
MM.
Martin ( A . - J . ) .
Maygrier.
Merklen,
Meyer.
Napias.
Nocard.
Olivier (Ad.).
Olivier (L.).
Ollier.
Patouillard.
Peraire.
Perrier (Bdm,).
Peyrot.
Folin.
Pouchet (G.).
Pozzi.
Prillieux.
Quènu.
Reclus.
Retterer.
Roger (II.).
Ruault.
Séglas.
Se gond.
Sérieux.
Spillmann.
Straus.
Talamon.
Testut (Léo).
ïissier.
ï h o u l e t (J.).
Trousseau.
Vallon.
Viala.
"Viault.
W e i l l (J.).
• Weiss (G.).
Wurtz.
ENCYCLOPÉDIE SCIENTIFIQUE DES X.
DIRIGÉE „ f A R ^ 4
Collection d e 300 YO
i
p-AUTÉ,
f»pti
^BRJS J>E
in-S ( 3 0 j t , 4 0 x p l ma& ,
CHAQUE VOLUMB SH Y»; p g t f . H O E K T : BR.OCHB& Û
0 fv c ^ s et tours de puSlicat
o
S cjon
S e c t i o n d e Yh
A. GODILLY.— T r a n s m )
par air comprimé o l
R . - V . P i c o u . — Distribj ii
cité p a r i n s t a l l a t i o n * i
DUQURSNAY.— R d s i s t a n
ri a u x .
tj
n eu.
u |
force
fAisAWS,—Mala
a
pïratoïrea-.
f
feignea
h siqv
MAONASV Ï S B
iquo a ôv
AUVARD.— B é m é ' o t |
•femme
G WEI88 —
<V "
DWELSIÏArJVKRS-DERY.^f
sie 9g e .
m e n t a l e calorimétridj
iCifcY — M a ï a d e »
â vapeur.
U r è t r e . "Vesa
A . MADAMET.— T i r o i r a 3
acebo
tements
d*u g e n
de vapeur. — Àpparf
fies
VrjRW.-^ T e c h q *
m a r c h e et d e c h a n g e a
T
ODSSB&W
— [Hy% *
MAGNIER DH LA S o u R c t
VFBÏS-*- Ep epsi .
vins.
I
bjxefc 4
ï VRHAN.r- P a adierne
ALHEILIO.— R e c e t t e , ûL
o ï M & " e t L A S T —* J
t r a v a i l d e s b o i s , outîT
éleç-t,
outils.
^
monts aspects..
R . - V . P i c o r / . — Distribq
MVGKIN — L o s a c a r ï o n s p a r a s i t e ^
trïcité par usines coij
B E i r c o i s ï ô . — P h y s i q u e «nédioatev
AIMÉ "WITZ.— T h e r m f ;
•DÉM*iaiï.»-*Anatomio o b s t é t r i c a l e .
l'usage d e s I n g é n i e u i ^
CoBNcrf ^-Lés moyens d e d é f o n s o ^ a n s
LIPIDKT.— L a b i è r e .
i a séria nima .
L B CHATELIER.— L e G:
"DE LAPEKSO&NE.—Maladies d e s p^U-®
3 <i «QOt
TH. SCHXŒSIN& fils.
p î è r e p at d o s m e m b r a n e s d e 1 oui
SAUVAGH.— L e s d i v e r s
BVDTS—^Tbérapeut'que
obstèfcncÊ.fe^
g-ent.
teurs a vapeur,
KCSHLER.^—* A p p l i a t i o n <io-Ifc phutô^j
I I . GAUTIEB. — E s s a i s d'
JE
-do
g r a p h i e aj x s c i e n c e s natnrel'îeE''.
$
H . LAURENT/ — Théo:
ïiBTor T A — M a l a d i e s s i g n é s <5e i â èfcï*1
hasard.
Cui- inlG
CKONEAU.— C a n o n s . Ti
DB BRUN^— M a l a d i e s d e s p a y s chancCa*-?
bines,
rasses.
\
BAZY—Êtud
<~es t r o u b l a s f b m c t ï o n ^
GÉRARD-LA VERGNE. — j.-é $ ( a u x ï j e u r
n e l e 'des> v o i e s wrinair«»»«
LECOMTK.— L e s t e x t i l e s ]
FAISANS.— D i a g n o s t i c ^rec-oce::dfi"+la.
e x a m e n rnicroscopiqù
«les g î t e s
tuberculose
D E LAUNAY. —r F o r m l
•DASTRK.^
L a D%ostion,;
métallifères.
Ssoirea d e s
LUDEBOUT.—Appareils
AIMK OJRAHD. T-a. b e t e e r a v a à,
moteurs à vapeur.
BROCQ
<>t
JAdQTiKT. ->— T r a i t é éléinôn-g
d « n o des
FERDINAND JKAN. — L*>
t a i r c r pratique de dermatologie, ^
poan't ot d o s c u i r s .
LAKNBLOKQUS^—La* Tttboreulos& c^*des
LAURIM** NAUDIN. -%Fy,'b R a t i o n
rur^icale.
.
vernis.
STHACS.— L e s b a c t é f i a s .
IIÉBprT.— E x a m e n eom % i*o d e r boisN P AS.— H y g i à n o Itidttstrielle c £
sous falsifiées.
f
fessionnello.
*
GUBNEZ.— L a d é c o r a t i o n d l a p o r c e GOMBAULT^—^Pathol^
l a i n e a u feu d e m o u f t p f
c idien.
gânëràlo m'
H. LÉATJTÉ e t A . EKKARt) — T r & n s m u
LEGROCX.— P a t l ï o l o g i t f j
aionspar câbles métall g nos.
tilG
é
ctn-
l
1
?
1
y
i *r>
$tk&h*£
E
1
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
© Copyright 2026









